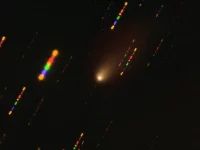Année charnière. Henry Kissinger, l’odieux prix Nobel de la paix 1973

REALPOLITIK L’attribution du prix à l’ex-secrétaire d’État américain avait fait scandale. Pourtant, lors de sa mort en novembre dernier, des hommages le gratifient de « grand homme du siècle », alors que ni le bilan ni les méthodes du personnage ne le justifient.
10 décembre 1973, à Oslo, la traditionnelle remise du prix Nobel de la paix ne se déroule pas comme à l’accoutumée. Les deux récipiendaires de la prestigieuse récompense ne sont pas présents pour la recevoir des mains du roi de Norvège. Et dans les rues de la capitale scandinave, des manifestants organisent une contre-manifestation avec un prix alternatif.
Le choix du comité a, il est vrai, surpris et laissé perplexes la plupart des observateurs lors de son annonce en octobre. Pour saluer l’accord de cessez-le-feu au Vietnam qui a été signé à Paris le 23 janvier, le prix Nobel de la paix a été en effet attribué aux deux négociateurs, le Nord-Vietnamien Lê Duc Tho et l’Étasunien Henry Kissinger, alors conseiller spécial de la Maison-Blanche devenu en septembre de cette même année secrétaire d’État (ministre des affaires étrangères).
La présidente du comité Nobel pour ce prix, la travailliste norvégienne Aase Lionæs, est elle-même mal à l’aise lors de sa remise. Dans son discours, elle reconnaît : « En donnant cette récompense, nous savions bien qu’il ne s’agissait pas de la paix, mais d’un cessez-le-feu, mais c’est cet effort pour terminer une guerre atroce que nous voulions saluer. »
Un prix Nobel contesté
En réalité, en cette fin d’année 1973, les combats se poursuivent en Indochine. Dans son éditorial de l’édition du 9 décembre 1973, Le Monde dresse ce constat navrant pour le comité Nobel : « La guerre d’Indochine… Pareil titre aurait dû être réservé aux manuels d’histoire après cette journée de janvier 1973 qui fut celle de l’accord de Paris. Mais la bataille n’a jamais cessé au Viêt-Nam et, de toute façon, le règlement ne concernait pas le Cambodge. »
En cette fin d’année, certes, l’intervention directe des États-Unis a cessé. Mais les combats entre la guérilla communiste du GPR (Groupement révolutionnaire provisoire) du Sud-Vietnam et les forces gouvernementales se poursuivent. Les clauses politiques de l’accord de Paris, qui prévoyaient la fin du régime autoritaire de Nguyen Van Thieu à Saïgon – dénomination de Hô Chi Minh jusqu’en 1976 – et de nouvelles élections libres, ne sont pas respectées. Le président sud-vietnamien accuse Hanoï de préparer une offensive militaire alors que l’aviation étasunienne continue à faire des reconnaissances en territoire nord-vietnamien.
Quant au Cambodge, il s’enfonce dans une guerre meurtrière entre le gouvernement pro-américain du général Lon Nol et les Khmers rouges prochinois de Pol Pot. Et malgré les bombardements aériens étasuniens massifs, qui leur aliènent une partie de la population, les Khmers rouges semblent prendre l’avantage en cette année 1973.
Cet accord de Paris qui a justifié la décision du comité Nobel semble donc un naufrage. D’autant plus que les négociations secrètes entre les deux hommes ont duré quatre ans et se sont accompagnées d’un durcissement et d’un élargissement du conflit.
D’autres se demandent s’il est juste de récompenser le ministre des affaires étrangères d’une puissance qui est intervenue dans le conflit vietnamien, un conflit fort éloigné de son propre territoire, pour y défendre un régime autoritaire et y mener une guerre totale parsemée de bombardements massifs de civils. Une puissance qui soutient, en Amérique latine notamment, des régimes militaires et des coups d’État comme celui survenu au Chili, un mois avant la décision d’Oslo…
D’autant que Henry Kissinger avait un rival pour la récompense du comité Nobel norvégien qui représentait l’opposé parfait de sa politique : l’archevêque brésilien Hélder Câmara, figure de la lutte non violente contre la terrible dictature militaire brésilienne en place depuis 1964. Un homme qui s’est opposé aux livraisons d’armes au Sud-Vietnam par Brasília. C’est d’ailleurs lui qui reçoit le « contre-prix » remis par les manifestants d’Oslo ce 10 décembre.
Les réactions à l’annonce de ce prix vont donc de l’ironie à l’atterrement. Le New York Times le juge « prématuré », le quotidien suédois Dagens Nyheter parle d’une « mauvaise plaisanterie ». Le Monde se demande comment, après cette « mascarade », il sera « possible à l’avenir de décerner le prix Nobel de la paix sans provoquer des haussements d’épaules ».
Lê Duc Tho, pourtant premier Asiatique à le recevoir, refuse rapidement ce prix. Le régime de Hanoï est bien conscient du caractère intenable de ce choix et ne souhaite pas, preuve que le conflit n’est pas terminé côté nord-vietnamien, mettre en scène une quelconque collaboration avec Washington.
Mais Henry Kissinger, lui, accepte avec enthousiasme et se dit « honoré » par le prix. Il ne se rend cependant pas à Oslo le 10 décembre, retenu par une réunion de l’Otan à Bruxelles, mais charge l’ambassadeur étasunien en Norvège de le recevoir. Ce dernier ne cache pas qu’il ne s’agit pas encore de paix au Vietnam, mais d’un simple « espoir », lequel méritait bien, selon le récipiendaire, cette récompense.
Maître de la « realpolitik »
Cinquante ans plus tard, presque jour pour jour, le 29 novembre 2023, Henry Kissinger s’éteint à l’âge vénérable de 100 ans. Au fil des années, l’image noire qui avait amené le monde entier à contester son prix Nobel en 1973 s’est transformée et s’est atténuée. Elle demeure encore, bien sûr, et on y reviendra, mais dans les milieux dirigeants et dans une grande partie de l’opinion, Henry Kissinger était un des « grands hommes » du XXe siècle.
Le personnage est devenu un conseiller recherché et un oracle écouté. Après son départ du secrétariat d’État en 1977 avec la défaite de Gerald Ford face à Jimmy Carter, Henry Kissinger avait créé une société de conseil, Kissinger Associates, qui a connu un franc succès auprès des multinationales du monde entier. Pour l’anecdote, même le Crédit lyonnais, au temps de son exubérance du début des années 1990, avait fait appel aux avis de celui qui, progressivement, s’imposait comme une sorte de « sage ».
À l’occasion, les grands dirigeants du monde contemporain, de Xi Jinping à Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, venaient rencontrer et écouter les leçons de ce vieux diplomate. L’administration Trump, après celle d’Obama, a cherché ses conseils.
En 2021, un ouvrage de Jérémie Gallon paru chez Gallimard, Henry Kissinger. L’Européen, grave dans le marbre cette image pour la France d’un « maître de la realpolitik », digne successeur de Metternich et de Talleyrand, sans doute critiquable mais fondamentalement fascinant par son parcours et admirable en ce qu’il aurait construit à lui seul les grands équilibres géopolitiques.
En réalité, cette image avait été soigneusement construite par Henry Kissinger pour la bonne marche de ses affaires. Il est vrai que l’homme avait tout pour séduire les dirigeants de l’époque néolibérale : un parcours de « self-made man » à l’américaine, émigré juif allemand devenu chef de la diplomatie de la première puissance militaire du monde ; un réalisme justifiant tout, fondé sur des idées philosophiques fondamentalement réactionnaires et un bilan désastreux repeint en une série de triomphes.
Cette image soigneusement construite de « sage » a été celle qui est ressortie dans les nécrologies de la grande presse qui, tout en concédant certaines erreurs, n’ont pu cacher cette fascination pour un personnage qui incarnait l’homme d’État capable et responsable.
Si l’on veut prendre conscience du contraste entre l’image de Kissinger dans les années 1970 et celle de maintenant, il suffit de lire la conclusion de la nécrologie du Monde de 2023 qui, une fois balayé son rôle dans le coup d’État chilien de 1973, salue ce « phénix de la diplomatie » qui « restera l’artisan de la détente avec l’Est ».
De son côté, le New York Times a publié une très longue biographie de l’homme qui « a conseillé douze présidents » et a été « influent jusqu’à la fin ». On y lit la vie d’un homme toujours conscient des grands enjeux, jusqu’aux plus modernes, comme l’intelligence artificielle, thème d’un ouvrage de 2019. Quelques jours plus tard, un professeur de l’université de Georgetown publiait dans ce même quotidien un éloge de « l’efficacité » de Henry Kissinger, dont il déplorait « l’oubli » par l’actuelle diplomatie étasunienne.
Cette vision de Henry Kissinger est finalement cohérente avec la pensée de ce dernier, qui a toujours vu l’histoire comme un jeu d’échecs entre de « grands hommes » capables de bâtir des équilibres. Dans son discours de réception du prix Nobel 1973, prononcé par l’ambassadeur étasunien à Oslo, le secrétaire d’État déclare que « la paix est le résultat des efforts d’hommes ayant une large vision des problèmes et faisant preuve de bonne volonté ».
Dans un texte publié dans la revue Jacobin et qui sera l’introduction d’un ouvrage à paraître en janvier chez Verso (The Good Die Young : The Verdict on Henry Kissinger), l’historien Greg Grandin rappelle que le cœur de la formation intellectuelle de Kissinger était l’ouvrage d’Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident, sur lequel il a rédigé sa thèse à Harvard en 1950. Ce livre est, depuis sa parution en 1918, une des références de la révolution conservatrice. Mais Kissinger estime que des hommes peuvent empêcher l’inévitable déclin des sociétés complexes. « Il y a deux types de réalistes, écrivait le diplomate au début des années 1960, ceux qui manipulent les faits et ceux qui les créent. » Et de conclure : « L’Occident a besoin avant tout de ces hommes capables de créer leur propre réalité. »
C’est cette ligne idéologique qui va guider l’action de Henry Kissinger dans les années 1970. Comme le souligne dans une tribune publiée dans Le Monde le 1er décembre l’historien spécialiste des États-Unis Justin Vaïsse, sa « vision de la diplomatie – un jeu de force immuable dans le temps où les seuls acteurs de l’histoire sont les grands hommes – laisse de côté la diversité des acteurs internationaux, le jeu des forces profondes, la transformation des sociétés civiles, le rôle des passions ou l’impact de la technologie ».
Cette conception de l’histoire explique que Henry Kissinger ait suivi le chemin de la droite étasunienne la plus réactionnaire avec une seule obsession, celui de la puissance des États-Unis. « De Rockefeller à Nixon, en passant par Reagan, George Bush et Donald Trump, les états de service de Kissinger traduisent les évolutions de la puissance américaine », résume Greg Grandin.
Il faut donc prendre les éloges de 2023 de ce prix Nobel 1973 pour ce qu’ils sont réellement : une part du récit néoconservateur et néolibéral qui a pris le dessus au cours du demi-siècle passé. Pour s’en convaincre, on peut lire ce passage de la biographie qu’a rédigée l’historien ultraconservateur Niall Ferguson, parue en 2015, Henry Kissinger 1923-68 : The Idealist (Penguin Press).
Face aux critiques des actions de Kissinger, Ferguson répond sans ambages : « Les arguments qui se concentrent sur les pertes de vie dans des pays stratégiquement marginaux – et il n’y a pas d’autre façon de décrire l’Argentine, le Bangladesh, le Cambodge, le Chili, Chypre ou le Timor oriental – doivent être mis à l’épreuve de cette question : qu’aurait donné, dans chaque cas, une décision alternative qui aurait affecté les relations étasuniennes avec les pays stratégiquement importants comme l’URSS ou la Chine […] ? Les États-Unis ont gagné la guerre froide et cela signifie que la charge de la preuve doit revenir aux critiques pour montrer comment des politiques différentes auraient produit de meilleurs résultats. » En d’autres termes, la fin a justifié les moyens.
Le cœur de l’action du diplomate Kissinger qui a provoqué tant d’éloges à l’annonce de son décès doit donc d’abord être lu comme une volonté absolue de défendre la puissance étasunienne au moment où cette dernière était en danger. Henry Kissinger a dirigé la diplomatie étasunienne d’abord en tant que conseiller spécial de Richard Nixon jusqu’en septembre 1973, puis dans la lumière du secrétariat d’État.
Maintenir l’hégémonie étasunienne
Car cette période 1969-77 est d’abord celle d’une crise profonde de l’hégémonie étasunienne. Les échecs de la guerre du Vietnam dans les années 1960 s’ajoutent à une crise économique qui devient évidente au début des années 1970 et à une contestation interne forte du modèle étasunien. La domination étasunienne semble contestée partout, sur le terrain militaire par la résistance vietnamienne, comme sur les marchés mondiaux par la concurrence japonaise ou dans le domaine de la monnaie, où le dollar ne peut plus assumer son rang de référence mondiale.
L’époque est celle de la crise sécuritaire, culturelle et politique du mode de vie étasunien, au moment où le bloc de l’Est, lui, apparaît comme plutôt solide. C’est bien dans ce contexte qu’il faut juger et comprendre la politique de Henry Kissinger.
Loin d’être un « constructeur de la paix », Henry Kissinger est d’abord et avant tout le défenseur d’un impérialisme américain en danger. En cela, sa priorité est de tenir les fronts. Il fait le dos rond dans le rapport direct avec l’URSS pour que cette dernière ne profite pas de la faiblesse étasunienne. C’est ici le sens de la politique de « détente » qui conduit en 1973 à un traité sur le nucléaire militaire et à l’ouverture de la conférence d’Helsinki. Mais cette « pause » dans la guerre froide, qui sera dénoncée et balayée par l’administration Reagan à partir de 1981, est bien davantage un repli stratégique qu’une politique de paix.
Au reste, c’est l’évidence, même lorsque l’on observe le reste de la politique Kissinger. Partout, le diplomate va revenir à « l’endiguement » de la doctrine Truman pour limiter l’affaiblissement étasunien. En cela, Kissinger se montre un soldat impitoyable de l’impérialisme étasunien, laissant sans vergogne la défense du « monde libre » à des régimes sanguinaires et dictatoriaux. Derrière les discours sur la défense de la liberté et de la paix, la réalité est tout autre, c’est celle d’une politique de puissance et de domination dans un contexte de recul.
L’éloge de la realpolitik de Kissinger sert donc avant tout la justification de massacres au nom du maintien de l’influence étasunienne et de la défense de cette puissance alors si contestée. Le cas du Chili, documenté par une enquête du Sénat étasunien dès 1975, est évidemment connu et, à raison, mis en avant, mais, en réalité, la liste est bien plus longue.
Le « sage » de la diplomatie a ainsi soutenu en 1971 le régime de l’allié pakistanais dans la répression inouïe du séparatisme bangladais. Sans succès, puisque le Bengladesh finira par arracher son indépendance avec l’appui indien, mais le bilan est très lourd : on estime le nombre de morts à près de trois millions.
Pour la même raison, Kissinger va soutenir l’Indonésie, puissance anticommuniste centrale en Asie du Sud-Est, dans son occupation violente du Timor oriental, après le retrait portugais à partir de la fin de 1975. Certains estimeront à un tiers de la population est-timoraise, soit près de 200 000 personnes, le bilan de l’invasion illégale de ce territoire. Autant de morts que Niall Ferguson justifie au nom de la « liberté », mais qui ont surtout été sacrifiés sur l’autel de l’influence des États-Unis.
Et ce ne sont là que quelques exemples. L’influence des manœuvres de la CIA et des liens de celle-ci avec l’extrême droite pour déstabiliser les démocraties en Europe avec le réseau Gladio ou en Amérique latine avec le plan Condor, n’a pas pu se déployer sans l’appui de Kissinger. Rappelons qu’outre la sanglante « stratégie de la tension » en Italie, ces pratiques ont mené l’Argentine en 1976, après le Chili et l’Uruguay en 1973, à basculer dans des dictatures militaires.
Kissinger a donc d’abord tenu le front où il le pouvait. Là où il ne le pouvait plus, comme au Vietnam, il a tenté de limiter la casse. Et c’est bien la raison pour laquelle les négociations avec Hanoï ont duré si longtemps. En intervenant à partir de 1970 au Cambodge, l’administration Nixon a apporté la preuve qu’elle n’entendait se retirer de la région que lorsque la situation deviendrait intenable, notamment au regard de l’opinion publique et de la situation économique. Mais entre 1969 et 1973, l’effort américain s’est intensifié.
Ce qu’a fait Kissinger, c’est donc de tenter une sortie acceptable de cette guerre. C’est pourquoi il a été difficile pour Washington de reconnaître pendant longtemps sa défaite et de tenter de tenir au moins le Cambodge et le Sud-Vietnam aussi longtemps que possible. Mais cette stratégie a été un désastre complet : en 1975, Saïgon tombe aux mains du Nord-Vietnam et Phnom Penh aux mains des Khmers rouges.
C’est aussi dans ce contexte qu’il faut replacer le grand « fait d’armes » de Henry Kissinger, la normalisation en 1972 des relations avec une Chine de Mao qui n’en a pas tout à fait fini avec la répression de la Révolution culturelle.
Kissinger et Nixon ont théorisé cette alliance dans un schéma plus grand, celui d’un monde polycentrique dont les États-Unis resteraient le centre, mais sous une forme plus souple et plus informelle. L’idée était de faire de Washington une sorte d’arbitre universel en haut d’une hiérarchie d’États qui n’aurait pas à gérer l’ensemble des problèmes régionaux.
C’est, pour eux, le moyen de maintenir la puissance étasunienne dans un contexte où la simple gestion centralisée devient trop coûteuse et impossible. C’est aussi dans ce cadre qu’il faut comprendre les propositions de réorganisation du bloc de l’Ouest émises par Kissinger fin 1973, où il demande aux Européens de prendre en charge une plus grande partie de leur défense.
Un bilan désastreux
Concernant la Chine, sa stratégie était sans doute plus prosaïque et, encore une fois, directement liée à l’obsession du maintien de la puissance étasunienne. Il s’agissait, bien sûr, d’accroître les dissensions au sein du bloc communiste. À l’époque, la rupture entre Pékin et Moscou est déjà ancienne, mais en Indochine, les deux frères ennemis ont pu jouer la carte anti-étasunienne. Il s’agissait d’en finir avec cette solidarité et de réaliser une forme d’« alliance de revers ».
La manœuvre peut être jugée digne de Metternich ou de Talleyrand, mais son efficacité à court et à moyen terme est contestable. Au Cambodge, ce sont ainsi les Khmers rouges soutenus par Pékin qui prennent le pouvoir en écartant tant les Vietnamiens pro-soviétiques qu’en écrasant avec violence le régime républicain pro-étasunien. Ils mènent une politique génocidaire qui fera 1,7 million de morts. Lorsque les Vietnamiens interviendront pour renverser ce régime en 1979, la Chine répondra en attaquant le Vietnam, sous le regard au mieux indifférent, au pire complice de Washington. Kissinger était alors parti du secrétariat d’État, mais son héritage restait présent.
En parallèle, le rapprochement avec la Chine laisse une situation ambiguë dont les limites réapparaissent parfaitement aujourd’hui. Washington abandonne en apparence le régime de Taïwan, jusqu’ici seule « Chine » reconnue par les États-Unis au profit de Pékin. Formellement, il accepte donc l’idée que la Chine populaire est la seule « Chine », et donc l’appartenance officielle de l’île à la République populaire. Mais Kissinger n’abandonne bien sûr pas le soutien concret à Taipei, qui est une pièce essentielle du dispositif étasunien dans l’Asie-Pacifique.
À l’époque, Pékin s’en contente : la Chine populaire entre de plain-pied dans le concert des nations, gagne une place de membre permanente au Conseil de sécurité de l’ONU, peut regarder son rival soviétique à égalité avec une sorte de soutien implicite de l’Occident, ce que prouvera la guerre contre Hanoï en 1979. Mais, à long terme, cette situation bancale était explosive.
La doctrine Kissinger sur la Chine a aussi évité à Pékin le destin soviétique. Lorsque Ronald Reagan abandonnera dans les années 1980 la politique de détente de Kissinger pour relancer la course aux armements, Pékin peut laisser passer l’orage. Pas besoin de se lancer dans une course qui achèvera le régime soviétique. Une fois réprimée la révolte de Tian’anmen, le régime s’ouvre aux investissements occidentaux, en particulier étasuniens, pour devenir l’atelier du monde occidental, et la deuxième puissance économique du monde, face aux États-Unis.
Un demi-siècle plus tard, le bricolage diplomatique de Kissinger est une bombe à retardement et un nouveau défi pour la puissance étasunienne. La Chine, devenue le principal rival de Washington pour la domination mondiale, n’accepte évidemment plus le statu quo sur Taïwan et exige que la reconnaissance formelle de sa souveraineté sur l’île devienne réalité. Une option inacceptable pour Washington, tant économiquement (Taïwan est le principal producteur de semi-conducteurs) que militairement. L’héritage de Kissinger est, l’année de son décès, un monde sous haute tension. Pour un prix Nobel de la paix, « artisan de la détente », on aurait pu espérer un meilleur bilan.
Au reste, la capacité d’analyse de Henry Kissinger a largement été surestimée. C’est ce que résume Justin Vaïsse dans la tribune déjà citée. Citant les cas du Cambodge, du Bangladesh et du Chili, l’historien parle de « fautes autant que de crimes ». La légende ne tient pas non plus devant les prises de position plus tardives de celui qui aimait se présenter en « oracle » ou en « sage » : soutien à la guerre en Irak en 2003, rejet puis défense de l’accord sur le nucléaire iranien ou de l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan, manque de lucidité face à la Russie de Vladimir Poutine. Tout cela ressemble plus à des prises de position au mieux incertaines, au pire intéressées, qu’à des analyses pertinentes.
Ce prix Nobel de la paix est donc encore aujourd’hui une tache indélébile dans l’histoire de cette récompense. Henry Kissinger n’a jamais eu la paix en tête, mais il a toujours eu la domination de son pays d’adoption. Il a placé cette domination avant toute autre considération morale, avant le respect de la démocratie ou des droits de l’homme.
Ceux qui saluent cette realpolitik, comme Niall Ferguson, sont avant tout les défenseurs de cette domination qui deviendra unique en 1989, puis s’affaiblit à nouveau depuis quelques années. Finalement, la seule justification de son prix Nobel, c’est que cette récompense marque bel et bien l’entrée du monde dans le cynisme néolibéral qui a marqué le demi-siècle passé.