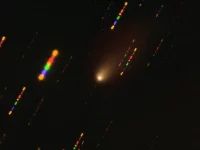Poutine, la guerre et le crime

GENERATION 2 Et si nous nous trompions ? Et si un terrible angle mort ne cessait de grandir dans les analyses faites en Occident pour comprendre les raisons de la guerre d’invasion de l’Ukraine, menée depuis le 24 février par le président russe Vladimir Poutine ? Très vite, un consensus s’est imposé chez les spécialistes de la Russie, les experts en politique internationale et les principaux acteurs politiques nord-américains et européens. Les mots sont plus ou moins vifs mais l’analyse ne varie guère.
Pareil consensus mérite d’être souligné : il tranche avec les désaccords radicaux qui ont accompagné tous les conflits de ces 30 dernières années. À l’inverse, la guerre contre l’Ukraine, le plus grand affrontement militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, donne lieu à une lecture unique. La Russie renouerait avec un projet impérial visant à reconstituer sous la férule de Moscou l’unité du « monde russe », voire des peuples slaves. Il s’agirait de punir les « Petits-Russes » (nom donné aux Ukrainiens à l’époque tsariste), de briser leur envie d’Europe et d’indépendance et de restaurer, si ce n’est le vieil empire, à tout le moins les sphères d’influence du Kremlin.
Ce néo-impérialisme, qui emprunte tout à la fois à l’URSS, à Staline, à la Grande Guerre patriotique (appellation donnée par les Russes à la Seconde Guerre mondiale), à l’empire tsariste et au panslavisme, serait la clé de compréhension exclusive d’une Russie soudainement rattrapée par ses démons. Et comme lors des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, le renforcement et l’élargissement de l’Empire permettraient de redessiner l’ordre international global, autre but de guerre affiché par le pouvoir russe désormais résolu à rompre avec l’Europe et les États-Unis.
L’Occident fait ainsi mine de découvrir ce qui serait le vaste projet géopolitique d’un État russe prêt pour cela à déclencher une guerre conventionnelle typique du XXe siècle au cœur de l’Europe du XXIe siècle. Une guerre coloniale, une guerre impérialiste… Cela à l’heure de la mondialisation, d’un droit international affermi, du droit à l’autodétermination des peuples, de la naissance de nouveaux États (le dernier est le Sud-Soudan en 2011).
Les trois points faibles d’une analyse univoque
Trois faits viennent écorner cette analyse univoque. Le premier est que la guerre contre l’Ukraine a été déclenchée dès 2014 et non en février 2022, avec l’invasion puis l’annexion de la Crimée et l’extension du conflit, aussitôt organisée par Moscou, dans les territoires dits « séparatistes » du Donbass, dans l’est du pays. Ne nous y trompons pas, il s’agissait bien d’une vraie guerre : en huit ans, elle a fait plus de 14 000 morts et provoqué 1,6 million de déplacés et réfugiés.
Marraines des accords de Minsk, dont l’échec est patent, France et Allemagne n’ont alors jamais évoqué un néo-impérialisme russe et encore moins un projet géopolitique d’ampleur. Les deux leaders européens, comme bon nombre d’experts, y ont vu la résurgence d’un vieux conflit local (les russophones du Donbass), l’obsession revancharde de Poutine envers l’Ukraine et un intérêt de sécurité immédiat, le port de Sébastopol, siège de la flotte militaire russe de la mer Noire.
Le deuxième élément qui fragilise cette lecture unique est que l’entrée en guerre totale, le 24 février 2022, n’est pas une décision du régime russe, même si elle l’engage désormais. Nous savons maintenant qu’il s’agit d’un choix solitaire de Vladimir Poutine, après consultation d’une petite poignée de proches, visiteurs du soir et de ses deux fidèles Nikolaï Patrouchev, qui préside le Conseil de sécurité russe, et Sergueï Choïgou, ministre de la défense.
Comment pourrait-il en être autrement, dira-t-on, dans un régime autoritaire ayant viré à la dictature ? Le sommet de l’État russe n’est pourtant pas un monolithe mais un agrégat de forces aux intérêts divers et aux projets différents. Les déclarations alarmistes de la gouverneure de la Banque centrale russe, Elvira Nabioullina, le départ à l’étranger d’une personnalité comme Anatoli Tchoubaïs, les remarques critiques de quelques oligarques ou politiques vite retournés au silence ne sont certes que de très rares symptômes de débats, et d’oppositions, dans les différents cercles du pouvoir russe. Mais est-on véritablement certain de la solidité du consensus qui règnerait aujourd’hui au sein du régime ? Cette guerre néo-impériale est-elle bien la sienne ?
Le troisième élément qui fragilise cette analyse d’un nouvel impérialisme russe est qu’elle prend pour argent comptant ce que disent sur tous les tons Vladimir Poutine et ses médias d’État, transformés en machine à propagande depuis au moins 2012. L’article de juillet 2021 du président russe, présenté comme un « essai historique » sur la gémellité des peuples ukrainien et russe, et son discours du 24 février (« dénazifier, démilitariser » l’Ukraine et « sauver du génocide nos frères russophones ») ne sont que des reprises de ce que n’ont cessé d’asséner depuis des années les principales chaînes de télévision et le président lui-même.
Doit-on prendre au sérieux Vladimir Poutine lorsqu’il fait de l’« élimination de la saleté nazie de Kiev » un but de guerre ? Lorsque son « essai historique » – « du n’importe quoi, du jaja » imbuvable, selon l’historien français Nicolas Werth, grand spécialiste de la Russie – pioche dans des auteurs panslaves et eurasiens du XIXe siècle, rajoute quelques ingrédients de la Grande Guerre patriotique (qu’il s’agirait de « terminer », selon ses propagandistes !) et touille le tout dans une vieille marmite ? Les responsables importants du régime russe peuvent-ils croire à de telles fariboles que tout – l’histoire longue et l’évolution de l’Ukraine depuis son indépendance en 1991 – vient démentir ? Et Poutine y croit-il lui-même ?
Deux éléments systématiquement ignorés
Il faut donc chercher ailleurs, intégrer des éléments complémentaires mais décisifs pour mieux comprendre les vraies raisons de la guerre et les possibilités de sortie du conflit. Il est étonnant de constater que les meilleurs analystes, historiens, experts en relations internationales et la totalité des grands acteurs politiques ont laissé de côté deux éléments pourtant déterminants. Le premier est la nature du régime Poutine, qui peut aisément être qualifié de système criminel. Le second est une autre « guerre », menée de longue date contre la société russe, écrasée par une répression féroce.
Comment ignorer de tels éléments qui structurent et cadenassent la Russie depuis vingt-deux ans ? Comment les négliger quand la question de la succession de Vladimir Poutine, 70 ans, se trouve posée au sein des élites russes ? Quand les rumeurs sur son état de santé ne cessent de prospérer ? Et surtout quand, à travers cette succession, vont se mettre en place les conditions d’une perpétuation – ou non – d’un système criminel construit depuis 30 ans et qui s’est emparé, avec l’accession à la présidence de son chef en 2000, des principaux rouages de l’État russe ?
Prenons-les en compte et la guerre d’Ukraine, certes de facture néo-impériale, impérialiste, coloniale, s’éclaire différemment. Elle fait surgir d’autres enjeux. Ceux-là sont exclusivement russes et concernent d’abord la pérennisation du système construit au Kremlin. Or c’est une faille constante des chancelleries, ambassadeurs et analystes de politique internationale : l’incapacité de penser ce que produit le crime lorsqu’il parvient à prendre le contrôle d’un État et fait son entrée en politique.
J’ai pu me rendre compte que le monde des assassins communiquait, par mille portes tournantes, avec les salons feutrés et insoupçonnables où le pouvoir s’abrite.
Depuis un quart de siècle, les dirigeants européens se sont toujours refusés à intégrer dans leurs relations avec la Russie la dimension proprement criminelle et mafieuse du régime Poutine. La corruption, les assassinats, les emprisonnements, les enrichissements phénoménaux, le pillage financier du pays, ont toujours été considérés comme des effets collatéraux et marginaux provoqués par un régime autoritaire vivant de la rente des matières premières. Bien souvent, l’absence de preuves irréfutables ou d’enquêtes judiciaires crédibles a encouragé cet aveuglement. Ce fut donc politique as usual…
Il est un homme qui a pourtant travaillé sur la façon dont le crime peut s’emparer du champ politique et le reconfigurer. Roberto Scarpinato a été l’un des plus célèbres procureurs antimafia en Sicile. Il fut un proche de Giovanni Falcone et de Paolo Borsellino, tous deux assassinés par Cosa nostra en 1992. Et il a instruit des procès majeurs, dont le procès Andreotti, dévoilant les alliances entre les groupes criminels et la classe politique italienne. Ses enquêtes ont détaillé comment la mafia, loin de seulement corrompre ou assassiner, savait aussi gérer des pans entiers de l’État et mettre la société sous contrôle.
En 2008, Roberto Scarpinato publie un livre, Le Retour du prince. Pouvoir et criminalité. Dans son avant-propos, il explique vouloir décrire « les démons de mon pays, ceux qui ont ensanglanté sa longue histoire et ceux qui, pillant ses ressources, sont en train de le condamner à un inexorable déclin ».
Dans une description d’une Italie saisie par le crime, mais qui vaut au mot près pour une Russie confisquée par le régime Poutine, Scarpinato écrit ceci : « J’ai pu me rendre compte que le monde des assassins communiquait, par mille portes tournantes, avec les salons feutrés et insoupçonnables où le pouvoir s’abrite. J’ai dû prendre acte du fait que ces gens ne parlaient pas forcément d’une voix criarde et ne portaient pas toujours les stigmates du peuple. Qu’au contraire, les pires d’entre eux avaient fréquenté les mêmes écoles que nous. On pouvait les croiser dans les milieux les plus aisés et, parfois, les voir à l’église se battre la poitrine aux côtés de ceux qu’ils avaient déjà condamnés à mort. »
En quoi les intérêts d’un système criminel redéfinissent-ils totalement une politique ? En février 2000, lors d’un déplacement à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, alors président par intérim, le ministre français des affaires étrangères, Hubert Védrine, écartait d’un soupir condescendant ce questionnement fait par quelques correspondants français qu’il rencontrait. « Vous voulez quoi ? Faire de la Russie un gros Danemark ? Cela ne marche pas comme ça », rétorquait-il. Pendant que l’armée russe finissait de raser la capitale tchétchène, Grozny, le ministre expliquait publiquement que la conjoncture ne devait pas affecter la relation à long terme, « stratégique », avec Moscou.
Presque vingt ans plus tard, en août 2019, Emmanuel Macron poursuivra dans la même veine en recevant Vladimir Poutine dans sa résidence de vacances du fort de Brégançon. « La Russie est une grande puissance des Lumières. Elle a sa place dans l’Europe des valeurs auxquelles nous croyons », assurait-il, confondant un pays et son représentant et refusant d’intégrer la nature toute particulière du régime Poutine.
« Comprendre où et comment se déplaçait le pouvoir réel du pays, c’était comprendre où et comment il fallait se déplacer à son tour pour éviter d’être pris au dépourvu », écrit encore Scarpinato. L’Occident n’a jamais voulu comprendre, s’en tenant à une diplomatie classique. L’échec spectaculaire de Barack Obama et de sa politique de « reset » lancée en 2009 pour améliorer les relations avec la Russie en est une illustration.
Trente années d’une longue marche sanglante
Or, dès février 2000, la nature du régime Poutine était déjà établie par de nombreux observateurs russes. Le seul débat pertinent pouvait être celui-ci : s’agissait-il de l’accession au pouvoir d’un groupe criminel ou de la violente reprise en mains du pays par l’« État profond », celui des services de sécurité hérités du KGB, dont Poutine était un agent ? Ce débat a occupé une bonne partie des années 2000, jusqu’à ce que la liste des morts s’allonge de manière impressionnante et que les guerres se multiplient.
Plusieurs éléments pouvaient, dès le début, alerter les chancelleries sur le fait qu’avec Poutine, le crime allait s’emparer du pouvoir. Depuis, d’innombrables enquêtes journalistiques, livres de chercheurs, d’opposants russes et rapports de services étrangers sont venus confirmer cette situation inédite : un système criminel s’est installé à la tête d’un État, et pas n’importe lequel puisqu’il possède le premier arsenal nucléaire au monde et un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce système allait bien sûr « produire » de la politique et des idéologies pour habiller le tout. Mais elles devaient converger pour d’abord accroître l’emprise du crime sur l’État et la société russe.
Le premier élément est constitué des années pétersbourgeoises (1991-1996) de Vladimir Poutine. À la tête du comité des relations extérieures de la ville, un système de corruption est mis en place, fait de commissions occultes, de racket sur les activités économiques de la ville et de son port, de ventes frauduleuses de licences d’exportation. Tout cela a été abondamment documenté. Dès 1992, un rapport de la députée Marina Salié et d’élus de Saint-Pétersbourg dévoile le système de fraudes. Des documents officiels montrent l’implication directe de Vladimir Poutine, alors adjoint du maire « démocrate » Anatoli Sobtchak, et demandent son limogeage.
Par la suite, plusieurs hommes d’affaires témoigneront de ce système, tout comme des enquêteurs russes spécialisés dans la criminalité économique. Le plus célèbre est Andrei Zykov. En 1999, il faisait partie d’une brigade d’enquêteurs qui s’est cassé les dents sur une tentaculaire affaire de détournements de fonds publics à Saint-Pétersbourg impliquant Vladimir Poutine. L’enquête a été classée sans suite en 2000. Zykov a été contraint de prendre une retraite anticipée l’année suivante. « Sous Poutine, la corruption est devenue systémique,expliquait-il à Mediapart en 2017. Ce modèle de corruption est né dans les années 1990 à Saint-Pétersbourg. Encore aujourd’hui, autour de lui, on retrouve les mêmes personnes et les mêmes liens. »
Remarqué pour son efficacité, Poutine est propulsé en juillet 1998 à la tête du FSB (héritier du KGB).
En 1996, quand Sobtchak perd la mairie de Saint-Pétersbourg, le système Poutine aurait pu s’écrouler. Il va au contraire prospérer, cette fois au cœur du pouvoir. Pavel Borodine appelle en effet Vladimir Poutine à ses côtés pour gérer à Moscou ce qui va devenir le « scandale Mabetex », du nom d’une compagnie albano-kosovare basée en Suisse. Surnommé l’« intendant du Kremlin », Borodine est chargé de la direction des affaires présidentielles. Et la rénovation totale des bâtiments du Kremlin, entre autres, par la société Mabetex, va donner lieu à des détournements massifs, estimés à plus de 60 millions de dollars, en faveur de la famille Eltsine.
L’enquête démarrée en Suisse par la procureure Carla Del Ponte, poursuivie par le juge Daniel Devaud, trouve un relais à Moscou en la personne du procureur général Iouri Skouratov. Ses investigations sèment la panique au Kremlin alors que le règne Eltsine s’achève. Remarqué pour son efficacité aux côtés de Borodine, Poutine est propulsé en juillet 1998 à la tête du FSB (héritier du KGB) pour éteindre l’incendie. Ce sera fait en quelques mois. En mars 1999, les télévisions diffusent des extraits d’une vidéo d’un homme présenté comme étant Skouratov, nu dans une chambre avec deux call-girls. Si le scandale est énorme, les interrogations sur ce qui apparaît comme un classique « kompromat » fabriqué par les services se multiplient.
En avril, Vladimir Poutine fait basculer l’affaire. Le chef du FSB explique aux journalistes avoir fait authentifier la vidéo et qu’il s’agit bien des images du procureur général. « Il doit démissionner », conclut-il. Le limogeage interviendra quelques semaines plus tard. Le volet russe de l’enquête Mabetex est enterré, les investigations suisses piétinent et Poutine, une fois président, nommera Pavel Borodine secrétaire de l’Union Russie-Biélorussie, un poste qu’il occupera pendant dix ans. Cette élimination de Skouratov est un événement clé qui convaincra la famille Eltsine de faire de Vladimir Poutine son candidat à la présidence. Une fois élu, son premier acte sera d’ailleurs de signer un décret accordant une immunité totale à Boris Eltsine et à ses proches. À une condition : ne plus intervenir dans le champ politique.
Vague d’attentats à Moscou
Ces principes vont se généraliser les années suivantes à tout l’appareil d’État et au secteur économique. L’opposant Boris Nemtsov, assassiné par balles à deux pas du Kremlin en 2015, avait ainsi décrit dans son blog le processus à l’œuvre : « Quel est le principe central de la verticale du pouvoir créée par Poutine ? On peut voler, prendre des pots-de-vin, tuer des gens dans des accidents de circulation. Ce n’est pas un problème du moment que l’on reste obéissant et loyal au pouvoir. » Dès 2007, Elena Panfilova, alors directrice de l’antenne russe de Transparency International, le notait déjà : « Désormais, il est impossible de trouver une institution ou un secteur de l’économie qui ne soit pas affecté par une corruption devenue systémique. »
Un dernier élément, et il est le plus terrible, pouvait alerter les chancelleries dès l’année 2000 : le soupçon – la certitude, pour beaucoup d’observateurs – d’un recours au terrorisme d’État. À l’été 1999, Vladimir Poutine est nommé premier ministre ; la « famille » l’a choisi pour succéder à Eltsine lors de l’élection présidentielle de mars 2000. Il s’agit de faire connaître ce personnage inconnu, a priori falot et mauvais orateur. L’opération deuxième guerre de Tchétchénie est lancée dès la fin août, sur fond de manipulations par les services et l’oligarque Boris Berezovsky. Mais, traumatisée par la première de guerre de Tchétchénie (1994-1996), la société russe n’est pas prête à un nouveau conflit. Des massacres répétés de civils vont la faire basculer en quelques jours.
Le 4 septembre, une voiture piégée explose à Bouïnaksk (Daghestan), au pied d’un immeuble abritant des militaires russes et leurs familles : 64 morts. Le 8 septembre, une explosion détruit la moitié d’un immeuble de huit étages à Moscou : 109 morts. Le 13 septembre, un autre immeuble est totalement détruit à Moscou : 119 morts. Le 16 septembre, nouvelle explosion dans un immeuble de Volgodonsk, dans le sud du pays : 17 morts. Jamais la Russie n’avait connu pareille vague d’attentats.
Le 22 septembre, à Riazan, à 180 kilomètres au sud-est de Moscou, des agents de la police et du FSB local, alertés par un habitant, découvrent des sacs d’explosifs reliés à un détonateur dans les caves d’un immeuble. Très vite, deux agents du FSB, ceux qui ont apporté l’explosif, sont arrêtés. Alors que le scandale gronde, le successeur de Vladimir Poutine à la tête du FSB, son ami Nikolaï Patrouchev, qui préside aujourd’hui le Conseil de sécurité russe, annonce qu’il ne s’agissait là que d’un « exercice » de ses services pour tester l’état de préparation du pays…
Les incohérences de ses explications, démenties par de nombreuses autorités locales, les insuffisances de l’enquête judiciaire, qui a échoué à identifier les commanditaires de l’attentat-« exercice », ne font que renforcer les soupçons sur les responsabilités du pouvoir dans cette vague de terreur. Une commission d’enquête indépendante est créée par des responsables politiques et des militants des droits humains. Deux de ses membres, des députés d’opposition à la Douma, sont assassinés : en 2003, Iouri Chtchekotchikhine, également journaliste à Novaïa Gazeta, meurt empoisonné ; la même année, Sergueï Iouchenkov est tué de trois balles tirées dans le dos. Les enquêtes n’ont jamais abouti.
La guerre, la terreur, les assassinats et les emprisonnements, la corruption, la privatisation des services de sécurité et de la justice mis au service du crime : au tournant des années 2000, tout était déjà sous nos yeux qui permettait de qualifier le nouveau régime russe de système mafieux ou criminel. Bien sûr, aucun de ces crimes ne peut être attribué à Vladimir Poutine. Présumé innocent… même quand il est établi qu’une équipe spéciale du FSB a tenté en août 2020 d’empoisonner mortellement l’opposant Alexeï Navalny, aujourd’hui emprisonné dans un camp à régime sévère pour exécuter une peine de neuf ans.
Des victimes qui représentent toutes les facettes de la société russe
Les opinions occidentales n’auront donc retenu que quelques noms de victimes, au milieu de faits confus noyés dans des enquêtes suspectes ou jamais abouties et de rares procès incompréhensibles. Mais si l’on veut bien se retourner sur ces trente dernières années, alors la liste des assassinés, emprisonnés, tabassés, empoisonnés (sans parler des exilés) est interminable.
Toutes et tous, à un moment ou à un autre, se sont opposés à Vladimir Poutine ou au système mafieux construit à Saint-Pétersbourg et systématisé au Kremlin. Elles et ils sont des responsables politiques, économiques, des fonctionnaires, des avocats, journalistes, syndicalistes, militants écologistes, artistes, scientifiques.
Sans livrer un inventaire exhaustif, rappelons quelques faits qui donnent une idée de l’intensité et de la continuité de la violence exercée sur l’ensemble de la société russe.
Depuis le début de la guerre contre l’Ukraine, une nouvelle vague d’assassinats semble viser cette fois les milieux économiques. En quelques mois, neuf oligarques ou hauts dirigeants de grandes entreprises, le plus souvent de groupes énergétiques, ont trouvé la mort dans des conditions plus que suspectes, les enquêteurs concluant chaque fois à un suicide. Le dernier en date, le 1er septembre, est Ravil Maganov, puissant patron du premier groupe privé pétrolier russe Lukoil : tombé d’une fenêtre d’un sixième étage, selon la première annonce de son décès, puis mort d’une « longue maladie », selon un communiqué de Lukoil, et enfin « suicide », selon les enquêteurs.
Lukoil avait appelé à une fin rapide de la guerre en Ukraine, qualifiée de « tragédie ». Elle n’en est certainement pas une pour le système Poutine. Comme ce fut le cas avec la Tchétchénie puis la Géorgie en 2008, la guerre est un « accélérateur ». Elle permet, au nom des intérêts supérieurs du pays, d’anéantir les droits civiques et les libertés publiques et de mieux écraser la société. Construit tout au long des années 2000, le régime autoritaire russe a muté depuis 2012-2014 en une dictature d’un groupe criminel qui n’a plus besoin de masquer son visage.
Car, comme le souligne l’enquêteur financier Andreï Zykov, le plus frappant est la stabilité de ce groupe et des membres qui le composent. Ils sont une trentaine, amis d’enfance, collègues du KGB en Allemagne de l’Est et surtout collaborateurs à la mairie de Saint-Pétersbourg, à s’être emparés de la Russie, de son pouvoir politique et d’une bonne part de son économie. Poutine est le chef de la « famille ». Tous se sont enrichis de manière fabuleuse. Personne n’a quitté la « famille » même si certains peuvent connaître des moments d’éloignement, voire de disgrâce ; personne n’a parlé.
Citons juste quelques exemples.
Comment organiser la génération 2 du système Poutine ?
Tels sont les principaux personnages de la « famille », renforcée par quelques anciens du KGB. Le clan ne s’est pas élargi, même si d’autres personnages importants pilotent la politique russe. Sergueï Kirienko, chef adjoint de l’administration présidentielle et éphémère premier ministre en 1998 ; Sergueï Choïgou, ministre sans interruption depuis 1994, chargé de la défense depuis dix ans ; Sergueï Lavrov, ministre des affaires étrangères depuis dix-huit ans… Eux aussi pèsent et se sont enrichis mais ils n’ont pas rejoint ce premier cercle dont ils ne sont que les serviteurs.
Tous ces hommes ont entre soixante-deux et soixante-quinze ans ; Poutine est âgé de soixante-dix ans. Et la question centrale qui leur est posée est moins le supposé avenir impérial de la Russie que celles de l’immunité et de la transmission. Comment se garantir à terme une immunité judiciaire semblable à celle qui a protégé la famille Eltsine ? Comment transmettre aux enfants les fortunes colossales constituées et les postes de pouvoir ? Bref, comment organiser la génération 2 du système Poutine ?
La distribution des places a déjà commencé. Le fils de Nikolaï Patrouchev, Dmitri, est ministre de l’agriculture depuis 2018. Son autre fils, diplômé de l’académie du FSB, est banquier, après avoir travaillé avec Igor Setchine à Rosneft. Ce n’est qu’un exemple d’une très longue liste d’enfants de la « famille », souvent formés dans les meilleures écoles occidentales puis placés au cœur des grands groupes ou de l’État. Certains sont à leur tour frappés par les sanctions européennes ou états-uniennes, accusés de blanchiment d’argent et diverses manipulations financières.
Cet enjeu de la « génération 2 » n’est jamais évoqué mais il est déterminant. Et la guerre en Ukraine, entreprise certes risquée, est une partie de la solution. Car sa contrepartie, l’installation d’une dictature en Russie, interdit toute interrogation publique, tout débat sur cette transmission à bas bruit qui s’est engagée au cours des dernières années.
Lev Goudkov est l’un des plus fins observateurs du pouvoir et de la société russe. Ce sociologue a été, de 2006 à 2021, le directeur scientifique du Centre Levada, seul organisme indépendant d’études et de sondages en Russie. Dans un récent entretien avec le média indépendant russe Meduza (interdit dans le pays et installé en Lituanie), il explique comment la guerre en Ukraine a permis le contrôle total de l’espace public russe.
« L’important ici, dit-il, c’est la censure totale qui s’exerce depuis fin février-mars. La population est ainsi laissée à elle-même face à une propagande agressive, incessante, qui sévit sur toutes les chaînes, même les chaînes religieuses. Toute propagande repose sur le fait qu’elle plonge les personnes dans un état de désarroi et de terreur, annihile leur capacité d’attention et de raisonnement critique. Vous créez chez elles un état de désarroi, de cynisme, d’apathie et donc d’adhésion à la force. »
Propagande et idéologies Potemkine
Vladimir Poutine n’est ni un intellectuel ni même un politique portant une vision large pour son pays. Il n’a jamais écrit de livres, pas plus rédigé de programme susceptible de parler à la société russe. Lieutenant-colonel du KGB en 1991, son cadre mental, sa représentation du pouvoir et du monde se sont forgés dans les services secrets, qu’il a rejoints en 1975 au sortir d’études de droit à Leningrad.
Tania Rakhmanova documente parfaitement dans son livre Enquête sur l’empire Poutine les conditions de son accession à la présidence russe. Pas de campagne, pas de meetings, pas de discours mais une propagande télévisuelle déchaînée des médias d’État qui le montrent en action. Chef de guerre en Tchétchénie, jeune, sportif, froid et autoritaire : tout le contraire d’un Eltsine chaotique, âgé, malade et alcoolique. « Notre faute n’est pas seulement d’avoir cru en Poutine, c’est aussi de l’avoir fabriqué »,explique dans ce livre Ksenia Ponomareva, alors directrice de l’information de la chaîne de télévision ORT et membre de l’équipe de campagne.
Durant les premières années de pouvoir, un contrat tacite est passé avec la société russe, qui se résume en deux mots : stabilité et développement. La stabilité est la construction d’un État de plus en plus autoritaire (la « verticale du pouvoir », le concept de « démocratie souveraine », le contrôle des élections). Le développement n’est pas celui de l’économie mais consiste en une amélioration importante du niveau de vie des Russes grâce à la rente des matières premières. Cette amélioration, même si elle se paie d’une quasi-disparition des droits politiques, vaut au régime une réelle popularité.
Il n’est nullement question durant ces années (les deux premiers mandats présidentiels, 2000-2008) de confrontation avec un Occident haï, d’exaltation patriotique, de construction d’un projet néo-impérial. Le partenariat Otan-Russie est maintenu, les projets économiques avec l’Europe et les États-Unis se multiplient et la Russie de Poutine s’insère dans une économie mondiale dominée par ses ennemis d’aujourd’hui.
En 2008, quand Poutine transmet la présidence à sa doublure Dmitri Medvedev, ce dernier affiche un projet encore plus libéral et plus pro-occidental. Les chancelleries européennes et états-unienne se mettent à rêver de ce nouveau dirigeant, féru de high-tech, courant après la modernité, jouant avec les réseaux sociaux et donnant son feu vert à l’intervention appuyée par l’Otan en Libye.
Dmitri Medvedev, désormais vice-président du Conseil de sécurité russe, est aujourd’hui l’un des pires faucons du régime dans sa dénonciation de la « junte de Kiev et de ses chiens nazis » comme dans celle de l’Occident. Sur VKontakte, principal réseau social russe (contrôlé par l’État), ses textes sont des diatribes enflammées. Il s’en explique en ces termes, le 7 juin : « Les gens me demandent souvent pourquoi mes messages sont si durs. Parce que je les déteste [l’Ukraine et ses alliés]. Ce sont des bâtards et des dégénérés. Ils veulent notre mort, celle de la Russie. Et tant que je serai en vie, je ferai tout ce que je peux pour les faire disparaître. »
L’alerte de 2008 et un premier virage
Les conseillers politiques sont appelés en Russie des « technologues ». Le mot dit combien il s’agit d’une ingénierie de contrôle politique des masses portée ensuite par de puissants médias (les télévisions) aux ordres du pouvoir. En 2007-2008, les technologues du Kremlin s’alarment. Il faut proposer un nouveau récit national à la société. Car cette société commence à distinguer l’autre face du régime : une démocratie confisquée, un État de droit inexistant, des assassinats de responsables politiques et de journalistes, une corruption qui a essaimé dans tout l’appareil d’État. Et surtout, l’enrichissement phénoménal des proches.
Poutine leur demande alors de développer un projet tout entier fondé sur le conservatisme et les valeurs traditionnelles. C’est une union renforcée avec le réactionnaire patriarcat orthodoxe de Moscou. C’est une dénonciation virulente de la crise morale de l’Occident, de l’homosexualité, des luttes LGBT. C’est une mise en avant des ressorts de l’« âme russe » face à une Europe faible et perdue dans son individualisme lâche. C’est enfin un premier discours de confrontation avec l’Occident avec une intervention de Vladimir Poutine remarquée par sa violence, lors de la conférence de Munich de fin 2007, grand-messe annuelle sur la sécurité internationale.
Ce projet conservateur, dont l’architecte est le conseiller Vladimir Sourkov, doit aider à légitimer la perpétuation d’un régime autoritaire. Et pour mieux le renforcer, une guerre est décidée. Après la Tchétchénie en 1999, voici la Géorgie en 2008. Une guerre éclair aboutit à la reconnaissance par la Russie de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, ce qui ampute la Géorgie de 20 % de son territoire. La Géorgie apparaît ainsi comme une répétition générale avant, six ans plus tard, l’annexion de la Crimée et la guerre du Donbass.
Ce projet ultra est à la fois radicalisé et amplifié dès 2012, lorsque Vladimir Poutine retrouve la présidence de la Fédération de Russie. Les élections législatives de l’automne 2011, massivement truquées, ont donné lieu à de spectaculaires manifestations dans les grandes villes de Russie. Il a fallu également bourrer les urnes afin que Poutine soit réélu dès le premier tour en mars 2012. Le président sort vainqueur mais affaibli de ces épreuves électorales. Une nouvelle réalité politique menace de déstabiliser le système criminel.
La réponse du pouvoir est la construction d’un national-patriotisme aux relents fascistes. Il doit organiser la militarisation de la société et préparer l’opinion aux guerres à venir (Ukraine 2014, Syrie 2015, Ukraine 2022). Il doit légitimer l’interdiction de tout débat politique et historique, comme le montre l’interdiction, fin 2021, de la grande association Memorial.
Le spécialiste de la Russie Michel Eltchaninoff, dans une postface au Rapport Nemtsov. Poutine et la guerre, note ainsi qu’à partir de 2012, « la guerre, selon Vladimir Poutine, dessine le destin historique de la Russie dans sa défense contre un Occident structurellement hostile. Elle révèle également l’homme russe à lui-même en lui permettant de dépasser un égoïsme bourgeois importé d’Europe ».
Un autre livre important détaille cette militarisation de la société et la sacralisation d’un ultrapatriotisme exalté par la Grande Guerre patriotique. Dans Le Régiment immortel. La guerre sacrée de Poutine, Galia Ackerman, historienne, spécialiste de l’Ukraine et des idéologies postsoviétiques, note combien il s’agit d’« affirmer la supériorité morale intrinsèque du peuple vainqueur – hier, aujourd’hui et pour toujours ». Et elle cite ce texte peu remarqué de l’idéologue du Kremlin Vladimir Sourkov, écrit en 2018, qui consacre l’alliance du système Poutine avec tous les milieux ultras, néofascistes et eurasistes de Russie.
L’année 2014 et le début de la guerre contre l’Ukraine constituent, selon Sourkov, « la fin du voyage épique de la Russie vers l’Occident, la cessation des multiples et vaines tentatives de devenir une partie de la civilisation occidentale, d’entrer dans la “bonne famille” des peuples européens. En 2014, une époque nouvelle, de durée indéterminée, commence. C’est l’époque 14 +, celle qui nous verra vivre dans une solitude géopolitique pendant cent (deux cents, trois cents ?) ans ».
En 2020, Sourkov est écarté du Kremlin après 20 années au service de Poutine. Il aurait même été récemment placé en résidence surveillée. Son extrémisme idéologique, qui a électrisé une large partie des élites russes, aurait-il fini par inquiéter le clan Poutine, d’abord soucieux de mettre à l’abri des sanctions occidentales les fortunes constituées et de passer le relais à la génération 2 ? Nul ne le sait. En revanche, la course à la guerre et la militarisation de la société sont bien les derniers leviers à la disposition du système Poutine pour assurer son avenir. C’est dire combien, sauf révolution de palais ou coup d’État militaire, le conflit en Ukraine est conçu pour durer.
François Bonnet La Revue du Crieur