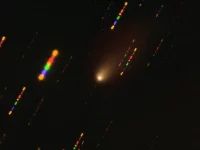Interview. Laura Poitras: «Le débat sécurité contre liberté est un faux débat»

INSTINCT. La documentariste, auteure de «Citizenfour» évoque sa rencontre avec Edward Snowden et le débat qui agite les Etats-Unis et l’Europe sur la surveillance. La folie des oscars à peine terminée, elle a pris l’avion pour la France, où son film Citizenfour sortait en salles ce mercredi.
Dans le salon calme et coquet d’un hôtel parisien, loin du tumulte, la documentariste Laura Poitras évoque pour Libération sa rencontre avec Edward Snowden, l’ancien employé de l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA), qui a révélé en juin 2013 l’ampleur des programmes de surveillance déployés par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Mais aussi le débat plus vif que jamais entre sécurité et liberté, le travail loin d’être achevé sur les documents transmis par le lanceur d’alerte, ou la surveillance dont elle fait l’objet depuisMy Country, My Country, son film consacré à l’Irak sous occupation américaine.
A quel moment avez-vous vraiment réalisé l’ampleur de cette histoire ?
Il y a eu deux moments différents. D’abord avec l’arrivée des premiers e-mails, en janvier et février 2013, et notamment un de ceux que je montre dans le film, dans lequel il décrit tout ce sur quoi il a réuni des preuves. A ce moment-là, je me suis dit : c’est sérieux. J’ai éteint tous mes ordinateurs, j’en ai acheté un nouveau, en espèces, j’ai ouvert des comptes e-mail anonymes, que je ne relevais pas depuis chez moi – j’allais dans des cybercafés au hasard, à Berlin… Mais ce n’était encore que mon instinct qui me disait que j’avais affaire à une source légitime. Je restais un peu précautionneuse, je gardais en tête qu’il pouvait s’agir d’un piège.
Juste avant de partir à Hongkong, j’ai reçu la clé de déchiffrement pour pouvoir accéder à certains documents. C’est là que j’ai vu le «budget noir»du renseignement américain. Dès lors, je n’avais plus seulement le sentiment de parler à quelqu’un qui allait transmettre des documents très importants : j’en avais la certitude.
Au début du film, Snowden dit qu’il ne veut pas être au centre de l’histoire. Avec Citizenfour, c’est tout l’inverse…
Je l’ai ignoré (rires). Son souci répondait à une perception très correcte de la manière dont fonctionnent les médias, qui se focalisent sur les personnes. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit dès qu’il a commencé à apparaître. Mais j’espère que je fais quelque chose d’un peu plus complexe… Je sentais qu’il était l’histoire. La raison pour laquelle il a fait ce qu’il a fait, c’est très important. C’est pour cela qu’il ne voulait pas rester anonyme – ce qu’il disait dès ses premiers messages et qui était pour moi, au départ, très surprenant : je suis journaliste, je considère qu’il faut protéger ses sources et non les exposer. Mais il estimait que le public avait le droit de savoir qui il était. En tant que réalisatrice, je respecte son sentiment qu’il «n’est pas» l’histoire, mais je crois qu’à bien des égards, il l’est.
Après My Country, My Country (2006) et The Oath(2010), Citizenfour est la troisième partie d’une trilogie consacrée aux Etats-Unis après le 11 septembre. Le film parle de surveillance, mais les révélations de Snowden ont eu un effet direct sur ce débat.
Il y a deux choses différentes : le travail journalistique sur les révélations, et le film lui-même. Je crois que le travail que j’ai fait avec Glenn Greenwald et d’autres sur les documents a changé la perception globale de ce que dont sont capables les agences de renseignement. Il a aussi changé le paysage du point de vue de ce que font les entreprises, qui proposent de plus en plus de services sécurisés. Pour elles, c’est une question de survie, il y a aussi des forces économiques en jeu.
Le film est différent : il parle de surveillance, mais quand on fait un film, si on veut qu’il vive sur la durée, il faut un thème universel. Pour moi, c’est un film sur le courage, au moins autant que sur la surveillance. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui fait que quelqu’un va quitter une vie normale pour prendre ce genre de risque, tout sacrifier sans savoir de quoi le jour suivant sera fait. Edward Snowden n’est pas le seul, il y a aussi William Binney (1), ou Glenn Greenwald… Je ne fais pas des films pour faire avancer des réformes, mais parce que je m’intéresse à l’expérience humaine.
Votre film sort alors que le débat entre liberté et sécurité se pose de nouveau avec acuité en Europe, et en particulier en France…
J’ai travaillé sur la manière dont l’Amérique a répondu au 11 septembre, et je crois qu’avec l’occupation de l’Irak, avec Guantanamo, avec l’usage de la torture, nous avons suivi un chemin qui a mené vers un monde moins sûr, moins stable. Nous avons fait quelque chose de vraiment tragique : nous avons abandonné nos principes. Ce qui nous rend forts, c’est la démocratie, l’Etat de droit… J’espère vraiment que la France ne suivra pas ce chemin. Ce serait vraiment terrible que des attaques contre la liberté d’expression, comme celles qui ont eu lieu ici, aient pour conséquence de limiter la liberté d’expression par l’usage de la surveillance.
Je crois aussi que ce débat – sécurité contre liberté – est un faux débat. Il n’y a aucune preuve que l’usage de la surveillance de masse ait servi à éviter des attaques. On a découvert après coup que la CIA n’avait jamais transmis au FBI des informations concernant deux des auteurs des attentats du 11 septembre : c’est un échec du renseignement. Or la réaction a été de tout collecter. La NSA, les «Five Eyes» (2), sont submergés de données. J’en suis un exemple : me poser les mêmes questions, à chaque passage de frontière, pendant six ans, c’est une perte de temps et de ressources. C’est une espèce de machine kafkaïenne, complètement hors de contrôle.
Sortir de l’Etat de droit, comme on l’a vu avec Guantanamo, ce n’est pas arrêter les terroristes. C’est un outil de recrutement. Je ne dis pas cela sur un plan théorique : j’ai été en Irak, j’y ai vu la colère croissante contre les Etats-Unis. Juste après l’élection d’Obama, beaucoup de gens étaient vraiment heureux, ils pensaient que les choses allaient changer. Des années après, on voit l’usage du programme de drones au-dessus du Yémen. Cela radicalise les gens.
C’est aussi ce qui a fait basculer Snowden ?
C’est sans doute l’un des éléments qui l’ont amené à se dire : maintenant, il est temps. Mais je crois surtout qu’il estimait que l’ampleur de ce que faisait la NSA ne devait pas rester secrète, qu’un débat public était nécessaire. Comme beaucoup, il a pensé que le changement d’administration allait mettre un frein à tout cela. Ce n’est pas arrivé. C’est à ce moment qu’il s’est dit : si nos représentants élus ne sont pas capables de transparence sur ces questions qui impactent tout le monde, alors il faut un lanceur d’alerte.
Le fait de se retrouver à Moscou a-t-il affaibli sa position, la portée de ses propos ?
C’est regrettable qu’il se soit retrouvé là-bas. Il devait transiter par Moscou, mais il n’a pas pu aller plus loin, et je sais avec certitude que cela n’a jamais été la destination prévue. Mais s’il a quitté Hongkong et recherché un asile, c’est parce qu’il savait comment les lanceurs d’alerte et les journalistes sont traités par le département de la Justice des Etats-Unis : on l’a vu avec Thomas Drake, qui a travaillé pour la NSA, et qui a été poursuivi au nom de l’Espionage Act, et menacé d’aller en prison pour le reste de sa vie.
Snowden a fait ce choix de chercher l’asile politique. Il n’est clairement pas là où il voulait être, et je crois que ses avocats travaillent très dur pour trouver une meilleure option. Le plus décevant, c’est qu’aucun pays d’Europe ne lui ait proposé de l’accueillir, pour ne pas se fâcher avec les Etats-Unis. La France, par exemple, aurait été en capacité de le faire, si elle en avait eu la volonté. Mais si le choix est entre l’asile politique là où il est et une vie entière dans une prison de haute sécurité, il estime, et beaucoup de gens avec lui, que sa situation actuelle est préférable.
Comme il l’explique dans Citizenfour, il vous a laissé la responsabilité de ce qui doit, ou non, être rendu public…
D’un côté, c’est ce que les sources font tout le temps : se tourner vers des journalistes qui vont évaluer ce qui est d’intérêt public et ce qui ne l’est pas. Ce qui est inhabituel, c’est voir cette discussion devant une caméra… Dans de très nombreux documents, il y a des éléments qui sont d’intérêt public, d’autres pas. Dans ce que nous avons publié sur le programme Prism par exemple, on voit les entreprises parties prenantes du programme, les dates auxquelles elles l’ont rejoint. D’autres éléments, vraiment «opérationnels», ont été retirés. Il y a aussi ce qui concerne l’usage légitime de la surveillance ciblée, par rapport à la surveillance de masse, qui est la question sur laquelle j’ai concentré mon travail, notamment pour Der Spiegel. Le travail sur les documents passe par un processus éditorial, ce n’est pas juste Glenn ou moi qui prenons ce type de décision. Ce n’est pas facile : les gens peuvent arriver à des conclusions différentes… Snowden ne voulait pas être celui qui ferait ce choix. C’est vraiment une responsabilité. Un fardeau, aussi : il y a encore beaucoup de documents, il faut faire en sorte que le travail soit fait, et qu’il soit bien fait.
Comment voyez-vous l’avenir d’Edward Snowden aujourd’hui ?
J’espère vraiment qu’il pourra trouver un asile dans un autre pays. Je crois aussi qu’avec le recul, il deviendra clair que ce qu’il a fait, c’est informer le public pour qu’il décide des capacités à accorder aux agences de renseignement. D’une certaine façon, il a mis ça entre nos mains de citoyens. Qu’allons-nous faire de ces informations ? Je crois que nous ne le savons toujours pas. Nous sommes à la croisée des chemins. Peut-être qu’un jour, Edward Snowden pourra retourner aux Etats-Unis. Mais il faudra du temps.
Et vous, cette histoire a changé votre vie ?
Oui, bien sûr. Avant même que Snowden ne me contacte, j’étais partie à Berlin parce que je considérais que je ne pouvais pas protéger mon travail aux Etats-Unis. Mais quand j’ai reçu les premiers e-mails, l’angoisse est devenue vraiment très forte. A Hongkong, et même après, elle l’était encore plus. J’ai eu des acouphènes, pendant un an environ, qui ont fini par partir. Quand nous montions le film avec Mathilde Bonnefoy, nous avons pris beaucoup de précautions, en laissant les téléphones portables à l’extérieur, en utilisant des ordinateurs qui n’étaient pas connectés à Internet… Aujourd’hui, je ne sais pas jusqu’à quel point je suis surveillée. Des sources m’ont dit qu’il y avait de la surveillance électronique. Je ne sais pas si ma maison est un endroit privé, par exemple… J’espère qu’un jour, je pourrai accéder à mon dossier.