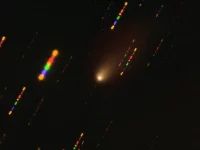Khartoum. Deux généraux rivaux menacent de plonger le Soudan dans le chaos

NIL BLEU NIL BLANC Voici des semaines qu’à Khartoum hommes politiques, analystes, épiciers, vendeuses de thé, bateliers ou enseignants craignaient de se réveiller avec cela : des tirs d’armes lourdes, des avions de chasse dans le ciel, l’écho des rafales d’armes automatiques. « Et voilà, on y est », « on s’y attendait mais c’est encore pire », disent depuis samedi matin les habitant·es contacté·es à Khartoum, entre fatalisme, angoisse et horreur. Au fur et à mesure d’heures confuses et d’informations plus ou moins véridiques, plus ou moins vérifiables, les Soudanais et Soudanaises ont l’impression que le sol s’ouvre sous leurs pieds.
Dimanche, les combats se sont intensifiés dans Khartoum. « Les murs tremblent », raconte Kholood Khair, analyste, terrée chez elle dans un quartier proche de l’aéroport. Une autre habitante, proche d’un des ponts sur le Nil, décrit au téléphone une situation « terrifiante ». Impossible de savoir qui contrôle le terrain, tant les communiqués sont contradictoires et les informations difficiles à recouper.
Seule certitude : les affrontements se sont étendus à tout le pays. Trois humanitaires du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués samedi dans l’Est. « C’est une guerre des villes, les combats se déroulent dans les rues, au milieu des civils, explique Ahmed Gouja, activiste et défenseur des droits humains depuis Nyala, capitale du Darfour méridional. Même en 2003, quand la guerre a commencé au Darfour, nous n’avons pas connu ça ! »
KARTOUM 2019
Et pourtant, « n’appelez pas ça une guerre civile, ce n’en est pas une », supplie un analyste politique, Hamid Khalafallah, sur le réseau social Twitter. Sa maison a pourtant essuyé des tirs dans la nuit. Et d’ajouter à l’adresse de ses concitoyennes et concitoyens civils : « Ce n’est pas notre combat et nous sommes juste un dommage collatéral. Ne vous engagez pas, ne soutenez pas un côté ou l’autre. »
Effectivement, à l’heure où sont écrites ses lignes, les deux camps qui s’affrontent font tous les deux partie de l’institution militaire. Ni les groupes armés rebelles, en activité ou non, ni les civils n’ont pris les armes.
Un pays avec deux armées et deux généraux rivaux
Au premier abord, la responsabilité en revient à deux hommes forts, dont l’inimitié notoire s’est transformée en haine : d’un côté le général Abdel Fattah al-Bourhan, commandant en chef de l’armée nationale (SAF pour Sudanese Armed Forces, selon l’acronyme communément utilisé), de l’autre le général Mohamed Hamdan Dagolo, dit Hemetti, chef de la Force de soutien rapide (RSF, selon l’acronyme anglais), constituée de paramilitaires issus des rangs des « janjawid », supplétifs de Khartoum pendant la sanglante guerre du Darfour. La RSF est aujourd’hui si puissante qu’elle est une « armée bis ».
« Nous avons deux armées dans ce pays. Si ces deux-là ne parviennent pas à s’entendre sur une unification des forces, nous irons vers l’affrontement et la destruction du pays », affirmait il y a quelques semaines seulement Babiker Faisal, responsable du parti unioniste, membre de la coalition civile des Forces pour la liberté et le changement.
Ces deux généraux-là semblent pourtant, pour les néophytes du Soudan, comme deux doigts d’une même main. Ils ont servi le même chef, le dictateur Omar al-Bachir. Ils ont participé à la révolution de palais qui l’a destitué il y a tout juste quatre ans, puis siégé dans le même comité militaire de transition. Ils ont négocié ensemble un accord de partage de pouvoir avec les civils et occupé chacun un siège dans le Conseil de souveraineté, organe suprême de la transition démocratique. Ils ont, enfin, renversé le fragile édifice de la transition en même temps que le gouvernement civil le 25 octobre 2021. Et sont devenus par la grâce de ce coup d’État, pour le général Bourhan, le chef de facto du pays, et pour Hemetti son numéro deux.
Seulement rien n’est allé comme ils l’escomptaient. Les révolutionnaires ne sont pas restés chez eux la tête basse et les comités de résistance, organisations de quartier et colonne vertébrale du soulèvement populaire de 2018, ont mis en place des manifestations et des actions de désobéissance civile. Les grandes agences internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), les pays occidentaux, ont suspendu les programmes d’assistance financière et technique.
Surtout, l’alliance de ces deux-là n’était que de circonstance. Chacun a son agenda et ses alliés régionaux et internationaux. Abdel Fattah al-Bourhan est proche des partisans de l’ancien régime militaro-islamiste et soutenu par l’Égypte. Hemetti est détesté des islamistes, qui l’accusent d’avoir précipité l’arrestation d’Omar al-Bachir. Il a de fermes soutiens aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.
Les deux ont des alliés en Israël et en Russie – mais pas dans les mêmes cercles. Les deux possèdent des sources de revenus énormes, issues principalement du complexe militaro-industriel pour le chef de l’armée, des mines d’or pour le second. Au fil des années, profitant d’un régime kleptocratique, ils ont su, l’un et l’autre, diversifier leurs richesses. Tous deux ont aussi beaucoup d’ambition.
Une rivalité qui va au-delà d’une inimitié personnelle
L’animosité ne s’arrête pas aux deux hommes. L’armée soudanaise a été façonnée par Omar al-Bachir : beaucoup d’officiers ont adhéré à l’idéologie islamiste du régime passé. Ils sont proches des militaires égyptiens, car ils ont fréquenté les mêmes académies. Les rangs de l’armée nationale représentent l’ensemble des ethnies du pays.
La RSF est composée pour l’essentiel d’hommes des tribus arabes éleveuses de bétail du Darfour. Hemetti lui-même vient d’une famille de nomades et a reçu une éducation sommaire. Il est fréquent d’entendre, à Khartoum, railler cet « éleveur de chèvres ». L’armée nationale n’a jamais vraiment accepté que ces supplétifs, les janjawid craints pour leurs attaques de villages au Darfour, soient déclarés « force régulière » par Omar al-Bachir et, en 2018, appelés par lui à Khartoum.
De son côté, Hemetti a fait grossir ses forces, aidé par l’argent que lui rapporte l’envoi de mercenaires au Yémen aux côtés des Saoudiens. La force paramilitaire compte presque autant d’hommes que l’armée nationale. Ils sont bien payés, bien entraînés, bénéficient d’équipements modernes. L’armée a pour supériorité de posséder l’aviation et l’artillerie.
C’est pour cette raison que la RSF s’est efforcée de prendre possession des aéroports et bases militaires aériennes. Ce n’est pas étonnant si la crise ouverte a commencé jeudi dernier à Méroé, dans le nord du pays, où des aviateurs égyptiens venaient s’entraîner avec leurs homologues soudanais. RSF a encerclé la base. Samedi matin circulaient des vidéos montrant les officiers égyptiens prisonniers des paramilitaires, ce qui a avivé l’escalade. Les aéroports de plusieurs villes ont été annoncés pris par les uns et repris par les autres au fil des heures.
Il y a plusieurs mois, RSF avait cherché à acquérir des avions et des missiles anti-aériens. Achats bloqués par l’état-major de l’armée. Chacun, déjà, préparait l’affrontement. « Ces trois derniers mois, il y a eu une grosse vague de recrutements à la fois par RSF et par l’armée au Darfour, explique Ahmed Gouja depuis Nyala. RSF offre davantage aux nouvelles recrues : la possibilité d’être envoyé au Yémen, ce qui rapporte 50 ou 60 000 euros au bout de neuf mois d’engagement, des Land Cruisers pour les leaders communautaires. Du coup, l’armée nationale, au Darfour, est en minorité par rapport à RSF. » Le général al-Bourhan a été accusé, de son côté, de former une milice dans le nord du pays, d’où il est originaire.
« Ce ne sont pas des acteurs politiques, ce sont des criminels »
C’est avec ces deux composantes militaires que les civils négocient depuis le début de la révolution en décembre 2018. Le premier partage du pouvoir, obtenu en août 2019, a été fracassé par le coup d’État d’octobre 2021. La coalition civile la plus large, les Forces pour la liberté et le changement (FFC), regroupement de partis politiques et d’organisations de la société civile, a remis le travail sur le métier. Les négociations suivantes ont été appuyées par toute une série de bonnes fées : mécanisme trilatéral regroupant l’ONU, l’Union africaine et l’IGAD, une organisation régionale ; quartet, rassemblant États-Unis, Royaume-Uni, Arabie saoudite et Émirats arabes unis ; Unitams (mission de l’ONU d’appui à la transition).
Elles ont abouti à un accord-cadre signé le 5 décembre 2022 sur le retour du pouvoir aux civils, aussitôt considéré avec suspicion et rejeté par une partie des acteurs politiques et sociaux.
Il faut dire que s’il prévoyait un gouvernement civil, cinq questions épineuses étaient repoussées à des négociations ultérieures, et la question de la place des militaires n’était pas réellement tranchée. La conférence sur la réforme des institutions militaires et de sécurité a échoué. « L’armée l’a réduite à la question de savoir comment intégrer RSF, mais ce n’aurait pas dû être cela !, s’exclame Amgad Farid, ancien directeur de cabinet du premier ministre civil Abdallah Hamdok. La réforme doit déboucher sur une armée unifiée sans agenda politique et sous le contrôle des civils, pas sur une discussion pour déterminer qui, de Al-Bourhan ou de Hemetti, gardera le plus de pouvoir. »
Pour autant, l’affrontement n’est pas lié au processus politique prévoyant le retour au pouvoir des civils : « Cette guerre était inscrite dans le coup d’État de 2021, reprend Amgad Farid. Il a été mené à forces égales par la milice privée qu’est RSF, au service de Hemetti et de son clan, et l’armée. L’équilibre ne pouvait pas tenir. Ce qui se passe aujourd’hui est un combat pour savoir qui contrôlera le pays. »
Le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé sa grande préoccupation, et les grands acteurs internationaux ont appelé à un cessez-le-feu… Mais, enrage Amgad Farid, « tous ces dirigeants ont commencé à traiter avec Al-Bourhan et Hemetti après le putsch, en les considérant comme des acteurs politiques avec lesquels négocier. Ce ne sont pas des acteurs politiques, ce sont des criminels qui ont mené un coup d’État ! »
« Si le Soudan s’effondre, tous les autres pays de la région en subiront les conséquences sécuritaires », disait pourtant un diplomate occidental il y a peu. Le terme « effondrement » peut sembler exagéré, mais le pays est depuis longtemps traversé par des tensions centrifuges et celles-ci se sont beaucoup accentuées depuis le coup d’État d’octobre 2021. Si aucune action rapide et ferme des « amis du Soudan » n’est lancée, les obus qui sifflent au-dessus des têtes des civils pourraient bien signer le début de la fin de ce pays.