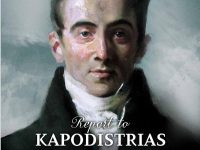Or noir et argent sale: en Irak, les cartels font la loi

OIL En Irak, les milices sont devenues incontrôlables, rançonnant, trafiquant, extorquant et kidnappant pour financer leurs activités. Dernier volet de notre série d’enquêtes sur la corruption dans un pays meurtri par les guerres et l’invasion américaine de 2003.
Lorsque le camion citerne Mercedes passe la barrière de la base militaire d’Al-Asad, à 180 kilomètres à l’ouest de Bagdad, rien ne le distingue des autres. Sa plaque 32-AA-665 est vérifiée, les papiers du chauffeur aussi. On n’entre pas si facilement dans la plus grande base militaire américaine d’Irak. Le camion fait partie d’une livraison tout ce qu’il y a d’officiel. Pourtant, ce qui pourrait paraître anecdotique est en réalité la partie visible de l’iceberg de la corruption dont même la puissante armée américaine est victime.
« Et si je vous disais que les États-Unis achètent du carburant iranien alors qu’ils n’ont pas le droit de le faire ? » Selon l’une de nos sources présentes en Irak, ce camion Mercedes est tout sauf banal. Il transporte du carburant iranien qui va être utilisé par l’armée américaine. D’après cette même source, un homme d’affaires qui a un accès régulier à la base d’Al-Asad, soit l’armée américaine ne le sait pas, soit elle ferme les yeux.
Cette base a d’abord été utilisée par les Américains entre 2003 et 2011, puis de nouveau en 2014 au nom de la lutte contre le groupe État islamique. Pour des raisons évidentes de sécurité, l’homme qui nous fournit ces documents souhaite rester anonyme. Ce qu’il nous dévoile, photos et vidéos à l’appui, révèle l’ampleur d’un trafic qui contourne les sanctions américaines imposées à l’Iran, lui interdisant d’exporter ses hydrocarbures. Or, ce carburant iranien est revendu aux Américains. Étrange paradoxe.
L’Irak est un pays de profondes contradictions. Cinquième réserve prouvée de pétrole au monde, il est obligé d’importer des hydrocarbures pour faire fonctionner ses centrales électriques, elles-mêmes défaillantes. Pour cela, l’Irak achète du gaz en provenance d’Iran, ennemi des États-Unis, qui sont donc à l’origine de sanctions lourdes empêchant la République islamique d’exporter ses hydrocarbures.
Pour ce faire, un permis d’importation, renouvelable tous les trois mois, est exceptionnellement accordé à l’Irak par les États-Unis, en dépit de ses propres sanctions imposées à l’Iran. Entre les discours diplomatiques et les réalités du terrain, il y a parfois un monde absurde.
Ce trafic n’aurait pas été possible sans l’implication de différentes factions du Hached Chaabi, coalition de milices chiites appelées à libérer Mossoul de l’emprise du groupe État islamique en 2014. Trois ans plus tard, dès la fin de l’emprise territoriale de Daech en Irak, un système parallèle informel s’est développé, dans lequel les milices ont quadrillé les passages terrestres et maritimes du pays. Ce système parallèle est devenu la pierre angulaire des partis et des groupes armés irakiens.
Pour mesurer combien les milices sont devenues incontrôlables, au point de générer ce genre de trafic, il faut comprendre le degré d’impunité des milices chiites irakiennes. Comme cet événement passé inaperçu, le jeudi 25 mars 2021.
Un État failli
La scène ressemble à s’y méprendre au cauchemar de juin 2014, lorsque le groupe djihadiste État islamique prend Mossoul. À bord de dizaines de pick-up, des hommes cagoulés et armés jusqu’aux dents bombent le torse. Debout sur des véhicules kaki, certains tirent en l’air, d’autres déploient des banderoles aux messages guerriers tels : « Nous avons sorti nos hommes et nos armes contre l’occupant américain et son fidèle collaborateur, le gouvernement irakien. » Un gouvernement irakien aux abonnés absents. Tout comme l’armée irakienne. Rien ni personne ne s’oppose à cette colonne militaire qui avance sur Bagdad.
Ces hommes ne sont pas des membres de Daech. Ce sont des miliciens chiites d’un groupe tout récemment formé, Rabaa Allah, – les « Camarades de Dieu ». La scène qui suit est surréaliste. En plein cœur de Bagdad, les miliciens s’engagent dans une parade militaire en saluant les effigies de religieux et de militaires iraniens, dont celle du général Qassem Souleimani, tué par un drone américain le 3 janvier 2020.
Sur les écriteaux, on aperçoit également le visage du premier ministre irakien actuel, Moustapha Kadhimi, piétiné par une botte de soldat. Puis la parade s’achève par la déclaration d’un homme cagoulé qui se présente comme le chef de la milice. À l’aide d’un mégaphone, entouré d’hommes masqués munis de lance-roquettes, il blâme directement le premier ministre pour avoir entamé un « dialogue stratégique » avec le nouveau président américain Joe Biden.
Dans son discours, le chef de la milice énonce même des directives au gouvernement. Il l’exhorte entre autres à voter le budget 2021 plus rapidement et à trouver une solution à la question du taux de change par rapport au dollar, crucial pour le pays, qui traverse sa pire crise économique et dont la monnaie, le dinar, a récemment perdu 25 % de sa valeur.
À quelques rues à peine du Parlement et des institutions étatiques, la tournure tragi-comique de la scène est pourtant prise très au sérieux par le gouvernement irakien, qui décrète aussitôt l’état d’urgence. L’une de nos sources, un homme d’affaires possédant des bureaux dans le centre de Bagdad, a assisté au spectacle. « Lorsqu’un groupe paramilitaire défile, menaçant, en plein cœur d’une capitale et que le gouvernement ne peut rien y faire, peut-on parler d’un État fiable et respectable ? Je ne le crois pas », s’indigne-t-il. Installé à Bagdad depuis 2009, il n’avait jamais vu « ça ».
« Ça, selon lui, c’est un État failli. »
Cette nouvelle formation du nom de Rabaa Allah émane de l’une des milices les plus puissantes du pays : le Kataeb Hezbollah. Ce groupe paramilitaire pro-iranien fait partie de la fameuse coalition de milices du Hached Chaabi, formée et financée par l’Iran depuis juin 2014.
Ces dernières années, la milice Kataeb Hezbollah a combattu aux côtés du gouvernement irakien contre Daech. Aujourd’hui, c’est pourtant ce même gouvernement que les miliciens défient dans ce qui se présente comme la plus grande démonstration de force anti-gouvernementale depuis la prise de Mossoul par l’organisation de l’État islamique.
Si cette milice n’est qu’une des nombreuses mains armées de l’Iran en Irak, elle est l’une des plus virulentes. C’est elle qui tire régulièrement des roquettes sur l’ambassade américaine à Bagdad ou encore sur les bases militaires du pays où les Américains opèrent. C’est l’une des raisons pour lesquelles le groupe et son leader, Ahmed al-Hamidawi, ont été placés sur la liste des organisations terroristes par les Américains.
On dit de ce chef militaire qu’il recevait directement ses ordres du défunt général iranien Qassem Soleimani. Depuis, l’Iran a intensifié ses attaques contre les intérêts américains en Irak en utilisant ces milices. Des milices que le gouvernement irakien parvenait plus ou moins à contrôler en les finançant. Depuis la libération de Mossoul, ce n’est plus le cas.
« Impossible de faire du business en Irak sans passer par les milices »
Car, au lieu de rendre les armes, le Hached Chaabi s’est organisé, surfant sur la victoire contre Daech. Asphyxié par les nouvelles sanctions économiques de Donald Trump, l’Iran a dû revoir le financement des milices irakiennes à la baisse. Ces dernières ont dû chercher des sources financières alternatives. Pour assurer leur longévité face à un gouvernement qui ne sait plus comment se débarrasser d’elles, il leur fallait de l’argent. Beaucoup d’argent.
Aujourd’hui, si les milices ne combattent plus le groupe État islamique, pourtant encore influent et capable de commettre des attentats dans tout le pays, désormais, elles rançonnent, trafiquent, extorquent et kidnappent pour financer leurs activités.
« Elles fonctionnent comme des cartels, dans le sens où elles ne se font pas ouvertement la guerre. Il y a un accord tacite entre leurs chefs. Les milices se partagent le territoire. Chacune prend sa part du gâteau. On assiste à la cartellisation de l’Irak », explique un diplomate irakien basé à l’étranger. Elles sont devenues financièrement autonomes et militairement incontrôlables. Dans la kleptocratie qu’est devenu l’Irak, il ne manquait plus que les cartels. Avec les milices, c’est chose faite.
« Elles se sont professionnalisées dans le flux de financement à travers des domaines où l’argent et les marchandises transitent sans arrêt. Comme les douanes, par exemple », ajoute-t-il.
In fine, avec les milices présentes dans tout le pays, les trafics même les plus impensables peuvent se dérouler. Comme cette fameuse contrebande de carburant iranien révélée par notre source, qui sévit à travers la frontière nord entre l’Irak et l’Iran.
Selon les documents mis à notre disposition, le trafic se déroule de la manière suivante. Une entreprise nommée Renos, tenue par un Irakien du nom d’Ameer Rasheed, achète du diesel à une société iranienne basée en Iran. Sur les différents bons de commande, on aperçoit la mention « One tanker diesel, 23 129 kg », le bon pour accord, les tampons de deux sociétés iraniennes basées à Téhéran, Artin Farabar AraratetSabooran Tarabar. On y trouve également les noms des chauffeurs, et les numéros des camions, immatriculés en Iran, photos à l’appui.
Un autre homme, Jamal al-Alem, réceptionne le chargement pour le compte de la base Al-Asad. Nous avons découvert que cet homme a pourtant été banni par le gouvernement irakien après avoir été condamné dans des affaires de fraude. Pour continuer son business, il opère désormais depuis le Kurdistan, à travers cette même société de transport, Renos, basée à Erbil.
L’autre découverte laisse sans voix. Jamal al-Alem travaille indirectement pour le compte du Pentagone à travers la DLA, Defense Logistic Agency. Cette agence fournit du matériel aux forces armées nationales et assure notamment l’acquisition de pièces de rechange d’armes et de munitions. La DLA est une organisation militaire des plus stratégiques pour les États-Unis.
Pourtant, l’homme qui a la charge de fournir le carburant à la base d’Al-Asad travaille avec les milices irakiennes. Quant au carburant, personne à la base n’a semblé ému par sa provenance, encore moins par sa mauvaise qualité, comme en attestent des analyses fournies par notre source. Pour couronner le tout, il est revendu beaucoup plus cher. La violence des milices et les multiples intermédiaires entre la douane et la base d’Al-Asad rendent les transactions complètement opaques.
« Voilà pourquoi le Pentagone se retrouve à acheter du carburant iranien sans s’en rendre compte », explique l’homme d’affaires.
Selon différentes sources, le Pentagone dépense environ 15 millions de dollars par mois pour acheter du carburant pour la seule base d’Al-Asad. Ramené au gallon, environ quatre litres, son budget est de 10 dollars, cinq fois le prix du marché. De quoi permettre aux trafiquants de prospérer…
« Aujourd’hui, les milices sont tellement ancrées dans le système qu’elles peuvent acheter tous les fonctionnaires qu’elles veulent. C’est comme ça. C’est un fait », dénonce-t-il. Installé à Bagdad depuis 2009, il admet lui aussi ne pas avoir le choix. « Soit on attend éternellement que l’administration irakienne nous fournisse les autorisations pour faire transiter tel ou tel produit, soit on accepte l’idée de sacrifier une grosse somme d’argent pour réussir à obtenir un contrat. Tous les hommes d’affaires qui veulent accélérer les démarches payent les milices. »
Cette affaire, pourtant grave, n’est que la partie visible d’un iceberg qui ne cesse de croître en Irak. Ce problème d’opacité et de milices intermédiaires ne concerne pas seulement les hydrocarbures. « Toutes les transactions commerciales sont affectées », confirme un autre homme d’affaires, en place dans le sud de l’Irak, à Bassorah, depuis 2008.
N’exportant plus grand-chose hormis son pétrole, l’Irak a besoin d’importer toutes sortes de produits, majoritairement d’Iran, de Turquie et de Chine. Dans leur grande majorité, ces biens transitent par les cinq terminaux officiels parsemant les 1 600 kilomètres de frontière avec l’Iran, par le seul poste-frontière couvrant tout aussi officiellement les 370 kilomètres de frontière avec la Turquie et par l’unique port d’Irak, Oum Qasr, à la pointe sud.
« Quasiment plus rien ne peut se faire sans leur accord. Le problème est qu’il y en a maintenant des dizaines et des dizaines. Chacune contrôle un territoire ou un domaine. Il est inconcevable de travailler en Irak sans les payer. Pour ma part, j’ai un budget pots-de-vin pour chacun des contrats que je veux signer, s’indigne-t-il. Pas le choix, c’est ça ou on doit quitter le pays, voire pire. »
Ce sont elles désormais qui tiennent les rênes de la corruption. Même le ministre des finances actuel Ali Allaoui le reconnaît : « La collusion entre officiels, partis politiques, milices, gangs et hommes d’affaires véreux aboutit au pillage des fonds publics. » Selon ce dernier, l’État irakien est le premier à être pénalisé puisqu’il ne perçoit que 10 à 12 % des recettes douanières par an.
Dans les méandres de cette corruption tenue par les milices, on trouve également des responsables politiques de renom. L’ex-premier ministre Nouri al-Maliki par exemple. Il serait associé à une entreprise tentaculaire en Irak et dans les pays voisins : Afaq. C’est également le nom de la télévision financée par l’ex-premier ministre : Afaq TV. Mais pour se faire discret, Nouri al-Maliki aurait lui aussi instrumentalisé les milices.
Le point zéro de la corruption des milices
Pour en savoir plus sur les liens supposés entre l’ex-premier ministre et les milices, nous avons recontacté Abou Hassan et son réseau de lanceurs d’alerte établi à Bassorah. C’est ce dernier qui avait révélé l’affaire de corruption autour de l’eau empoisonnée en 2018 dans la première partie de notre enquête.
Parmi le vaste réseau de milices déployées dans le Sud, deux noms reviennent régulièrement : Afaq et Sami al-Asadi. Selon Abou Hassan, Sami al-Asadi est le premier milicien à avoir mis la main sur la corruption déjà en place. Il est surtout un proche de Nouri al-Maliki. Tous les contacts d’Abou Hassan le confirment. Et ils pointent tous dans la même direction : le port d’Oum Qasr, seul point d’entrée maritime du pays.
Tout commence en 2004, un an après l’invasion américaine. À l’époque, Sami al-Asadi est mécanicien de formation. Par l’intermédiaire d’un ami, il est recruté par l’une des nombreuses sociétés américaines chargées de la reconstruction : American United Group.
Pour elle, Sami al-Asadi va mettre les mains dans le cambouis mais en manipulant les armes. La société le recrute pour assurer la sécurité des sites où elle opère. Sami a des connexions tribales et surtout de bonnes relations avec certains futurs membres du gouvernement irakien. Il a aussi de très bonnes relations avec Moqtada al-Sadr, chef religieux chiite et fondateur de l’Armée du Mahdi, celle-là même qui combattra l’armée américaine.
Selon nos sources, Sami devient membre de l’Armée du Mahdi peu de temps après son recrutement. Un paradoxe de taille lorsque l’on sait que Sami al-Asadi travaille pour les Américains. À partir de 2004, la milice de l’Armée du Mahdi contrôle le sud de l’Irak, là où Sami travaille, notamment le port d’Oum Qasr. Cette adhésion à l’Armée du Mahdi lui permet de travailler en toute sécurité. Après quelques années, Sami devient l’intermédiaire incontournable pour toutes les affaires liées au port d’Oum Qasr. Il devient celui qui règle les « problèmes ».
Mais ses relations avec American United se compliquent. Ses méthodes inquiètent sa hiérarchie, qui le lui fait savoir. Sami al-Asadi quitte la société et va fonder Afaq, que tout le monde attribue à l’entourage de Nouri al-Maliki et de son fils, Ahmed. C’est lui qui sera arrêté à Beyrouth avec un milliard et demi de dollars, puis finalement libéré après l’intervention de son père. Personne ne sait ce qu’il est advenu de cet argent.
Le coup d’État
En 2008, Sami al-Asadi est aperçu à plusieurs reprises avec Ahmed al-Maliki dans des réunions d’affaires. Quelques mois plus tard, l’oncle de Sami devient ministre de l’intérieur par intérim dans le gouvernement de Nouri al-Maliki. Un homme puissant du nom d’Adnane al-Asadi. Ce dernier se rapproche du premier ministre.
Selon des mails révélés par WikiLeaks, Adnane al-Asadi est alors l’homme de main de Nouri al-Maliki pour les « transactions irrégulières ». En d’autres termes, toutes les activités commerciales qui lient Afaq et Nouri al-Maliki sont signées de sa main ou de celle de Sami al-Asadi. Il n’existe, à notre connaissance, aucune trace du nom de Nouri al-Maliki dans aucun document, sauf dans sa propre télévision, qui se nomme elle-même Afaq TV.
« Parmi la classe politique irakienne, il est celui qui fait le plus attention à ne pas laisser de traces. On entend son nom partout, mais on ne peut le lire nulle part, c’est sa force », nous raconte le diplomate irakien basé à l’étranger, et qui a côtoyé Nouri al-Maliki durant son premier mandat en 2006.
Sami al-Asadi, selon plusieurs sources, est également proche d’Essam al-Asadi, l’un des hommes d’affaires les plus importants en Irak. Enfin, l’un de ses cousins est au cœur des forces de sécurité irakiennes : Abdul Ghani al-Asadi, puissant général des forces spéciales irakiennes. Ce dernier est le beau-père d’un des directeurs de la sociétéAfaq, nom que l’on retrouve un peu partout en Irak.
Selon le registre de commerce du gouvernorat de Bassorah, la société Afaq Umm Qasr for Marine Service est constituée le 7 janvier 2008. En 2021, elle est toujours active. À sa tête, trois personnes seulement : Riyadh Abdel Aziz Badr, Qassem Radhi Lemgheity et bien sûr Sami al-Asadi, présenté comme étant le directeur.
Après quelques recherches, avec l’aide de l’OCCRP, collectif d’enquêteurs spécialisés dans les affaires de criminalité financière, basé à Washington, on découvre que la société possède également un bureau au Koweït et un autre en Jordanie.
Au Koweït, l’entreprise est enregistrée en 2008, en même temps que sa création dans le sud de l’Irak à Bassorah. En Jordanie, l’entreprise est enregistrée le 15 avril 2010. Le site internet de la société n’est plus actif. Mais une version archivée mentionne ceci : « Créée en 2008, Afaq est l’une des premières entreprises à fournir des services de transport sophistiqués et de fret maritime pour les marchandises transportées à l’intérieur et autour de l’Irak. » On y trouve également d’autres informations. Aux côtés d’American United, on y lit qu’Afaq a signé un accord dans le port d’Oum Qasr avec l’armée américaine pour de la logistique et de l’importation de fournitures. La signature est de Sami al-Asadi en personne.
Cela lui donne un effet de levier inespéré pour contrôler totalement le port d’Oum Qasr. En 2010, selon les contacts d’Abou Hassan, Sami al-Asadi est tout-puissant et hors de contrôle. Cet été de la même année, Sami donne le coup de grâce à American United. Il ordonne à des miliciens d’empêcher les camions de transport d’American United de quitter le port. C’est ce qu’Abou Hassan appelle « le coup d’État ».
Sami al-Asadi réquisitionne tous les équipements d’American United et force les salariés à quitter le complexe d’Oum Qasr, sous la menace de miliciens armés. Un Américain aurait même été évacué du port, à deux doigts d’être capturé par les miliciens.
American United ne survivra pas à ce « coup d’État ». Malgré ses plaintes auprès de l’administration du Pentagone, rien ne change. L’entreprise prépare un plan de sortie du pays. La fin d’American United est le début d’Afaq. Un événement sans précédent. Sami al-Asadi est un homme insaisissable et mystérieux. Selon Abou Hassan, il se fait très discret, invisible. Mais la société Afaq est toujours active. Elle continue aujourd’hui de travailler avec des sociétés étrangères sur le port d’Oum Qasr.
La corruption ou la nation
Aujourd’hui, force est de constater que la corruption en Irak n’est pas le fait de quelques hommes d’affaires et responsables politiques. Non seulement systémique et mafieuse, elle est désormais cartellisée. L’Irak post-Saddam est loin du modèle prôné par l’administration Bush, loin d’un régime fondé sur la justice sociale, la citoyenneté et une démocratie fonctionnelle.
Le système actuel se décompose à mesure que la corruption se systématise. Si les États-Unis sont profondément impliqués dans ce processus, ils sont aujourd’hui incapables d’inverser la tendance. Non seulement parce que l’invasion de l’Irak a contribué à ravager l’économie mais surtout parce que l’Amérique achète le pétrole qui alimente cette corruption.
La Réserve fédérale américaine fournit toujours à l’Irak au moins 10 milliards de dollars par an grâce aux ventes de pétrole du pays. Le Pentagone finance toujours à coups de milliards certaines bases militaires du pays. Une grande partie de cette somme est détournée et alimente la machine bien huilée de la corruption irakienne. Dans le même temps, les États-Unis infligent des sanctions punitives aux deux pays voisins, l’Iran et la Syrie, avec lesquels l’Irak partage des frontières très perméables et tenues par les milices.
C’est le terreau idéal de la corruption.
En octobre 2019, des manifestations antigouvernementales, dirigées par une jeunesse chiite en révolte contre le système, secouent Bagdad et les villes du Sud. Par sa rage, cette jeunesse a ébranlé le système dans son essence mais fait face à des défis de taille pour engager les élites dans de véritables réformes, voire dans un changement radical de système politique. Même si certains responsables irakiens ont pris conscience de ce besoin de réformes, ils ne peuvent rien contre les milices qui défendent ce système et qui harcèlent, kidnappent, tuent les manifestants.
En 2021, l’Irak connaît toujours un important marasme social, aggravé par la corruption et la déliquescence de ses institutions. En révolte depuis bientôt deux ans maintenant, la population dans son ensemble pointe toujours du doigt ce système politique, fondé sur le sectarisme et le confessionnalisme. Plus que jamais, cette jeunesse dénonce en premier lieu la corruption généralisée qui étouffe, détruit la nation irakienne. Les milices qui tiennent désormais le pays ont pour l’instant réussi à contrer cette hargne, certainement pour une même et unique raison : préserver la destruction d’une nation nommée Irak pour survivre et faire durer la guerre entre le pays voisin, l’Iran, et les États-Unis.
Ce coup d’État des milices sur l’économie du pays éloigne le rêve déjà très lointain d’un Irak indépendant. Cette démonstration de force du 25 mars 2021 porte plusieurs symboles. D’abord celui d’un gouvernement impuissant, incapable de répondre à ces menaces. Elle est aussi le symbole d’une nation qui ne parvient pas à se reconstruire, prise entre le marteau américain et l’enclume iranienne. Si le gouvernement irakien veut survivre, il devra faire des choix. Laisser perdurer un système politique qui favorise la corruption ou écouter sa population. Détruire une nation ou la reconstruire.
Plus que jamais, 18 ans après l’invasion américaine, les responsables politiques irakiens devraient se poser la question : si les frontières d’un pays ne sont pas tenues par sa propre armée, peut-on parler d’une nation souveraine ?