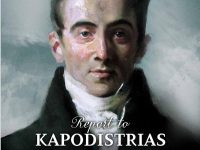Ecosystemes. Comment vivre après le traumatisme d’un mégafeu

Ecosystemes. Comment vivre après le traumatisme d’un mégafeu
Tandis qu’un violent incendie frappe la Grèce, l’anthropologue Élise Boutié explique comment les mégafeux bouleversent en profondeur la vie sociale des territoires ravagés par les flammes, remettent en cause notre vision idéalisée de la forêt, et bouleversent à jamais des vies humaines.
Dans son dernier rapport d’évaluation sur le climat, le Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a rappelé qu’au fur et à mesure que nos émissions de gaz à effet de serre augmentent, les mégafeux deviennent « plus fréquents » et « plus intenses ». C’est que les incendies de forêt extrêmes ont déjà doublé depuis vingt ans.
Alors que le changement climatique s’accentue à « un rythme sans précédent », des incendies gigantesques en Sibérie russe ont dévoré un million d’hectares de forêt en juillet dernier. Idem sur la côte ouest américaine. Et depuis le 11 août, la région au nord-est d’Athènes, en Grèce, est en proie aux flammes, obligeant les autorités à évacuer plusieurs communes.
Doctorante en anthropologie sociale au LAP (Laboratoire d’anthropologie politique), Élise Boutié a écrit sa thèse sur le Camp Fire en Californie, un des mégafeux les plus meurtriers de l’histoire des États-Unis qui a détruit en novembre 2018 la ville de Paradise, ravagé 62 000 hectares de forêt et tué 85 personnes.
Elle détaille, grâce à une enquête de terrain de sept mois, comment les incendies sont un fait social total qui chamboule la vie matérielle et symbolique des territoires brûlés, mais aussi comment vivre après une telle catastrophe. Selon elle, les mégafeux révèlent nos attachements au paysage forestier tout comme notre méconnaissance de ces écosystèmes complexes.
Mediapart : L’une des particularités du « Camp Fire » de 2018 que vous soulignez dans vos travaux, et qui résonne avec les incendies actuels en Grèce, c’est la rapidité avec laquelle les flammes se déplacent…
Élise Boutié : Ce mégafeu s’est déclenché en Californie après un hiver très peu pluvieux et un été traversé par la sécheresse. À cela se sont ajoutés des vents très forts, comme en ce moment en Grèce, qui empêchent les hélicoptères d’intervenir au plus près des flammes.
On a parlé de mégafeu car l’incendie ne s’est pas propagé sur un seul front, mais s’est répandu très vite par ricochet avec le vent, créant simultanément plusieurs foyers. On a estimé que le feu courait à la vitesse d’un stade de foot par seconde.
Par ailleurs, l’incendie a traversé Paradise, une ville de 27 000 habitants, où l’urbanisation a fait que tout était hautement inflammable : les bonbonnes de gaz, les voitures, les peintures des murs, etc.
Le feu s’est déclenché à 6 heures du matin, à une heure où les gens démarraient leur journée pour aller au travail. Il leur a fallu un temps pour comprendre qu’une catastrophe était en train de se passer sous leurs yeux et qu’il fallait déguerpir. Beaucoup d’habitants se sont retrouvés coincés dans leurs voitures, entourés par les flammes, et m’ont décrit le choc de voir brûler en une poignée de secondes des endroits familiers.
Vous écrivez à ce propos que le fait de « voir » la disparition a créé un trauma chez les victimes de ce mégafeu…
Les habitants de Paradise sont sujets à des traumas qui se traduisent physiquement, comme la perte de mémoire ou le blanchissement des cheveux. D’autres font des cauchemars, des insomnies. Des chiens ont perdu leurs poils. Un vétéran du Vietnam, qui était revenu de la guerre avec un bégaiement à cause de la violence du conflit, l’avait perdu au fil du temps. Mais après l’incendie, il s’est remis à bégayer.
Ce qui est terrible, c’est que si les gens racontent énormément l’évacuation en urgence et la chronologie du mégafeu, cette expérience de la disparition a été éprouvée une deuxième fois par le fait d’être perdu chez soi. Les victimes du Camp Fire ont dû réapprendre à se déplacer dans un paysage devenu illisible, où leur forêt et les lieux familiers, comme les maisons de leurs amis, étaient soudain partis en fumée.
Vous ajoutez aussi que le choc de la disparition du paysage résulte du lien que les habitants de Paradise avaient développé avec la forêt.
Paradise était au milieu d’une forêt de conifères similaire à celles que l’on voit dans l’est de la France, sombres et denses, avec des arbres très hauts. C’était aussi une banlieue pavillonnaire où beaucoup de retraités de la classe moyenne se sont installés pour fuir les métropoles de San Francisco et Los Angeles. Ils avaient le fantasme, grâce à cette forêt urbanisée, de vivre isolés, dans un espace synonyme de tranquillité et où il fait bon vivre.
Les classes moyennes supérieures qui avaient une bonne assurance ont empoché l’argent et sont parties loin.
Il y avait aussi des personnes issues des classes populaires, voire sous le seuil de pauvreté, qui étaient à Paradise pour fuir la crise du logement de grandes villes californiennes.
Les gens avaient l’impression de vivre dans un environnement privilégié et abordable, basée sur une vision idéalisée de la nature : celle d’un beau décor que l’on regarde depuis la baie vitrée de son salon. Paradoxalement, peu de ces gens connaissaient la forêt, ou s’y baladaient. Cela reste une nature que l’on doit maintenir à distance.
À Paradise, l’attachement aux arbres est ainsi plus fort que l’attachement au territoire forestier lui-même, et on retrouve non pas la forêt mais le motif symbolique de l’arbre sur le drapeau de la ville comme sur les tatouages que se sont faits les habitants sur leur peau. La forêt demeure méconnue en tant qu’écosystème complexe, et est perçue comme peuplée d’une vie qui ne doit pas pénétrer nos intérieurs, nous envahir.
Comment les habitants ont-ils vécu après le mégafeu ?
Les classes moyennes supérieures qui avaient une bonne assurance ont empoché l’argent et sont parties loin de la Californie, qui est de plus en plus invivable entre les sécheresses, les incendies et le risque élevé de tsunami.
Les plus précaires qui n’avaient pas pu souscrire une assurance sont restés là, ont vécu en caravane sur leur terrain le temps de se reposer mentalement et d’épargner un peu pour reconstruire leur maison. Ils sont traversés par un récit dominant : celui de l’Américain pionnier, qui sait se relever.
Il y a ici un enjeu de justice environnementale entre les plus aisés qui peuvent déménager et ceux qui n’ont pas d’autre choix que de rester après la catastrophe.
Le feu est devenu dans l’imaginaire un danger là où il était historiquement un phénomène récurrent.
Dans ce territoire, 80 % des habitants sont blancs, plutôt pro-Trump, voire climatosceptiques. Certains ont reconstruit à l’identique leur maison. Pour eux, leur mode de vie pavillonnaire ne doit pas bouger et ce malgré le fait que tout autour d’eux a été calciné, qu’un million d’arbres ont été abattus et qu’à la suite au feu l’eau a été polluée au benzène – un composant toxique qu’on retrouve dans l’essence ou dans les matières plastiques.
Vous dites aussi que cette forêt qui a brûlé est le produit de l’histoire coloniale des États-Unis…
Les populations amérindiennes de la région avaient comme pratique de laisser brûler les feux dits naturels, déclenchés par la foudre. Cela créait des forêts plus clairsemées, en mosaïque. Mais avec la colonisation de la Californie, cette habitude a disparu, car les populations blanches venant d’Europe avaient historiquement peur du feu – associé à l’Enfer –, et avaient la volonté d’avoir la mainmise totale sur la nature.
Un arsenal militaire a été mis en place par les autorités pour éteindre rapidement tout départ d’incendie. Le feu a dès lors été associé à un ennemi intérieur. Pour exemple, dans les années 1940, une campagne des services forestiers américains reprenant l’iconographie de « l’Oncle Sam a besoin de vous » a été déployée avec un ours, Smokey Bear, pour responsabiliser les Américains à propos des incendies.
Cette politique de suppression rapide de tout départ de feu naturel dans des massifs de conifères en continu explique en partie pourquoi on peut avoir désormais des incendies très violents.
Le feu est devenu dans l’imaginaire un danger là où il était historiquement un phénomène récurrent.
Vous avez également effectué un travail d’enquête à Martigues (Bouches-du-Rhône) où un incendie a en août 2020 ravagé 1 000 hectares de terrain. Quels sont les parallèles que vous avez trouvés avec le « Camp Fire » ?
J’ai retrouvé cet attachement des habitants à un paysage figé : celui des pins en bord de Méditerranée. C’est une carte postale qui est le produit du feu car le pourtour méditerranéen français est historiquement composé de forêts de chênes. Mais depuis une trentaine d’années, cette essence n’arrive plus à s’installer durablement, les incendies dans la région ayant favorisé l’installation des pins.
J’ai revu aussi l’expérience traumatique des habitants d’être pris de court par la catastrophe et la non-prise en compte de la réalité écologique du territoire. L’incendie à Martigues a pu atteindre des campings en bord de mer car il est passé par des terres laissées en friche pour compenser les dégâts environnementaux d’un projet d’aménagement. On voit ici encore une fois les dégâts d’une vision anthropocentrée des écosystèmes.
Quelle est votre réaction face à l’incendie qui frappe violemment la Grèce depuis quelques jours ?
J’ai pensé au fait que les événements extrêmes arrivent désormais aussi chez nous et de plus en plus vite. Quand j’étais sur le terrain en Californie, il n’y avait quasiment pas de mégafeux en Europe. Mais les sécheresses, les vagues de chaleur et les vents violents sont de plus en plus fréquents, ce qui fait que les mégafeux sont désormais un problème contemporain extrêmement urgent.
Or, nous n’arrivons toujours pas à penser ces feux, notre lien à la forêt ayant été entièrement coupé et délégué à des services étatiques. Il n’existe aucun savoir autonome en circulation sur comment réagir quand un incendie survient là où on habite.
Face aux mégafeux, nous devons renouer avec l’histoire de nos forêts, et apprendre à cohabiter avec le feu.