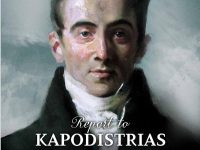Entre la Turquie et la Grèce, les jeux de la force et de l’intimidation

SIMERA La Turquie qui accuse fin août Athènes de « piraterie » en tentant d’« armer » une île démilitarisée. La Grèce qui dénonce l’« agression » d’Ankara qui « viole ses droits souverains ». Le ton monte chaque jour entre les deux pays. Au cœur de l’actuelle discorde : la présence du navire turc de recherche sismique Oruc Reis depuis le 10 août dans la zone économique exclusive (ZEE) grecque, au large de la Crète.
Ces trois dernières semaines, la Grèce et la Turquie ont multiplié les démonstrations de force en Méditerranée orientale. Athènes a ainsi effectué le 26 août des manœuvres militaires aux côtés de la France, Chypre et l’Italie. Deux jours plus tard, la marine turque faisait savoir qu’elle conduirait des « exercices de tir » jusqu’au 11 septembre. Ankara a également annoncé le 1er septembre l’extension des recherches gazières de l’Oruc Reis jusqu’au 12 septembre.
La délimitation du plateau continental fait l’objet d’un conflit larvé entre la Grèce et la Turquie depuis les années 1970. La récente découverte de gisements dans la région a renforcé les revendications territoriales du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une liste de nouvelles mesures restrictives contre la Turquie pourrait par ailleurs être discutée au cours du prochain sommet de l’UE, le 24 septembre.
L’armée grecque, mise en état d’alerte maximale, a « déployé (ses) forces », a annoncé le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, deux jours après la venue du navire Oruc Reis. « Le risque d’accident est élevé lorsque tant de ressources militaires sont rassemblées dans une zone si confinée », a-t-il alerté.
Un bateau de l’armée grecque de retour de l’île de Kastellorizo, le 28 août 2020. © AFP
Le 31 août, une nouvelle étape a été franchie dans la querelle opposant les frères ennemis, la Turquie accusant la Grèce de vouloir « armer » Kastellorizo. Se référant à des photos de l’AFP montrant la venue de soldats grecs sur la petite île située à environ trois kilomètres des côtes turques, Ankara a dénoncé un acte contraire au traité de Paris de 1947 qui prévoit la démilitarisation des 12 îles du Dodécanèse – dont Kastellorizo. Les autorités grecques ont fait savoir qu’il s’agissait d’une simple rotation de militaires, sur les quelque 300 que compte déjà l’île.
Car « il n’y a pas de bases militaires sur les îles [le long de la frontière – ndlr] mais que des installations destinées à se défendre d’une éventuelle attaque turque, précise Georges Kaklikis, ancien diplomate et consultant à la Fondation hellénique pour l’Europe et la politique étrangère (Eliamep), à Athènes. La Turquie n’est pas partie contractante au traité de Paris qu’elle invoque. Par ailleurs, la Grèce ne peut renoncer à son droit naturel et légal de se défendre à un moment où la Turquie viole de manière flagrante la Charte des Nations unies », en pénétrant notamment dans les eaux de la Grèce.
L’occupation de la partie nord de Chypre par la Turquie depuis 1974 justifie la méfiance d’Athènes à l’égard des velléités d’expansion du pays voisin. Alors que la Grèce réclame le départ de l’armée turque, Ankara est seule à reconnaître la République turque de Chypre nord (RTCN).
« La politique expansionniste d’Erdogan est une menace systémique pour toute l’Europe », s’inquiète Angelos Syrigos, député de la Nouvelle Démocratie (parti de droite au pouvoir) qui fait le parallèle avec l’Allemagne de 1938. « À l’époque, Berlin voulait se retirer du traité de Versailles [de 1919, entre l’Allemagne et les Alliés – ndlr]. Aujourd’hui, Ankara ne respecte pas celui de Lausanne [de 1923, qui précise le tracé des frontières de la Turquie], il existe des similitudes entre les deux situations. »
Les positions alertes du gouvernement grec sont largement relayées dans la presse pro pouvoir qui fait régulièrement sa une sur les « attaques », « provocations » ou encore la « politique néo-ottomane » du « Sultan Erdogan ».
« Les Grecs réagissent de manière intense, car le pays est encore très marqué par son histoire liée à la Turquie : des siècles sous ce qu’ils qualifient de “joug ottoman” (XIVe- XIXe siècle) ou le déplacement des populations de 1923 (l’expulsion de plus d’un million de Grecs d’Asie Mineure) », rappelle le journaliste et chercheur spécialiste de la Grèce et des Balkans, Christophe Chiclet.
Ces dernières décennies plusieurs épisodes avaient déjà amené les deux pays membres de l’Otan au bord du conflit. En 1987, la Grèce avait rappelé ses réservistes après la menace d’envoi d’un navire de recherche sismique turc au large de l’île grecque de Samothrace (nord-est). La Turquie réagissait alors à l’annonce d’une compagnie pétrolière travaillant pour le compte de l’État grec voulant effectuer des forages dans une zone contestée de la région. La tension était toutefois vite retombée, avec une annonce réciproque de renoncer à la prospection.
L’actuelle crise est la plus longue qu’aient connue les voisins depuis la crise chypriote en 1974. « Le rapport de force a évolué. Il y a trente ans, l’armée de terre turque n’était pas une armée mondialisée comme aujourd’hui, c’était une armée de guerre civile », explique le chercheur Christophe Chiclet. L’affaire a aussi pris une dimension internationale, la ruée vers le gaz méditerranéen engageant également Chypre, Israël ou l’Égypte et plusieurs compagnies pétrolières étrangères.
Le rôle de plus en plus évident de l’extrême droite nationaliste dans la détermination de la politique étrangère turque semble justifier les inquiétudes d’Athènes. En perte de vitesse depuis 2015, le parti présidentiel de la justice et du développement (AKP) doit désormais compter sur le Parti de l’action nationaliste (MHP) pour conserver la majorité absolue au Parlement.
Après le coup d’État manqué de juillet 2016, Erdogan a également été contraint de ressortir de la disgrâce dans laquelle ils étaient tombés des officiers issus de cette mouvance, pour contrer l’influence des putschistes et remplir les vides laissés par les purges. Le contre-amiral Cem Gürdeniz, considéré comme le théoricien du nouvel activisme armé de la Turquie, à l’œuvre de la Libye à l’Irak, est l’un d’eux. Sa doctrine, la Patrie bleue, affirme que la sécurité de la Turquie commence par des « lignes avancées » hors de ses frontières, qui doivent être défendues en faisant primer la force militaire sur la diplomatie classique.
Pourtant, dans le concert des accusations d’expansionnisme ou de restauration ottomane proférées à l’encontre de la Turquie et confortées par les rodomontades bellicistes des dirigeants d’Ankara, certains analystes appellent à garder la tête froide.
« On peut critiquer les méthodes singulièrement agressives d’Erdogan, mais les dirigeants turcs faisaient déjà ça avant lui : toujours surenchérir, tirer sur la corde jusqu’au dernier moment puis, quand la corde est prête à rompre, s’arrêter et se rabibocher avec ceux qu’on a agonis d’injures et de critiques », rappelle ainsi Didier Billion, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), à Paris.
« Toutes les revendications turques ne sont pas illégitimes »
Si les démonstrations de force de l’armée turque – comme le déploiement d’une quinzaine de vaisseaux aux abords de Kastellorizo, en juillet, ou le simulacre d’interception de F-16 grecs par des appareils turcs fin août – impressionnent, et c’est bien leur but, ces provocations, minutieusement calibrées, ne doivent rien au hasard. Pas plus que les campagnes de prospection des navires turcs d’études sismiques et de forage.
« Je doute que toutes les ressources encore à découvrir en Méditerranée orientale soient situées dans des zones qui ont une importance stratégique sur le plan géopolitique. Et pourtant, c’est là que la compagnie pétrolière turque TPAO concentre ses recherches », commente Nikos Tsafos, analyste pour CSIS Energy, basé à Washington. « Ce n’est pas comme ça qu’on fait sérieusement de l’exploration. Les bateaux de TPAO sont plutôt là pour prouver quelque chose sur le plan politique. »
Sous la protection de la marine turque, TPAO avait multiplié en 2019 les campagnes de prospection au large de la République de Chypre, qu’Ankara ne reconnaît pas et à qui elle dénie le droit d’exploiter les gisements de gaz découverts dans son giron – Aphrodite, Calypso et Glaucus-1 – sans organisation préalable du partage des dividendes avec la RTCN.
Mais au cours des derniers mois, les Turcs ont concentré leurs efforts plus à l’ouest : à Kastellorizo, dont la localisation « coupe » le vaste plateau continental que revendique Ankara ; près de Rhodes, aux confins de ce même plateau tel que défini en novembre 2019 par un accord de délimitation maritime conclu avec la Libye, qui ne reconnaît aucune ZEE aux îles grecques.
L’exercice de pressions sur la Grèce semble en effet potentiellement plus porteur de dividendes que les tentatives d’intimidations par Ankara de Chypre, où toute avancée semble conditionnée à une hypothétique réunification de l’île. Face à la Grèce, « la Turquie utilise une politique de force à la fois pour démontrer qu’elle ne va jamais accepter l’imposition unilatérale d’un partage de la Méditerranée orientale qui se fait sans elle, et aussi pour forcer Athènes à entamer des négociations bilatérales avec elle », résume Sinan Ülgen, directeur du centre de recherches turc EDAM.
Selon cet analyste expérimenté, Ankara souhaite remettre sur les rails les négociations exploratoires menées par les deux pays entre 2002 et 2016, qui ont été interrompues par le coup d’État raté, la Turquie reprochant alors à la Grèce d’accueillir des putschistes en fuite. « L’objectif des négociations n’est pas de résoudre immédiatement le problème, mais de se mettre d’accord sur un cadre normatif qui sera ensuite soumis à une cour internationale chargée de trancher », précise-t-il.
Ülgen souligne le relatif succès de cette politique musclée, puisque les pourparlers ont bel et bien été « revitalisés le mois dernier, à l’initiative de l’Allemagne ». Il admet cependant que les positions turques, telles que définies dans l’accord avec la Libye, sont à dessein « maximalistes ». « Au final on devrait parvenir à un tableau dans lequel la Turquie concédera une ZEE limitée à des îles comme Rhodes et la Crète, tandis que la Grèce devra admettre que Kastellorizo n’a droit à aucun plateau continental », estime le géopolitologue.
À Paris, Didier Billion va dans le sens de son confrère turc. « On connaît la tendance plutôt contre-productive d’Erdogan à en rajouter. Mais sur le fond, il faudrait faire preuve d’un peu de raison et considérer que toutes les revendications turques ne sont pas illégitimes », estime-t-il. « Que je sache, le droit international maritime s’applique de manière spécifique aux îles anglo-normandes [qui n’ont pas de ZEE – ndlr] parce que la configuration géographique l’impose. »
Ce constat, le chercheur l’adresse en particulier à la France, qui, entre volonté de solder ses comptes avec une Turquie rivale en Libye et en Syrie, et espoir de faire progresser à travers le dossier gréco-turc son projet d’une Europe de la défense, s’est résolument rangée du côté de la Grèce.
Paris a en effet envoyé le 12 août deux chasseurs Rafale et deux bâtiments de la marine nationale pour un renfort « temporaire » aux côtés des Grecs en Méditerranée orientale. La « politique expansionniste qui mêle nationalisme et islamisme [d’Erdogan – ndlr] (…) n’est pas compatible avec les intérêts européens », a ajouté Emmanuel Macron le 29 août dans les pages de l’hebdomadaire Paris Match, suscitant les louanges des médias grecs pro-gouvernementaux à l’égard de l’« allié » français.
« Je préfère clairement la politique actuelle de [la chancelière allemande Angela] Merkel sur ce dossier. C’est une volonté de faire baisser les pressions, de tenter d’initier des contacts, un dialogue. Je pense que c’est la bonne méthode », affirme le chercheur Didier Billion. « J’espère qu’elle arrivera à ses fins et que Macron pourra dire que c’est aussi grâce à notre politique de fermeté qu’on est arrivés à ce résultat. »
Du côté des autorités grecques, on salue l’attitude de Paris, qui « a compris que la politique d’Erdogan était bien une politique stratégique d’expansion et non un simple enjeu économique, comme le pense l’Allemagne », résume le député Angelos Syrigos.
Derrière cette présence française, l’hypothèse de l’acquisition d’avions de combat Rafale par la Grèce resurgit. Paris souhaiterait vendre entre 10 et 18 Rafale, selon plusieurs médias grecs conservateurs ou encore l’agence Reuters qui évoque « des pourparlers », le 1er septembre. Il n’y a toutefois encore aucune confirmation officielle.
En montrant les muscles, Erdogan a peut-être une petite chance de faire bouger les lignes en faveur de son pays. Mais ses méthodes portent aussi en elles les ferments de l’échec. « Le risque, c’est que, des deux côtés, la rhétorique hypernationaliste prenne en otage les gouvernements et que le conflit devienne ingérable », prévient le directeur du centre de recherches turc EDAM Sinan Ülgen. « Si on veut résoudre le conflit, il faut se préparer des deux côtés à des concessions. Ce n’est pas ce que fait la rhétorique de la Patrie bleue. »
En Grèce, le dialogue semble en effet impossible en suivant cette doctrine. « Nous ne pouvons pas négocier quoi que ce soit sous la menace, tant que la Turquie restera dans nos eaux territoriales », conclut le député Angelos Syrigos.