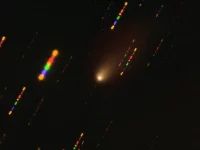Interview. Guy Vallancien chirurgien: « Nous allons vers un homme mi-chair, mi-machine »

ROBOTS. De la télémédecine à l’augmentation de soi, le chirurgien Guy Vallancien, auteur de « La Médecine sans médecin ? Le numérique au service du malade », décrit les bouleversements récents et à venir.
La rencontre a lieu à l’université Paris Descartes ; pas dans les couloirs jaunis, comme sur la photo, mais sur la moquette de l’Ecole européenne de chirurgie. Cette école, c’est Guy Vallancien qui l’a fondée.

Ce chirurgien urologue, bientôt 70 ans, n’a pas pris sa retraite. Faut comprendre : dans ce métier, dit-il, on ne cesse de s’améliorer, alors lui ne décroche pas, pas encore.
Membre de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie nationale de chirurgie, officier de la Légion d’honneur, Guy Vallancien, c’est un gradé. Il a récemment sorti un livre :« La Médecine sans médecin ? Le numérique au service du malade »(éd. Gallimard), un ouvrage qui le change des rapports ministériels qu’il a pu écrire.
On y trouve une réflexion sur la manière dont le système sanitaire doit évoluer pour intégrer au mieux les évolutions technologiques :
« J’espère que, pour les prochaines élections présidentielles, les candidats liront mes propositions. »
Libérales, progressistes, en défense des industries, technophiles, les idées de Guy Vallancien vont en énerver plus d’un (au cours de notre entretien, il a même dit qu’il détestait Pierre Rabhi ; dire ça à Rue89, c’est plutôt osé). Il le sait d’ailleurs : 25% des gens vont apprécier son bouquin, 25% vont dire qu’il a perdu la tête, et 50% vont dire « oui, pourquoi pas » mais ne bougeront pas leurs fesses.
Nous, le Guy Vallancien qu’on a voulu rencontrer, c’est le chirurgien urologuetweeto, celui qui a vu ses outils changer au fil de plusieurs décennies de carrière et qui fait de la futurologie dans son bouquin.
Tout au long de votre ouvrage, vous dénoncez les casseurs de progrès. Vous dites : « Dans l’Antiquité, la médecine était ignorante, les hommes la sacralisaient. Lorsque, au XIXe siècle, elle devint savante, ils la respectèrent. Aujourd’hui, alors qu’elle est efficace, ils la suspectent ! » Qu’est-ce qui cloche ?
Guy Vallancien : Je pense que nous sommes entrés dans une civilisation de tristesse. Il y a comme un rejet de la science. On oublie que nous n’avons jamais aussi bien vécu qu’aujourd’hui.
Il ne faut pas oublier qu’en 1033, à Cluny, en Bourgogne, les Français mangeaient de la chair humaine à cause de la famine (l’un d’entre eux en vendait même au marché). En 1400, ni la ménopause ni Alzheimer n’existaient car on mourrait avant d’avoir atteint 40 ans. Aujourd’hui, on va globalement mieux.
Etes-vous une sorte de positiviste ?
Je ne suis pas un béni-oui-oui de la science. Je dis simplement qu’elle est un outil nous servant quand nous sommes confrontés à une crise.
Il ne faut pas se laisser tromper par les « anti-sciences », bien souvent d’ailleurs anticapitalistes. Et le capitalisme est, à ce jour, le système économique favorisant le progrès. Avec, malheureusement, tous les défauts qu’il a, comme la surenchère ou la financiarisation insupportable.
Si « on va globalement mieux », si nous ne sommes pas dans une crise sanitaire majeure (je parle de la France), à quoi il sert, le progrès ?
En tant que médecin, mon but est de diminuer la souffrance et je vois encore un tas de gens malades, atteints du cancer par exemple. Nous n’avons pas encore gagné la partie. C’est pour ça qu’un débat comme « Faut-il se faire vacciner ? » m’énerve au plus haut point.
C’est bien parce qu’on est dans un monde où il n’y a plus de polio estropiant des gamins qu’on peut se permettre de remettre leur efficacité en doute. Les gens n’ont pas de vision collective. Si un pourcentage important de gens refusent la vaccination, les maladies peuvent repartir à une vitesse folle. L’absence de mémoire est flagrante.
Comment a évolué votre métier de chirurgien au cours des dernières décennies ?
Si je regarde ce que je faisais quand j’étais jeune interne et ma pratique de la chirurgie aujourd’hui, ça a complètement changé. A l’époque, dans les salles d’opération, il y avait une table et des instruments classiques, comme des ciseaux et des pinces. Le seul instrument électrifié demeurait le bistouri électrique.
Aujourd’hui, j’opère avec un échographe me permettant de repérer les tumeurs, je les extrais d’une prostate avec les bras robotisés d’une machine, ou à l’aide de lasers. Je ne « joue » plus du tout avec les mêmes instruments.
Lors d’un reportage en Charente, nous avons rencontré un garagiste regrettant de ne plus « mettre les mains dans le cambouis », à cause de l’électronique. Si on transpose ça au corps, vous, ça ne vous manque pas ?
Mes mains me servent de moins en moins. Cette tendance va s’accentuer. Aujourd’hui, avec les robots type Da Vinci (on appelle ça des télémanipulateurs), j’opère grâce à des joysticks.
Demain, on va complètement robotiser un certain nombre d’opérations standardisées.
Dans ma spécialité, l’urologie, on pourrait d’ores et déjà programmer larésection endoscopique de la prostate, c’est-à-dire enlever des petits morceaux à l’intérieur pour faciliter le jet urinaire.
Avec les scanners et les IRM, on rentrerait les dimensions exactes de l’organe dans la machine, et un système robotisé se chargerait seul de l’extraction.
Et vous devenez inutile…
Non, les opérations nécessiteront toujours la présence humaine. Parfois, je n’aurai qu’un rôle de surveillant, vérifiant le bon déroulement d’une ou plusieurs opérations, dans une sorte de tour de contrôle. En revanche, s’il s’agit d’un gros chantier opératoire, une longue opération, l’humain s’en occupera.
Pour moi, la technologie nous servira à dégager du temps pour revenir à l’essentiel de notre profession : l’échange et la confiance.
Mon rôle sera davantage de l’ordre relationnel, celui de « décideur » et non plus seulement d’« effectueur ». J’ai en partie perdu ce lien à cause des nombreuses tâches techniques et administratives qui ne devraient pas être miennes.
Vous savez, quand un patient discute avec nous de sa maladie, il dit souvent : « J’ai compris ce qu’il m’arrive, mais vous, docteur, qu’est-ce que vous feriez à ma place ? » Cette question, et la décision qui en découle, elle est la clef de notre métier.
Dans votre ouvrage, vous expliquez qu’une nouvelle médecine émerge grâce au numérique : la « médiamédecine ». Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une médecine qui éloigne le malade du chirurgien, voire plus globalement du médecin, tout en renforçant les moyens qu’il a d’agir sur la maladie.
Le premier exemple remonte à 1816. René Laënnec, praticien breton, roule deux feuilles de papier ensemble pour écouter les bruits de poumons et le cœur d’une patiente obèse. Il invente le stéthoscope.
Au lieu de faire une auscultation « immédiate » – coller son oreille au thorax –, il fait une auscultation « médiate » – à distance. Aujourd’hui, cette « médiamédecine » est partout.
Je l’ai dit tout l’heure, mes mains sont de moins en moins utiles lors d’une opération, tout comme mes yeux et mes oreilles. C’est l’échographie qui montre la tumeur, ce sont les examens qui montrent le taux de sucre. Le diagnostic arrive bien avant les symptômes, au point qu’un patient m’a déjà dit :
« Mais, docteur, êtes-vous sûr que ces examens sont les miens ? Une erreur d’étiquetage peut-être ? Car je ne me sens pas mal. »
L’intérêt de la technologie, là-dedans, c’est d’apporter une meilleure connaissance, et à partir de cette connaissance, la possibilité pour les médecins de faire les meilleurs choix, de prendre les meilleures décisions en termes de diagnostics et de traitements.
Cette distance, vous me la décrivez dans le cadre d’une opération. Mais peut-on imaginer un éloignement encore plus fort entre le patient et le médecin, notamment pendant la phase du diagnostic ? L’avènement, par exemple, de la télémédecine ?
On y est déjà ! J’ai l’expérience d’une consultation avec un malade, à 500 km de Paris, par Skype. C’est tout bonnement génial. On prévoit une heure et hop, on clique, je suis dans mon bureau, lui chez son généraliste, et ensemble on échange sur la maladie du patient et son traitement.
Cela évite l’angoisse d’un rendez-vous à Paris, la queue à l’hôpital, la place de parking à trouver. La télémédecine offre la réponse appropriée avec le moins de dépense énergétique humaine.
Pour moi, la consultation à distance peut être aussi forte que la « présentielle ». Nous y voyons aussi la personne et ses fragilités quand bien même nous ne la touchons pas.
Bien sur, la télémédecine n’est pas applicable à toutes les situations. Un dermatologiste, par exemple, a besoin de voir la personne, la toucher et vérifier qu’il n’y a pas de boutons partout. On va vers un subtil équilibre entre le « présentiel » et le « non-présentiel ».
On parle depuis tout à l’heure de l’impact de la technologie sur le travail du médecin, ou du chirurgien. Mais qu’implique-t-elle sur le patient ?
On voit déjà que le patient est de plus en plus intéressé par ce qui lui arrive, il cherche à comprendre, sur Internet notamment, de quel mal il souffre. Il a la volonté de participer à l’action, à la décision de son traitement. Cela devrait augmenter avec la Big Data.
Expliquez…
Nous travaillons aujourd’hui sur des systèmes capables de faire des diagnostics grâce aux données recueillies. J’appelle ça les « médecins de synthèse ». Dans très peu de temps, le patient possédera sur son ordinateur une application « Ma santé ».
Il y rentrera toutes les « données » le concernant : sa taille, son poids, son alimentation, le nombre de ses rapports sexuels, ses hobbies… on peut tout imaginer. Cela permettra de définir son profil, de le « pixelliser ».
Et à partir de cette base de données, s’il ne se sent pas bien, l’application lui posera une liste de questions : avez-vous vomi ? Où avez-vous mal ? Depuis combien de temps ? etc. Si c’est bénin, l’application lui prescrit un médicament en autoprescription. Si c’est plus sérieux, elle lui envoie un médecin.
J’imagine que les objets connectés, type l’Apple Watch qui fait beaucoup parler d’elle, vont aussi récolter des données utilisables ?
Honnêtement, concernant les applications du type « Self Quantified » [en français, on peut traduire par « l’automesure de soi », ndlr], les plus avertis sont conscients que nous nous trouvons dans une bulle, qui va bientôt exploser. 90% des applications proposées aujourd’hui vont disparaître.
Moi, j’en ai une sur mon iPhone, ça calcule le nombre de pas marchés. J’en conviens, c’est très amusant à regarder au début. Et après un mois, je me suis lassé et ne regardais plus le compteur.
En revanche, les applications destinées aux patients chroniques, comme pour quelqu’un souffrant d’un diabète et équipé d’un pancréas artificiel, celles-ci vont être primordiales.
Le malade va pouvoir contrôler quotidiennement son taux de sucre, de façon optimale. S’injecter la bonne dose, au bon moment.
Pareil pour les patients atteints de problèmes respiratoires. lls vont pouvoir calculer le taux de CO2 dans l’air et éviter les zones hautement chargées en dioxyde de carbone.
Ces objets connectés aux bonnes applications vont permettre d’améliorer l’état constant du malade. Il ne subira plus les pics « ça va bien », « ça va pas bien ».
Et vous ne craignez pas que ces données soient utilisées à mauvais escient par des entreprises privées (au pif, les assurances), ou des administrations ?
Là-dessus, il faut vraiment arrêter de dramatiser. Tous les jours, nous naviguons sur nos ordinateurs. Oui ! Nous sommes suivis à la trace, alors qu’on en fasse un petit peu plus ou un petit peu moins, je m’en bats les flancs !
Le patient qui souffre s’en fiche de la Cnil [Commission nationale de l’informatique et des liberté, ndlr] ou de la protection de ses données. Par mail, il m’envoie déjà des documents confidentiels : l’image du scanner, de l’IRM, les résultats des examens biologiques. Savoir qu’un Big Brother va jeter un coup d’œil sur leurs données, ils s’en foutent. Ce qu’ils veulent, c’est être soignés.
Ces données aussi, elles doivent nous permettre d’accroître l’efficacité de la santé publique. En France, nous possédons un nombre incroyable de données de santé (la Cnam et l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation ou ATIH). En les utilisant, un cas de crise sanitaire, comme le Mediator, ne pourrait plus arriver. En croisant les données, notamment celles de la Caisse d’assurance maladie qui connaissait le problème, on se serait rendu compte que des généralistes prescrivaient le médicament à des non-malades, comme coupe-faim.
Tout à l’heure, vous parliez d’un homme avec un pancréas artificiel. Par définition, il s’agit d’un cyborg, un humain avec des greffes mécaniques. La médecine nous amène-t-elle sur cette voie-là ?
Je pense effectivement que nous y allons. C’est une vraie question de société et je déplore qu’elle n’intéresse ni les citoyens ni les politiques en France.
Le scénario est déjà écrit : nous allons commencer par nous réparer. Comme ce patient équipé d’un cœur artificiel [décédé le 2 mai, neuf mois après son implant, ndlr], cet autre équipé de prothèses audio, de hanches artificielles…
A partir du moment où l’on sait se réparer, et on progresse vite, on saura s’augmenter. Nous allons vers un homme mi-chair, mi-machine.
Réparer un homme, pour lui endiguer tout handicap, c’est une chose ; l’améliorer, c’en est une autre.
On détournera les procédés de réparation pour nous augmenter. Comme ces militaires qui décideront un jour d’avoir besoin d’une vision infrarouge ou d’une audition ultrasons.
La question, c’est : à quoi ça va nous servir ? Pourquoi être augmenté ? Dans quel but ? Quelle est ma finalité d’homme ?
Des questions que se posent les transhumanistes. Dans votre livre, d’ailleurs, vous dites que ses « adeptes considèrent le handicap, la maladie, la souffrance, le vieillissement et la mort » comme « inutiles, indésirables ». Vous partagez ce point de vue ?
Non, ils sont notre lot de finitude. Si j’emploie des termes informatiques, je dirais que les humains sont bourrés de bugs et que, jamais, nous n’atteindrons la perfection. Les transhumanistes, eux, veulent limiter les bugs.
Si je poursuis ma comparaison avec l’ordinateur, je regrette en revanche que la nature ait mal « programmé » notre mort. Le rêve de tout homme, ça serait de « crasher » comme un ordinateur. Rideau d’un coup, écran noir, type infarctus au lit sans déchéance progressive.
Vous considérez-vous comme un transhumaniste ?
Non, je ne suis pas un transhumaniste. Ce courant, extrêmement puissant aux USA, n’a pas encore franchi l’Atlantique, mais ça commence à venir [aux élections législatives britanniques, on a découvert l’existence d’un jeune parti transhumaniste, ndlr].
En France, il y a quelques personnes bien plus transhumanistes que moi, comme Laurent Alexandre, un ancien interne à moi en urologie.
Le plus important, c’est d’alerter les politiques sur ces enjeux, pour éviter des choses comme l’eugénisme forcené.
Mais pour être honnête, aujourd’hui, nous sommes déjà dans l’eugénisme : nous avortons tous les poly malformés détectés pendant une échographies.