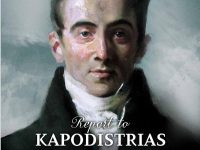Life style. Christiana, le jour où les hippies sont devenus des hipsters

DROP OUT. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le réveil est difficile pour les Danois. L’attitude coopérative et passive de leur gouvernement, en s’alignant dès le début sur les politiques du Reich, leur reste en travers de la gorge.
Difficile pour eux d’imaginer un instant leur patrie comme un Munster-Protektorat ; le « protectorat modèle » pour le royaume du Führer. L’économie danoise est dans le sillage de l’après-guerre. Le moral est en berne. Les enfants ne se reconnaissent plus dans la génération silencieuse de leurs parents. Lassés d’entendre dire qu’il est impossible de critiquer ce qu’ils ne pourront jamais comprendre. En 1970, flotte sur le Danemark une crise du logement sans précédent. Cette fois-ci, les descendants ont bien grandi. Par protestation, mais surtout par nécessité, ils resserrent les rangs. C’est ainsi qu’une poignée de squatteurs et de sans-abri décident d’occuper l’ancien terrain militaire de la caserne de Bådmandsstræde, situé au sud-est de la ville. Cette même armée qui, contrairement à celles des différents pays occidentaux occupés par l’Allemagne nazie, n’a jamais combattu aux cotés des Alliés. L’enjeu est de taille et certains Danois l’ont enfin compris. Le 4 septembre 1971, le bastion est pris d’assaut par des dizaines de jeunes hippies ayant le feu au ventre. Les barrières sont détruites, puis franchies. Christiania est né. En s’autoproclamant « ville libre », elle devient ainsi un quartier autogéré au sein de la capitale danoise. Autant dire une expérience unique en Europe qui tente de résister encore et toujours à l’envahisseur étatique.
Seulement voilà, après quarante années à cultiver la contre-culture, les pétales ont fini par faner. Il sera très difficile d’en glisser un dans ma chevelure ébouriffée. Rencontres avec l’autochtone, ou du moins ce qu’il en reste.
Julie, le lapin blanc de Copenhague
Ce quartier n’est pas facile à trouver pour quelqu’un qui n’a jamais mis les pieds sur le sol danois. La langue, le mode de vie, le vif intérêt pour les bicyclettes, sont autant de barrières à franchir. Dans ce qui ressemble en tout et pour tout à une zone industrielle désertique, une silhouette avance dans le crépuscule, d’un pas assuré. Julie, la quarantaine, est une femme dont le visage buriné laisse entrevoir les nombreuses frasques d’antan. Ses cheveux longs d’une couleur noir corbeau font ressortir son teint pâle et fatigué. Une frange effilée et mal taillée, un jean levi’s troué taille haute, un t-shirt blanc jauni, tant d’éléments rappelant étrangement une certaine Nina Hagen. Julie habite Copenhague depuis une dizaine d’années, « pour le boulot ». Pourtant, elle fait partie de celles et ceux qui, une fois la journée terminée, se rendent à Christiania pour décompresser. Décompresser, dans la langue danoise, cela veut souvent dire fumer de l’herbe. « Je vais rejoindre une très bonne amie Christianite. Cela fait un bon moment que je ne l’ai plus vue. Là-bas, tu peux acheter de quoi te rouler des joints, t’asseoir dans un parc ou à la terrasse d’un bar et fumer, tranquille. Personne ne dira rien… ». Les badauds de passage en ont tout leur soûl. Mais n’allez pas croire que l’on peut trouver des drogues dures, comme c’était le cas avec l’héroïne à la fin des seventies. « Tout ça c’est terminé ! ». Cela tombe à pic, l’idée ne nous avait même pas traversé l’esprit. Elle avance en direction du bastion par des chemins de traverse. Nous la suivons, essoufflés, comme le lapin blanc imaginé par John Tenniel. Arrivés devant un imposant pont en bois, Julie me fait signe, avec un large sourire que c’est là-bas que se trouve Christiania. Un étui en plastique contenant un joint pré roulé gît sur la première planche. « You’re welcome ! » s’amuse-t-elle à nous dire. Julie est en retard. Elle montre le cadran de sa montre et s’en va comme elle est venue. Une drôle de façon de souhaiter la bienvenue à des inconnus.
Kurt, l’autochtone
Sur un banc du Woodstock bar, seul vestige de la résistance hippie, j’entonne une mélodie à l’harmonica qui sonne désespérément faux. Un homme s’assoit à mes cotés. Son visage est rongé par l’excès, les cheveux longs et gras, un bandeau serré sur le front. « I’m a fuckin’ hippy », nargue-t-il en me souriant. Kurt est l’un de ces trente millions de baby-boomers américains. Originaire du Kentucky, il fait partie des 870 privilégiés qui versent l’équivalent de 150 euros au gouvernement danois pour loger au sein de cette expérience libertaire unique. Tout en me tendant sa bouteille de porto quasi pleine, nous entamons une discussion passionnée et sincère. Il me parle de Dylan, de la société de consommation, du Human Be-In. J’épanche de plus en plus mes réticences sur l’héritage de la contre-culture américaine des sixties dans cette cité. Kurt semble les comprendre. Il m’explique que « tout est de la faute des dealers de Pusher Street, – cette rue centrale où cannabis et haschich s’y négocient, sur des étalages, jusqu’à 21 euros le gramme. Ils protègent ce quartier avec un service d’ordre. Il n’est pas rare non plus qu’ils fassent appel à des casseurs, comme lors des affrontements entre la police et les habitants en décembre 2009 ». Kurt reçoit un message sur son portable dernier cri. Il dit qu’il repassera nous voir dans quelques heures. Pour preuve, il nous confie son Porto. Je le scrute s’élancer dans une foule de touristes, en titubant. Sur la table, la bouteille d’alcool est bien là. Mais elle est complètement vide. On le croisera, quelques jours plus tard, totalement ivre, en train de parler à l’un des murs du Woodstock.
Anaïs, la touriste française
Anaïs est une très bonne amie de Kurt. Elle nous assure qu’il est le « père qu’elle n’a jamais eu ». Cette jeune française, originaire de Bretagne, a suivi très tôt l’enseignement de la riche école buissonnière. Depuis, elle erre de festival en festival, vivant de petits boulots et des cueillettes saisonnières. Comme chaque été, elle (part)est là pour se dorer la pilule, pendant plusieurs semaines, à Christiania. « Cela fait cinq ans que je viens passer des vacances ici. Je vis dans un camion que j’ai réaménagé. C’est pas le luxe, mais cela me plaît ». Vivre d’amour et d’eau fraîche serait-il toujours possible ? « Pour la première fois, on m’a posé un papier sur mon pare-brise : on me disait de dégager d’ici, qu’on ne voulait pas de moi ». Anaïs n’a pas compris. Elle sait que de nombreuses tentes, hissées aux alentours de cet havre de paix – le camping dans Christiania étant interdit – sont vandalisées chaque année. Notre guitoune est plantée sur l’une des berges que nous avait conseillée Julie. On verra bien ce soir. En attendant on peut comprendre les Christianites. Ils ne veulent pas voir leur « ville » devenir un Muséum d’histoire naturelle ayant pour vocation de conserver les hippies dans le formol des drogues. Pourtant, selon Anaïs, « chacun d’entre eux en tire un revenu confortable ». En effet, les dealers réinvestissent une grande partie de leur prébende dans les commerces locaux. Tout comme ce marché, installé sur la principale place du quartier, rassemblant pléthore d’objets ethniques et d’accessoires pour fumer. Les mêmes que l’on retrouve d’ailleurs partout en Europe. On préfère écouter la jeune baba jouer de l’accordéon, à la terrasse du Woodstock. Même si à Christiania, comme ailleurs, l’été de l’amour semble bien terminé.
Olivier, le fou en liberté
Il est l’heure de reprendre la route. En quittant Christiania, à l’abri des regards indiscrets, je découvre une valise rouge posée à coté de deux poubelles bien remplies. A l’intérieur, beaucoup d’affaires sont trempées par l’averse de la veille. Poussé par la curiosité, on décide tout de même de fouiller à l’intérieur. Elle appartient à un certain Olivier, français lui-aussi, qui après avoir fait un saut dans un HP près d’Orange, semble avoir jeté son dévolu sur Christiania. Difficile de brosser le portrait d’un homme par rapport au reste de son baluchon. Un pendentif Peace & love, des disques de Tryo ainsi que l’opus Meddle des Pink Floyd – qui met fin au tournant psychédélique du groupe. Ces preuves montrent qu’Olivier n’est pas venu ici par hasard. Mais comment sa valise s’est-elle retrouvée ici ? Qu’est-ce qui a poussé cet homme à rejoindre cette communauté ? Y est-il arrivé ? Ces questions restent aujourd’hui sans réponses. Olivier, si tu lis ces quelques lignes, donne-nous de tes nouvelles ! On a tellement écouté l’album de David Gilmour et de Richard Wright sur le chemin du retour qu’on doit en discuter ensemble. Et si tu ne le fais pas pour nous, fais-le au moins pour ta mère qui doit être morte d’inquiétude.
En 2011, un vent de folie s’est abattu dans les ruelles de Christiania. La ville venait tout juste de souffler les quarante bougies de son gâteau d’anniversaire, mais déjà le 18 février sonnait la fin de son indépendance. En effet, la Cour suprême danoise rejetait en appel, le jugement de 2009, qui permettait à l’État le contrôle total du quartier et donc de pouvoir priver tous les Christianites de leur habitation. Après un bras de fer interminable, le 21 juin 2011, squatteurs et autorités ont enfin pu statuer sur un accord. L’État leur a offert la possibilité de racheter leur « maison », pour la « modique » somme de 469 euros le mètre carré. La citadelle devra également stopper tout deal illégal, et permettre aux touristes de prendre librement des photos de ce lieu alternatif.
Texte et photos: Julien Bouisset.