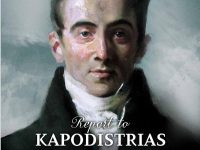Peinture. Gustave Courbet. Le communard et les épreuves.

Courbet et la Commune (1870-1871) A la chute du Second Empire, Courbet est élu Président de la Fédération des artistes. Alors que Paris subit le siège des armées prussiennes et que beaucoup fuient la capitale, Courbet reste sur place. Lui qui avait déjà suivi avec intérêt les événements de 1848 garde sans doute à l’esprit le souvenir de son grand-père, sans-culotte en 1789.
En février 1871, son engagement se confirme : il se présente aux élections législatives, sans succès. En avril 1871, la commission exécutive de la Commune de Paris le charge de rouvrir les musées parisiens et d’organiser le Salon.
Elu au Conseil de la Commune, Gustave Courbet n’est cependant pas garde national et ne participe donc pas aux combats. Arrêté par les versaillais le 7 juin, le peintre est condamné en septembre à 6 mois de prison et 500 francs d’amende auxquels s’ajoutent 6 850 francs de frais de procédure. La sentence est plutôt clémente au regard des peines de mort et de déportation qui frappent d’autres communards… mais ce n’est que le début des ennuis judiciaires.
Le temps des épreuves (1871-1877)
La démolition, le 16 mai 1871, de la colonne Vendôme érigée par Napoléon Ier, devenue le symbole du Premier et du Second Empire, avait été votée par la Commune le 12 avril 1871. Soit, quatre jours avant l’élection de Courbet. Mais l’artiste avait eu l’imprudence de lancer en septembre 1870 une pétition dans laquelle il réclamait au gouvernement de la Défense nationale de bien vouloir l’autoriser à « déboulonner » la colonne.
En 1873, à la suite d’un nouveau procès, Courbet est jugé responsable. On le condamne à rembourser les frais de reconstruction de la colonne s’élevant à 323 091 francs. Courbet perd une grande partie de sa fortune et part s’installer en Suisse de peur d’être à nouveau emprisonné.
Durant son exil, l’Etat saisit ses biens, surveille ses amis et sa famille. L’instabilité politique des premières années de la IIIe République n’est guère favorable aux anciens communards. Courbet refuse de revenir en France avant le vote d’une loi d’amnistie générale.
Malgré l’accueil bienveillant qu’il reçoit en Suisse, Courbet sombre dans cet exil. Il se perd dans l’alcool, ne produit plus que très rarement des oeuvres dignes de son talent. Les problèmes d’argent et les procédures à mener deviennent une obsession. Il meurt le 31 décembre 1877 à la Tour-de-Peilz, quelques jours après que son atelier de Paris a été dispersé en vente publique.
![]() Postérité
Postérité
« Regardez l’ombre dans la neige, me dit Courbet, comme elle est bleue… Voilà ce que les faiseurs de neige en chambre ne savent pas. » Cette observation du peintre, relatée par Castagnary, véritable incitation à la peinture sur le motif, ouvre la voie aux recherches impressionnistes sur les ombres colorées.
Ses peintures de paysage font notamment l’admiration de Cézanne : « Son grand apport » affirme-t-il à propos de Courbet « c’est l’entrée lyrique de la nature, de l’odeur des feuilles mouillées, des parois moussues de la forêt, dans la peinture de dix-neuvième siècle […]. Et la neige, il a peint la neige comme personne ! ». Au cours des années 1860, Cézanne utilise le couteau à palette selon la technique de Courbet. Il lui emprunte également les couleurs sombres et la pâte épaisse.

![]() Panorama des alpes. (vers 1876) Nouvelle acquisition du musée d’Art de d’histoire de Genève.
Panorama des alpes. (vers 1876) Nouvelle acquisition du musée d’Art de d’histoire de Genève.
Edouard Manet (1832-1883) ne cache pas sa dette envers Courbet. Comme son aîné, il attire le scandale et les sarcasmes. Le déjeuner sur l’herbe est refusé au Salon de 1863 puis conspué au salon des Refusés. L’Olympia, provocante « odalisque au ventre jaune » du Salon de 1865 focalise l’animosité du public. Par sa volonté de se libérer des règles académiques, Manet prolonge le chemin tracé par Courbet.
James McNeill Whistler (1834-1903), élève de Courbet, développe avec son aîné une relation amicale. Joanna Hiffernan, dite Jo l’Irlandaise, maîtresse de l’artiste américain, est d’ailleurs le modèle présumé de l’Origine du monde (1866). Avec lui, Courbet peint les bords de mer en Normandie, comme avec Eugène Boudin (1824-1898).

l’Origine du monde (1866)
Dans son Déjeuner sur l’herbe (1866), Claude Monet (1840-1926) met en scène un gaillard corpulent dont les traits évoquent ceux de Courbet. Ce dernier rendit d’ailleurs visite au jeune artiste qui achevait la peinture dans l’atelier qu’il partageait avec Bazille.
Carolus Duran (1837-1917) est influencé par Courbet au tout début des années 1860. Dans les mêmes temps, Henri Fantin- Latour (1836-1904) rencontre Gustave Courbet et travaille dans son éphémère atelier.
Renoir (1841-1919) débute aussi sous l’influence de Courbet avant de s’en affranchir. Les nus de Courbet le marquent durablement.