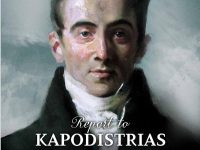The Young Gods, une histoire sans fin

YOUNG GUYS. Près de trente-cinq ans après ses débuts, le groupe romand publie un douzième album,fruit d’une résidence au Cully Jazz Festival. Rencontre avec le duo originel, Franz Treichler et Cesare Pizzi.
Même si les Young Gods sont restés actifs et n’ont cessé comme à leur habitude de multiplier les projets parallèles, en témoignent une collaboration scénique avec les Brésiliens de Nação Zumbi et des concerts dédiés à leur répertoire historique, le groupe fondé en 1985 du côté de Fribourg rompt, avec Data Mirage Tangram, un silence discographique de neuf ans. L’attente en valait amplement la peine.
Ce douzième enregistrement studio du groupe basé de longue date à Genève a, dès ses notes introductives, quelque chose d’hypnotique dans sa manière d’évoquer instantanément le son des Young Gods, mais en même temps de le transcender, de l’emmener dans des territoires parfois plus apaisés, mais aussi plus tortueux. Fruit d’une résidence réalisée durant le Cully Jazz Festival 2015 dans l’intimité du caveau THBBC (The Hundred Blue Bottle Club), Data Mirage Tangram est issu de longues sessions d’improvisation puis d’enregistrement, offrant au groupe l’occasion de renouveler son approche musicale. Rencontre avec le chanteur Franz Treichler et l’architecte sonore Cesare Pizzi, à savoir le noyau originel du groupe, qui n’avait plus travaillé ensemble depuis The Young Gods (1987) et L’eau rouge (1988).
Etait-ce une évidence que d’accepter cette résidence au Cully Jazz? Car il y avait quand même une part de risques…
Franz Treichler: Quand on a retrouvé Cesare à la fin de 2012, on a commencé par rejouer le vieux répertoire, nos deux premiers albums. Puis, dès 2014, on a commencé à intégrer des morceaux datant des années 1990, d’après son départ. C’est à partir de ce moment, comme on avait envie de continuer à jouer ensemble, qu’on s’est dit qu’il fallait faire du neuf. Cette proposition de résidence était ainsi l’occasion rêvée de se botter les fesses et, en effet, de prendre des risques. C’est la première fois qu’on travaillait comme ça.
L’idée était d’abord d’envisager cette résidence comme un laboratoire ou véritablement de commencer à élaborer un nouvel album?
F. T.: On a passé une semaine ou deux à se faire écouter des sons, à se dire que tel ou tel passage pourrait être le squelette de quelque chose, et au final on est arrivé à Cully avec une vingtaine de sessions. Le but était clairement d’en faire quelque chose, même si on ne savait pas si on allait dans la bonne direction. C’est pour cela que cette résidence s’appelait d’ailleurs non pas The Young Gods, mais Treichler Pizzi Trontin Experience. On ne voulait pas qu’il y ait une confusion, que les gens viennent en pensant qu’on allait faire du répertoire. Du coup, ça a été beaucoup plus relax, comme un laboratoire de sons avec des spectateurs qui avaient envie de vivre ça. C’était un public informé et averti, dans les deux sens du terme, qu’il allait se passer ce qui se passerait. On voulait creuser, chercher des nouvelles idées, et ça a dicté la couleur de ce nouvel album, qui est entièrement issu de cette résidence.
On sent d’ailleurs une approche plus jazz, plus libre, notamment dans le toucher de votre batteur, Bernard Trontin…
F. T.: Bernard, je peux répondre pour lui parce qu’il l’a expliqué, a pu essayer plein de choses. Il ne se définira jamais comme un batteur de jazz, même s’il a parfois joué avec des musiciens jazz, mais là, il a vraiment pu se lâcher et improviser des rythmes sur des boucles.
Cesare Pizzi: Le fait que le résultat soit un peu plus down tempopermet à la batterie de jouer un rôle différent. Dans le rock, les tempos sont beaucoup plus élevés et il faut assurer une rythmique binaire efficace. Alors que dans le down tempo, on peut être plus fin.
Cet album ne compte que sept morceaux, mais qui sont tous assez longs, entre six et onze minutes…
F. T.: A part All My Skin Standing, le morceau de onze minutes, on les a tous raccourcis… Sur le moment, on ne se souciait pas trop de leur durée, on faisait juste en sorte que cela paraisse musical et que chaque morceau s’arrête quand on n’avait plus rien à dire. Pour l’album, le boulot a alors consisté à trier tout le matériel qu’on avait, à réécouter les différentes versions de chaque titre jouées durant la semaine, puis de mettre de côté ce qui nous semblait le plus intéressant pour pouvoir recréer des ambiances. On n’a rien conservé de ce qu’on avait enregistré à Cully, mais on a gardé les bandes comme références.
«Super Ready/Fragmenté» (2007) était un album à guitares, très rock, tandis qu’«Everybody Knows» (2010) explorait un spectre assez large, comme un catalogue du savoir-faire du groupe. Est-ce chez vous une nécessité que de ne jamais enchaîner deux albums qui se ressemblent?
F. T.: En tout cas, pas avec les deux derniers. Sur Everybody Knows déjà, il y avait une envie d’aller un peu plus vers des choses qui viennent de l’impro; mais on n’arrivait pas encore à assumer ça. Ce qui compte, c’est que chaque disque possède sa cohérence. Mais tu te souviens, Cesare, tu disais souvent que ça ne sonnait pas vraiment rock, d’autant plus qu’on venait de rejouer les deux premiers albums et des extraits de T.V. Sky…
C. P.: C’est vrai que je n’étais pas vraiment convaincu de certaines choses. Moon Above, les Young Gods qui font un blues à l’harmonica, mais non… Au final, j’adore ce morceau. Et c’est probablement un de ceux qui restent les plus improvisés sur scène. Il y a une structure harmonique, mais son arrangement entier reste totalement ouvert. Que plaisir que de jouer quasiment en impro, c’est superbe.
Quand vous avez réintégré le groupe suite au départ d’Al Comet, était-ce en quelque sorte nécessaire de commencer par rejouer les deux premiers albums, ceux que vous aviez coécrits, avant de potentiellement explorer de nouvelles pistes?
C. P.: Il ne fallait pas nécessairement passer par là, et en fait c’était simplement une commande.
F. T.: On avait promis, à l’occasion de la sortie du livre Heute und Danach [sur la scène musicale des années 1980, ndlr], de rejouer nos deux premiers albums pour les vernissages à Genève, Fribourg et Zurich. On avait accepté cette proposition de Michael Lütscher du temps où «Cometo» était encore dans le groupe, et lorsque je l’ai appelé pour lui dire qu’on n’allait pas pouvoir le faire, il m’a dit: «Mais ce n’est pas possible, vous êtes le dernier groupe de cette époque encore vivant… Franz, tu dois faire quelque chose!» En me souvenant alors de nos débuts, des années 1980, j’ai pensé à Cesare, qui travaillait à ce moment-là en free-lance et se remettait à la musique avec son projet Twoflow. On a alors décidé, avec Bertrand, de lui poser la question.
C. P.: Je ne m’attendais pas du tout à cette proposition. Ils m’ont invité à manger et j’étais convaincu qu’ils allaient me demander des conseils en électronique, comment recréer tel son. Et là, ils me disent qu’ils vont rejouer les deux premiers albums et me demandent si j’en suis. J’ai d’abord été surpris, je voulais réfléchir; puis je me suis dit qu’il fallait commencer par essayer, car je n’avais pas rejoué ce type de musique en live depuis quasi trente ans. Au début, ça a été ardu de refaire cette musique d’une manière aussi précise. Puis c’est redevenu naturel et j’ai eu un immense plaisir.
Quelle influence a eu sur votre son Alan Moulder, qui a mixé «Data Mirage Tangram» et dont on connaît le travail effectué pour Nine Inch Nails, My Bloody Valentine, Foals ou The Killers?
F. T.: Après avoir passé beaucoup de temps à comparer les sons, à assembler des démos et à voir jusqu’où on arrivait à produire la musique nous-mêmes, on s’est dit que ce serait bien d’avoir quelqu’un de vraiment pro pour le mixage, une oreille distante. Et on a bien fait: les démos sont bien, mais les mix sont mieux! Alan a magnifié le tout, il a amené une cohérence au projet, surtout au niveau des sons de batterie, ce qui est un peu mon point faible. Vu que je n’avais plus produit un disque des Gods depuis Second Nature (2000), c’était préférable de donner ça à quelqu’un qui a sa routine, qui connaît ses machines et qui excelle là-dedans. J’aurais été incapable de faire ce qu’il a fait.
Ce nouvel album évoque une sorte de collage. Peut-on parler, lorsqu’on connaît votre intérêt pour ce mouvement artistique, d’un album dadaïste?
F. T.: Je n’irais pas jusque-là… Car pour moi, l’essence même du Dada est impossible à expliquer. Il y avait un côté «tout est permis», alors que nous, on essaie quand même d’avoir une cohérence. Je dirais plutôt que cet album est «dataïste», parce qu’on part de sons qui sont du data, avant d’essayer de créer des ambiances organiques. Notre musique est difficile à définir, mais c’est comme si elle faisait un deal avec la machine. On utilise le data pour faire quelque chose qui au final est très humain. Mais c’est clair qu’élaborer dans un caveau de jazz le disque d’un groupe estampillé comme faisant du rock industriel, c’était un peu décalé.
Portrait de Franz Treichler: Le feu consacré
On retrouve cette idée du data dans ce titre énigmatique, «Data Mirage Tangram»…
F. T.: C’est évidemment une référence au big data. Car il y a des voix qui commencent à s’élever, chez les mathématiciens et les statisticiens, pour dire qu’il faut faire attention à ne pas tout miser sur le big data. Il semble qu’il y a tellement d’informations stockées dans le cyberspace qu’elles ne constituent plus une source sûre. Il y a trop de données qui se croisent. Ce que racontait Terry Gilliam dans Brazil, avec la confusion entre les noms Buttle et Tuttle, devient réel.
C. P.: Je n’ai encore jamais pris la parole sur cette question du data, mais j’ai travaillé dans les algorithmes et, en effet, le taux d’erreurs est énorme. Ce sont des erreurs techniques, c’est difficile d’en parler parce que c’est un discours d’informaticien, mais même si les mathématiciens s’appuient sur des choses bien réelles, les résultats sont totalement faux. La grande difficulté, c’est la qualification des données; et un algorithme ne peut travailler en quantitatif que s’il a une base de données qualitatives. J’ai rencontré et connu cette réalité dans mon ancien métier d’informaticien, mais c’est un autre sujet…
F. T.: On peut donc dire qu’il y a, dans cette croyance sacro-sainte pour le big data, une part de mirage. Le titre de l’album vient de là. Quoi que tu fasses devant ton écran, des algorithmes analysent tout et vont te montrer des pubs pour te vendre des chemises… Tangram est ensuite venu se rajouter pour dire que tout cela n’est dans le fond qu’un jeu. Le tangram, c’est un puzzle de sept pièces qui forment un carré quand tu ouvres la boîte, et que tu peux ensuite assembler pour créer des silhouettes. Comme les sept morceaux de l’album, qu’on a agencés selon un certain ordre afin de donner une couleur à l’album.
Vous avez hâte de retrouver la scène?
F. T.: C’est super excitant, même s’il y a un truc qui me chiffonne: notre condition physique. On va faire beaucoup de concerts, mais on n’a plus trente balais. Il va quand même falloir essayer de trouver le sommeil… Mais la scène reste quelque chose de génial, d’autant plus qu’à partir du moment où on a annoncé qu’il y aurait un nouvel album, on a senti un vrai engouement; beaucoup de promoteurs et de salles nous ont dit qu’ils voulaient nous avoir. Et les billets se vendent bien, c’est réjouissant. Idem avec la presse. C’est cool de voir comment les gens réagissent par rapport à l’album, comment ils le ressentent. D’autant plus que beaucoup de personnes s’attendaient à ce que cela ressemble à du Young Gods des premières années vu que Cesare réintégrait le groupe.
Lorsque vous avez officiellement fondé le groupe en 1985, quelle était votre ambition première? Réellement faire œuvre de pionniers, pour reprendre un terme qu’on vous a souvent accolé?
F. T.: On était très excités par les nouvelles technologies, par la possibilité de faire du rock avec des interventions de musique classique, de musique concrète, des riffs de metal. On était des fans de rock, mais aussi de Kraftwerk. On avait eu tous les deux des expériences de groupes plus classiques, guitare, basse et batterie, et soudainement, pouvoir composer autrement, ne pas partir d’accords de guitare ou de piano mais bosser directement sur le son, a été une révélation. C’est le son qui nous dirigeait vers le rythme et l’atmosphère. C’était vraiment une nouvelle approche, mais dans le fond on ne se posait pas trop de questions.
C. P.: On avait l’excitation de la surprise. Moi, ce qui m’intéressait énormément, c’était la manière de reproduire cette musique sur scène, car la technologie n’était pas la même qu’aujourd’hui. Comment recréer notre musique avec un batteur, un chanteur et des samplers? C’était un véritable défi. On n’inventait pas quelque chose de nouveau, mais on assemblait des pièces éparses dans un processus qui, lui, était nouveau. Franz composait; moi, je passais mon temps à élaborer des sons, c’était un véritable échange de compétences.
The Young Gods, «Data Mirage Tangram» (Two Gentlemen/Irascible). En concert le 21 mars à Lausanne (Les Docks), le 19 avril à Winterthour (Salzhaus), le 20 avril à Bâle (Czar Fest), le 26 avril à Berne (Dachstock) et le 27 avril à La Chaux-de-Fonds (Bikini Test).
________________________________________
Consécration anglaise
En 1987, deux ans après la formation du groupe éponyme, The Young Gods fait sensation. L’album ne ressemble à pas grand-chose de connu, fait l’effet d’une déflagration. A la fin de l’année, lorsqu’il s’agit de dresser la liste des meilleurs disques des douze mois écoulés, l’influent hebdomadaire anglais Melody Maker fait lui aussi sensation: tout en affichant U2 en une de son numéro rétrospective, il place The Young Gods en pole position, juste devant des enregistrements de Prince et de Public Enemy. Plus loin encore dans le classement, des groupes aussi importants que The Jesus and Mary Chain, New Order, The Cure, The Smiths ou encore R.E.M.
«C’est clair que ça a été une sacrée claque», confirme Franz Treichler lorsqu’on évoque cette consécration. Cesare Pizzi, lui, se fait plus prosaïque: «Alors que la presse encensait un groupe quasi inconnu, on dormait dans les cuisines des copains et on se déplaçait avec un bus complètement pourri… Mais on l’a fait avec beaucoup de plaisir et d’émotion.» Et Franz Treichler de se se souvenir de leur première tournée anglaise: «On s’était dit qu’il fallait absolument que quelqu’un dorme dans notre bus VW afin de protéger le matos. Et alors qu’on sillonnait les banlieues londoniennes, on a même décidé qu’il fallait qu’on y dorme à deux, car seul, c’était trop dangereux.»
Rompre avec l’isolationnisme
Si la presse britannique a été la première à soutenir les Young Gods, c’est pour le chanteur grâce à une nouvelle vague de journalistes qui souhaitaient alors en finir avec l’isolationnisme anglais. «Ils étaient très enthousiastes vis-à-vis de ce qui se passait ailleurs en Europe, que ce soit Einstürzende Neubauten en Allemagne, Front 242 en Belgique ou Laibach en Slovénie. Chaque pays avait un truc bizarre qui ne correspondait à rien de ce qui se faisait en Angleterre, et on a fait partie du lot. Alors que pour moi le rock industriel c’était plutôt Throbbing Gristle ou Cabaret Voltaire, ce genre de groupes des banlieues sombres de Sheffield et autres, ils nous ont associés à cette scène. C’est ainsi que parfois des journalistes anglais débarquaient au Buffet de la gare de Fribourg. Un jour, on a eu un gars qui s’appelait Jack Barron, habillé tout en cuir et avec des piercings, ce qui était nouveau. On s’est fait virer parce qu’à cette époque, c’était «tenue correcte exigée». Tous les articles disaient alors que la Suisse n’était pas uniquement le pays des banques, du chocolat et des montres, mais aussi du Dada et des Young Gods.»
Mais avant cette consécration anglaise et enfin une première reconnaissance en Suisse, il y a eu des débuts difficiles: «Je me souviens que lors de nos premiers concerts, en 1985, on démarrait devant trente personnes, et qu’à la fin il n’y avait plus que nos copines… Au début, notre musique, c’était quand même du bruit organisé», rigole Cesare Pizzi.
________________________________________
Le choc Kraftwerk
En 2010, le documentaire Pionniers solitaires, réalisé par Christian Walther, revenait notamment sur l’influence extraordinaire qu’ont eue les Young Gods sur leurs pairs. On l’a dit et redit, mais c’est toujours un plaisir de le répéter: le groupe romand a quand même été salué par Trent Reznor (Nine Inch Nails), The Edge (U2), Mike Patton (Faith No More) et l’immense David Bowie lorsqu’il s’est à son tour frotté à des ambiances industrielles sur 1.Outside (1995). Mais à l’inverse, quels artistes ont le plus compté pour Cesare Pizzi et Franz Treichler? «Pour moi, c’est sans aucun doute Kraftwerk, tranche le premier. C’est la première fois que j’entendais un vocoder et une boîte à rythme. Mais qu’est-ce que c’est que ça? J’ai vraiment kiffé. J’étais alors bassiste, et je me suis dit qu’il fallait que j’arrête. Ils m’ont ouvert un monde sonore qui me dépassait.»
Franz Treichler se souvient de son côté des disques que son frère aîné ramenait à la maison: Pink Floyd, les Doors, Hendrix, le rock psychédélique du tournant des années 1960. «Plus tard, j’ai quand même eu une grosse crise punk, car ce mouvement amenait une fraîcheur et une liberté d’expression bienvenue à une époque où tout devenait trop technique et virtuose. Mais la découverte de Kraftwerk a en effet vraiment été déterminante. Même si on était punks, on écoutait ça en boucle, c’était incroyable. Computer World, on a dû se le passer des milliers de fois.»