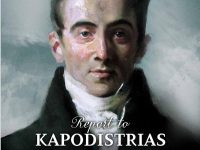Chronique #13: Les Etats-Unis sont ils encore fiables?

Pour beaucoup d’observateurs, l’implosion menace.
Salut mon cher Stephane,
Vacances scolaires obligent, je t’écris d’une Genève encore plus calme que d’ordinaire. Et à chaque jour qui passe, une évidence s’impose à l’Europe: après nous avoir lié depuis toujours avec l’Amérique, l’Atlantique désormais nous sépare. Soudainement, la traversée, par le passé toujours attendue, festive, suscite d’autres interrogations, parfois prenantes. Tu me diras que New York reste New York. L’enseigne a changé de propriétaire. Je crains tout de même que les vieilles saveurs deviendront vite fadasses.
L’Ukraine est l’agresseur, Volodymyr Zelensky un dictateur… A l’ONU, les Etats-Unis ont voté avec la Russie, la Biélorussie et la Corée du Nord. Stéphane, avec et sous Trump 2, plus rien n’échappe au domaine de l’impensable. Parfois pour le pire. C’est assez épouvantable. Mais les sentiments ne comptent pas. Le mot qui convient est “inquiétant”. Les choses ont tout de même le mérite d’être de plus en plus claires. L’analyse des pièces à conviction qui révèlent l’étendue du pivot historique de l’Amérique ne laisse plus guère de doute. L’Europe n’a rien vu venir. Nous sommes dans une phase aigüe depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mais elle n’a pas su, ou voulu, lire les signaux envoyés de l’Amérique qui depuis longtemps, tous partis à la Maison-Blanche confondus, nous indiquaient sa volonté de revisiter sa relation transatlantique et plus largement son engagement dans le monde. Je me souviens, mon cher, de tes papiers de l’époque quand, de Washington tu racontais comment Barack Obama et Xi Jinping construisaient un nouvel axe autour du bassin Pacifique. Il était déjà clair que, par définition, ça modifierait la relation américaine avec le Vieux-Monde. Après avoir émoussé nos sens, les rentes de situation finissent toujours par nous assoupir.
Ce qui se passe aujourd’hui, à vitesse hypersonique, nous permet ainsi d’abandonner nos illusions, de sortir de nos dénis et de ne pas nous raconter de nouvelles histoires face à la situation. Celle, par exemple, qui consisterait à placer beaucoup d’espoirs dans le fait que Trump 2 –comme on le disait déjà de Trump 1– ne sera qu’un phénomène passager, ou que par aménagement, flagornerie ou apaisement, la nouvelle orientation de la politique étrangère américaine pourrait, en l’état, être infléchie de manière significative. La réalité, mon cher Stéphane, est que de quelque manière que tu t’empares de l’équation, le fossé entre l’Europe et les Etats-Unis est devenu immense. Même si dans 4 ou 8 ans les Démocrates parvenaient à reconquérir la Maison-Blanche, le combler ne sera pas une priorité. Je peux me tromper bien évidemment, et je le souhaite. Mais, si l’histoire doit nous servir de guide, j’aime mieux partir de l’hypothèse du pire.
“Decoupling” et “derisking”, les deux mots que les Etats-Unis utilisaient, post-pandémie, dans la rédéfinition de leur relation avec la Chine, ces mêmes deux mots sont maintenant ceux que l’Europe devront très logiquement appliquer dans sa propre relation avec les Etats-Unis. La difficulté est évidemment que ce découplage qui nous est imposé prendra du temps, beaucoup de temps. On le voit en Ukraine. Sans la poursuite d’un appui militaire américain, l’Europe ne pourra pas garantir totalement la sécurité du pays si un cessez-le-feu devait être déclaré. Il faudra donc composer longtemps. Les diplomates et tous les négociateurs qui se frottent à la nouvelle administration américaine ont déjà découvert le goût amer des couleuvres. Ils sont aussi bien avisés d’abandonner Machiavel et Talleyrand au profit de traités de psychologie. Le comment traiter avec Trump est à inscrire d’urgence dans la formation des nouvelles générations de diplomates. J’y ajouterai, d’ailleurs, l’étude des technologies et de leur développement.
Partager
C’est en pensant à tout ça avant de t’écrire ces lignes que j’ai relu ces jours-ci “La Métamorphose du Monde” d’Ulrich Beck, un bouquin que je conserve précieusement à portée de main. Je sais toujours où est “mon Beck”, bigarré par des années de stabilobossage assidu. Décédé prématurément en 2015, le sociologue allemand reste pour moi l’un des penseurs les plus stimulants de l’époque. C’est lui qui dans les années 80 avait développé le concept de “sociétés à risque”, parlant de nos sociétés post-industrielles et technologiques menacées par les accidents industriels, les pandémies, la pollution, toutes avec des effets planétaires, toutes aussi reçues globalement sur nos écrans. Tentant de s’expliquer à lui-même un monde qu’il estimait déjà devenu insaisissable –c’était avant le Covid, avant l’Ukraine, avant Gaza, avant tout serais-je tenté d’écrire–, il amenait, dans son dernier ouvrage, à une nouvelle maturité son concept de « métamorphose ». Un concept qui permettait à ses yeux de penser nos sociétés modernes qui produisent de manière systémique des risques qu’elles ne parviennent pas à pleinement contrôler. La transformation désigne des changements qui peuvent être très importants mais qui s’opèrent au sein d’un cadre de référence existant, à l’intérieur d’un système de pensée et d’organisations sociales qui demeure globalement inchangé.
La métamorphose en revanche, dit Beck, concrétise une césure infiniment plus profonde où non seulement les institutions et les pratiques changent mais aussi où les catégories et les matrices mentales à l’aide desquelles nous appréhendons le monde sont irrémédiablement bouleversées.
Partager #Trump: Acte 2
Stéphane, voilà à mes yeux qui décrit bien le point où nous sommes parvenus aujourd’hui. Nous sommes au-delà des clichés des Power Points sur les “transformations” et les “mutations”, sur la “seule certitude c’est l’incertitude”, au-delà des “polycrises”. Sur fond de haute dangerosité du monde, je pense effectivement que nous sommes entrés dans le temps de la métamorphose. La plupart de ces conditions propices à son avènement prédataient la réélection de Donald Trump. Mais ce dernier en est le catalyseur et l’accélérateur. Dans la poursuite de ma lecture «beckienne» du moment, j’émets donc l’ hypothèse que pour l’Europe, dans laquelle j’inscris la Suisse, la menace que représente le trumpisme sera de deux natures. La première, ainsi qu’on le voit déjà, est celle d’une hostilité ouvertement exprimée qui scelle l’abandon de valeurs communes au sein de ce qui s’appelait encore il y a quelques semaines le « bloc occidental ». Un bloc que reconnaissait Vladimir Poutine et qu’il craignait, le nommant « l’Occident collectif ». (La volte-face américaine est une victoire absolument majeure pour le Kremlin.) La seconde menace vient des risques directs et collatéraux contenus dans le projet trumpien, lesquels pourraient, pour un nombre croissant de commentateurs, conduire à l’implosion de la société américaine. La machine pourrait soudainement s’emballer et par convulsions provoquer des accidents impossibles à contenir. J’utilise Beck pour avancer mon argument, mais c’est bien aujourd’hui, comme tu le sais, le débat qui anime les commentateurs américains les plus avisés. Les plus sombres considèrent d’ailleurs que cette implosion ne sera pas accidentelle mais délibérée, car il s’agirait de la finalité même du projet trumpien puisqu’elle bénéficierait en premier lieu aux oligarques de la tech qui en sont les principaux initiateurs. Nous pourrions en d’autres termes assister graduellement à l’implosion d’un pays devenu totalement dysfonctionnel sous les effets combinés du saccage du gouvernement fédéral, de l’imprévisibilité et de l’irrationalité complète des politiques intérieures, extérieures, économiques et sociales de Donald Trump. Aucune société ne peut fonctionner de manière stable sans une bureaucatie faites de professionels indépendants dont le rôle est de s’assurer de la bonne marche de l’état. Elle est brutalement démantelée. Les contradictions contenues dans le projet trumpien sur les plans économiques et politiques finiront par produire des effets négatifs. Nous ne sommes de toute évidence plus dans le scénario classique d’un parti contesté par une opposition unifiée, mais dans un rejet qui rassemble des forces disparates, y compris des acteurs qui ont contribué à la réélection de Donald Trump. Nous devons nous préparer à contempler la possibilité d’une chienlit profonde et incapacitante qui pourrait saisir le pays.
Tout pourrait aller très vite. Considère, mon cher, que quelques semaines à peine auront suffi pour détruire le “soft power” que l’Amérique avait construit pendant plus de sept décennies. Son hard power pourrait-il connaître le même sort?
Via un détour par une politique-fiction récemment publiée dans le Financial Times, Daron Acemoglu, le prix Nobel d’économie et professeur à MIT n’est pas loin de le penser:
Le déclin, lorsqu’il s’est produit, a été soudain et inattendu. Le XXe siècle avait été le siècle américain et les États-Unis semblaient encore plus «inarrêtables» au cours des premières décennies du XXIe siècle. Alors qu’ils prenaient la tête dans le domaine de l’intelligence artificielle, leur économie semblait robuste et destinée à surpasser leurs rivaux d’Europe occidentale qui souffraient encore des effets de la crise financière de 2007-2009 et de la pandémie de Covid-19 de 2020-22. (…) La plupart des observateurs ont été surpris lorsque, au début des années 2030, l’économie américaine a cessé de croître et s’est retrouvée à la traîne, même par rapport à l’Europe.
L’un des piliers du siècle américain a été la capacité du pays à façonner l’ordre mondial d’une manière avantageuse pour sa propre économie, y compris pour ses industries financières et technologiques. Mais le retrait des États-Unis des accords de Paris et de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que les tarifs douaniers onéreux imposés aux alliés, suivis de querelles intestines au sein de l’OTAN, ont incité de plus en plus de pays à s’éloigner du dollar et du système financier américain en tant que point d’ancrage. Cependant, aucune de ces explications n’a suffi à expliquer le déclin soudain et inattendu de l’euro. La plus importante a été l’effritement des institutions américaines ».
Mon cher Stéphane, nous finissons parfois chacun les phrases de l’autre. Je suis persuadé que tu auras donc déjà déduit de cette missive que je t’envoie en urgence par porteur que la question à laquelle nous sommes désormais tous confrontés est aujourd’hui de savoir si les Etats-Unis ne sont pas en quelques mois devenu un pays à risque? Un pays auquel on ne peut tout simplement plus se fier. Cette question, je te le concède, est assez vertigineuse à contempler.
Je file faire une promenade dans le Jura. A très vite.
Philippe Mottaz