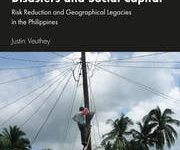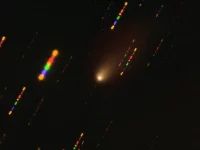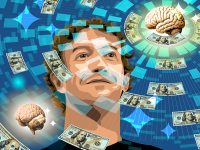Moyen orient. Après la chute d’al-Assad, le défi de la reconstruction d’une Syrie en miettes

HajjeraHajjera, Harasta (Syrie).– L’avenue qui mène de Sayyeda Zeinab à Hajjera, dans la banlieue sud-est de Damas est droite, absolument déserte et extrêmement propre. Pas un papier qui traîne, pas un sac en plastique qui vole. Soigneusement empilés sur les bords, tous les cent mètres, des tas de gravats.
De chaque côté de l’artère, des immeubles. Ou plutôt des carcasses d’immeubles. Des ruines grises à l’infini. Des moignons de béton, des toits effondrés comme des drapés de tissus, des murs éventrés, des armatures de fer rouillées. Certains sont rafistolés. La plupart sont inhabitables.
La propreté est l’œuvre d’un groupe d’habitant·es de Hajjera, une trentaine de personnes organisées dans un groupe WhatsApp, qui tentent, depuis début 2023, de prendre en charge les tâches basiques d’un État failli et d’une municipalité absente. Les destructions sont à mettre au compte de la répression de la révolution syrienne et de la guerre civile qui a suivi.
Le village de Hajjera, environ 4 000 habitant·es selon le dernier recensement officiel, il y a vingt ans, fait partie de ces bourgades et villes martyres de la province de Rif Dimashq, ceinture mi-urbaine mi-rurale de Damas.
« Ici, c’est l’Armée syrienne libre qui a tenu la ville, jusqu’au mois de ramadan 2013 [juillet – ndlr], se remémore Amar Moussa, ingénieur en mécanique et spécialiste des énergies renouvelables, un des piliers du groupe de volontaires. À ce moment-là, nous avons été attaqués par le Hezbollah qui avait posté des hommes juste à côté, à Sayyeda Zeinab, et la plupart des gens ont fui vers Bab Bila, y compris les combattants. »
Hajjera a été prise dans la géographie terriblement complexe de la guerre syrienne. Elle fait partie de ces cités qui se sont affranchies du régime pendant plusieurs mois, au début de la militarisation du soulèvement syrien. Puis qui ont succombé sous les coups des renforts puissants appelés par Bachar al-Assad, les milices envoyées par l’Iran : le Hezbollah libanais et le Hachd al-Chaabi irakien, coalition de milices chiites irakiennes, formée en 2014 pour lutter contre l’État islamique.
Des villes détruites
La bourgade, mi-urbaine mi-agricole a payé aussi sa position géographique, juste à côté de la ville de Sayyeda Zeinab, qui abrite un sanctuaire chiite, et que le Hezbollah a choisi comme poste de cantonnement important.
Bab Bila n’est guère plus éloignée, mais là, les combattants opposés au régime ont résisté jusqu’en 2018. Un accord de cessez-le-feu, signé sous l’égide de la Russie, soutien crucial du régime de Bachar al-Assad, a achevé de vider les bourgades rebelles.
Les membres des groupes armés anti-régime, leurs familles et nombre de civil·es ont été envoyé·es en bus vers le nord du pays, en particulier vers la province d’Idlib, la dernière à échapper aux alliés d’Assad.
Hajjera est alors détruite à plus de 70 %, comme les bourgades alentour. Et vide. Ou presque : « Le Hezbollah a pris possession de ce qui restait de la ville, avec le Hachd al-Chaabi, reprend Amar Moussa. Ils ont tout pillé, les magasins et les maisons, et installé des postes de commandement et des stocks d’armes. Ils sont restés là jusqu’au bout, on les a vus partir à 4 heures du matin le dimanche de la fuite de Bachar [8 décembre 2024 – ndlr]. »
Quand, en 2018, quelques centaines d’habitant·es ont été autorisé·es à revenir dans Hajjera, dont Amar Moussa, la bourgade était livrée aux milices, aux chats et aux chiens errants. « Tout était détruit ou brûlé, les propriétés privées, les infrastructures publiques, les mosquées, les écoles, les maisons, tout », se souvient l’ingénieur.
Avec quelques autres, il a nettoyé l’école élémentaire abandonnée depuis 2013. Elle a rouvert en novembre 2018, pour la rentrée scolaire, et accueillait… cinq élèves. « Les parents avaient trop peur de la proximité du Hezbollah pour envoyer leurs enfants en cours, explique la directrice, Fera’ Hehdaqi, emmitouflée dans un épais manteau, à son poste dans son bureau, glacial malgré un antique poêle à bois. Mais il fallait le faire, il fallait commencer par là, car beaucoup de jeunes avaient été déscolarisés pendant plusieurs années, trois ans pour certains. Nous nous sommes retrouvés avec des gamins de 12 ans qui n’étaient jamais allés à l’école, à cause de la peur, ou parce qu’ils devaient travailler pour aider leurs parents à faire vivre la famille. »
École minée
Peu à peu, les familles sont revenues. Avant même la chute du régime, l’école de Hajjera accueillait 1 600 enfants, de la maternelle au collège.
Dans un dénuement extraordinaire. Pas de chauffage, alors que l’hiver dans la région est glacial. Pas de robinets pour les toilettes. Pas de porte aux classes. Évidemment pas de cahiers, ni de stylos, ni de quoi nourrir les enfants, ou les vêtir. Le groupe WhatsApp a fait ce qu’il a pu : repeindre les locaux, installer des buts dans la cour, trouver des tableaux pour les classes, des bureaux et des chaises. « Certains viennent sans chaussures, sans pull, et ils ont faim », déplore la directrice.
de l’établissement transformé en arsenal par le Hezbollah et bombardée par les avions israéliens en 2018. Comme pour le reste, il aurait fallu que le régime fasse preuve d’un minimum d’attention pour sa population. Celle de Hajjera, rebelle et sunnite, ne faisait pas partie de ses amis, plutôt de ses ennemis.
À Hajjera, les enfants risquent à tout moment de tomber du deuxième étage sans rambarde.
Les volontaires, dont nombre d’étudiant·es, ont pallié tant bien que mal le manque d’enseignant·es en donnant des cours particuliers et collectifs sur leur temps libre.
Clandestinement et non sans risques : « Ce genre d’activités, organisées en dehors des structures du régime, n’étaient pas bien vues. On pouvait se retrouver en prison, pour ça », assure Badreddin Hafez, jeune ingénieur en informatique. « Mais on ne risquait pas de trouver des profs, parce qu’avec des salaires équivalents à vingt euros par mois, ils cherchent à faire autre chose », reprend Abdelsalam al-Mouallim, qui enseigne l’arabe et bricole à droite et à gauche pour vivre.
Revenir et habiter dans des ruines
L’épouse d’Amar Moussa, médecin, travaille dans une clinique privée. Elle soigne, gratuitement, celles et ceux qui en ont le plus besoin dans le village. C’est-à-dire tout le monde.
Dimanche 8 décembre au soir, quelques heures après la fuite de Bachar al-Assad, Mahmoud Moussa, sa femme, ses sept enfants, une de ses sœurs et ses deux adolescents, ont emprunté la grande avenue toute propre. Ils rentraient chez eux, après onze années de déplacement forcé, d’abord pour la ville voisine de Bab Bila, puis, en 2018, pour Idlib, bien plus au nord. L’ancien combattant de l’armée syrienne libre brûlait de retrouver son village et la maison familiale.
Il l’a trouvée « jolie mais endommagée », dans une litote qui prêterait à sourire si les nuits n’étaient pas si froides. Du bâtiment de deux étages, il ne reste que quelques murs porteurs, des piliers de soutien, l’escalier et, au sol, une partie de carrelage, là où il n’a pas été arraché par les pillards.
La famille louait un appartement à Idlib, Mahmoud travaillait comme ouvrier ferronnier. À Hajjera, les enfants risquent à tout moment de tomber du deuxième étage sans rambarde, la famille ne possède qu’un brasero pour faire la cuisine et tenter de se réchauffer. Mais « c’est notre ville, c’est notre cœur », tente Mahmoud.
Le groupe de volontaires n’a pu leur procurer que quelques matelas et des couvertures synthétiques. « La communauté est très pauvre, et nous ne recevons aucune aide de l’extérieur », s’excuse Badreddin Hafez.
Moins d’une semaine après la chute de la maison Assad, des représentants de Hayat Tahrir al-Cham (HTC), principaux tombeurs du régime sont venus rencontrer un groupe d’habitant·es. « Nous étions circonspects, raconte Amar Moussa, car on nous disait depuis des années que ceux d’Idlib étaient des islamistes extrémistes. Évidemment, nous n’avions pas confiance dans les autorités, mais quand même, on ne savait pas à quoi nous attendre. »
« Ils nous ont rassurés car ils font preuve d’une grande ouverture d’esprit, poursuit Fera’ Hehdaqi, la directrice de l’école. Nous leur avons dit que nous ne voulons pas d’un État islamique. Nous leur avons aussi demandé si les salaires de décembre allaient être payés, ils ont dit qu’ils feraient le maximum. »
Nature et organisation futures de l’État, réponses concrètes à des besoins élémentaires criants : tout est urgent dans la Syrie en miettes.
À l’est de Damas, plus emblématique encore de la vindicte sans pitié du régime que la partie septentrionale du Rif Dimashq, la Ghouta orientale. La région a subi ses bombardements, y compris aux armes chimiques, de terribles mois de siège, la prédation d’une petite frange de profiteurs de guerre, des transferts de population massifs vers le nord et vers la Turquie et, en sus, le joug de groupes insurgés islamistes radicaux.
« Si les déplacés et les réfugiés rentrent en masse maintenant, nous ne pourrons pas faire face, assure Omar Chaker, chirurgien de Harasta, une ville de la Ghouta orientale à quelques kilomètres seulement du centre de Damas. La population ici est épuisée, en mauvaise santé physique et mentale. Les dernières années, après 2018 et le départ des derniers combattants, ont été les plus dures, pires que pendant le siège où nous manquions de tout. Nous n’étions plus bombardés, mais les finances des familles se sont effondrées et les organisations communautaires que nous avions mises en place pendant le blocus ont cessé de fonctionner. La nourriture et les médicaments entraient à nouveau, mais personne ne pouvait les acheter. Nous avons eu beaucoup de dépressions. Des vagues d’hépatite A à cause de la pollution de l’eau. De la malnutrition. »
Le praticien n’a jamais quitté Harasta. Dès le début de la révolution, puis pendant tout le siège, de 2012 à 2018, il a participé aux services médicaux alternatifs mis en place par l’opposition. Dans son cabinet médical spartiate, il professe un espoir mesuré. Entre les atrocités du régime déchu et les exactions des insurgés islamistes, le père de trois enfants en a trop vu pour s’enthousiasmer.
Comment l’être, d’ailleurs, quand à Harasta, comme à Douma, principale cité de la Ghouta orientale, 70 % des bâtiments sont détruits ou endommagés ? « Nous estimons que 40 % seulement d’entre eux peuvent être réhabilités », assure Bassam Zeitoun, ingénieur, ancien responsable de la branche locale d’une ONG syrienne de développement.
Enfant de Harasta, il a dû quitter la Ghouta après la reddition de l’insurrection de 2018, et a poursuivi ses activités dans la province d’Alep puis d’Idlib. Revenu dans sa ville natale deux jours après la chute des Assad, il essaie, entre deux retrouvailles familiales, de remettre sur pied les réseaux qui ont permis à la Ghouta de survivre aux bombardements et au siège.
Non pas ceux des profiteurs enrichis pendant le blocus en pratiquant le marché noir entre le régime et la zone assiégée, mais ceux qui faisaient, au prix d’ingéniosité collective, tourner les boulangeries, les puits, les écoles et les centres de soins souterrains, organisaient les cultures paysannes les plus rentables, le ramassage des ordures et l’inhumation des corps.
« Nous allons réactiver certaines initiatives, étendre ce que nous avons fait à Idlib ces dernières années, mais de manière différente. Nous devons intégrer les personnes qui travaillaient dans l’administration locale sous l’ancien régime,explique Bassam Zeitoun. Si elles n’ont pas de sang sur les mains, si elles n’ont pas participé au système répressif et qu’elles possèdent des compétences, ce serait stupide de les mettre de côté. Nous avons besoin de tout le monde. »
Bassam Zeitoun a pour l’instant son bureau dans l’hôpital de Harasta. Au-delà de cette rue animée s’étend le paysage des carcasses d’immeubles et des bâtiments réduits en amas de béton.
À quelques kilomètres de là, dans la ville presque entièrement rasée de Jobar, des volontaires ont commencé à planter des arbrisseaux. Pour le symbole, celui de la nouvelle Syrie.