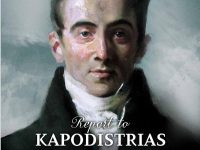Environnement. La crise de l’eau en Jordanie

ANALYSE. Le royaume hachémite fait face à une importante pénurie d’eau, privant une large part de sa population du droit à l’eau reconnu par les traités internationaux.
L’arrivée de réfugiés syriens à la suite de la guerre civile en Syrie a augmenté la pression sur les ressources hydriques du pays. Cette situation est à l’origine de tensions sociales, de problèmes sanitaires et exige des réformes urgentes en matière de gestion de l’eau.
Le droit à l’eau
Avant d’examiner la situation de la Jordanie en matière de pénuries d’eau potable, il convient de rappeler ce qu’est le droit à l’eau et la manière dont il est défini. Ce dernier est ainsi « une condition préalable à la réalisation des autres droits de l’homme »[1]. Il découle du droit à la vie et à la dignité consacré dans la Déclaration Universelle des droits de l’homme. Le droit à la vie ne peut en effet être garanti sans accès à l’eau. Le droit à l’eau a été défini officiellement en 2002 par le Conseil économique et social des Nations Unies. Il consiste en « un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun » [1]. Le Conseil économique et social, dans la même observation de 2002, souligne trois facteurs à prendre en compte afin de garantir un droit à l’eau adéquat : la disponibilité, la qualité et l’accessibilité de l’eau. Cette accessibilité doit être physique, économique (coût abordable pour tous), et implique la non-discrimination, particulièrement des populations les plus vulnérables ou marginalisées. L’accessibilité de l’information doit aussi être garantie.
Trois obligations sont également imposées aux États afin de garantir ce droit à l’eau : les obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre. L’obligation de respecter implique l’abstention d’entraver l’accès ininterrompu à l’eau, l’obligation de protéger nécessite d’empêcher d’entraver l’exercice du droit à l’eau, alors que l’obligation de mettre en œuvre induit une obligation de faciliter, de promouvoir et d’assurer le droit à l’eau.
De par sa ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Jordanie est donc tenue d’assurer un droit à l’eau et à l’assainissement[2], tel que défini par le Conseil économique et social. Il lui revient donc de prendre les mesures adéquates afin de garantir l’accessibilité, la disponibilité et la qualité de l’eau, malgré la pénurie d’eau à laquelle elle fait face.
Une situation très tendue
Avec une disponibilité en eau de 145 m3 par habitant et par an, la Jordanie fait partie des trois pays les plus pauvres en eau dans le monde[2]. Sa disponibilité en eau est de loin inférieure au seuil de pénurie d’eau, situé à 1000 m3 d’eau par an et par personne[3], et également en dessous du seuil de pénurie absolue de 500 m3 d’eau par an et par personne[2].
La Jordanie est approvisionnée en eau par le Jourdain, le Yarmouk, son principal affluent, et la nappe phréatique de Disi, et partage ces ressources avec la Syrie, Israël, les territoires palestiniens et l’Arabie Saoudite[4]. Afin de garantir le partage des ressources en eau provenant du Jourdain et de la rivière Yarmouk, un accord de coopération sur l’eau du Jourdain a été signé entre Israël et la Jordanie, en octobre 1994, à la suite du traité de paix entre ces deux pays[3]. Parmi ces ressources, l’approvisionnement en eau potable de la Jordanie provient majoritairement, à 57%, des eaux souterraines (480 millions de m3 par an), alors que les eaux de surface, provenant du Jourdain et du Yarmouk, fournissent 45% des ressources en eau (120 millions de m3 chacun)[3]. Toutefois, la quantité d’eau pompée dans les nappes phréatiques est supérieure à la quantité qu’elles génèrent[5]. L’utilisation réelle des ressources en eau renouvelable s’élève donc à 115% des ressources disponibles, avec un déficit de 500 millions de m3 d’eau par an – déficit comblé par la surexploitation des aquifères et des nappes phréatiques non renouvelables[3]. Ces nappes étant situées à plus de 1200 m sous le niveau d’Amman, une infrastructure importante est nécessaire pour acheminer l’eau[3], qui implique un investissement important de la part du gouvernement.
La distribution de l’eau est en effet gérée de manière centralisée par le Ministère de l’eau et de l’irrigation, la « Water Authority of Jordan » (WAJ), mais également par des opérateurs privés. Elle est soutenue par des bailleurs de fonds internationaux, dont les principaux sont américains (USAID), allemands (GIZ), japonais (JICA), européens et français (AFD) [6]. Selon le gouvernement, 98% des ménages sont connectés au réseau d’eau et 68% au réseau d’assainissement. Malgré cela, les habitants ne reçoivent de l’eau qu’une à deux fois par semaine, voire moins souvent dans les régions éloignées. De plus, les pertes d’eau dans ces réseaux peuvent atteindre jusqu’à 50%, suite à des fuites, des raccordements illégaux ou des pertes techniques. D’autres moyens alternatifs, plus onéreux, sont donc utilisés par les habitants afin de compléter leur approvisionnement en eau : bouteilles d’eau et utilisation de l’eau de citernes privées [2].
L’impact des réfugiés syriens sur l’approvisionnement en eau
Différents facteurs sont venus aggraver la pénurie d’eau en Jordanie : la sécheresse, l’épuisement des réserves d’eau souterraine, le changement climatique, la croissance de la population, l’afflux de travailleurs migrants et l’accueil de réfugiés[2]. Près de 45% de la population totale de la Jordanie, qui compte plus de 6 millions d’habitants, sont des migrants ou des réfugiés[2]. Parmi ceux-ci, 600 000 sont inscrits comme réfugiés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies[7]. Ces populations ont provoqué une augmentation de 20% la demande en eau du pays[8]. Cette augmentation de la demande a impliqué une réduction de la quantité d’eau disponible par habitant, une diminution de la fréquence d’approvisionnement en eau, et une augmentation de la pression sur le budget du gouvernement, qui subventionne l’eau à hauteur de 50%[6]. Cette pression sur la demande en eau a également conduit à des émeutes durant l’été 2013, dans le nord de la Jordanie, les médias ayant utilisé à ce sujet l’expression de« water riots » [6].
Ainsi, depuis l’arrivée de réfugiés syriens dès 2011, la consommation d’eau par habitant est passée de 88 litres à 66 litres dans certaines régions du Nord[2]. C’est en effet dans cette région que se situent les principaux camps de réfugiés, tels que le camp de Zaatari, qui compte 80 000 réfugiés syriens[9]. L’eau disponible pour ces réfugiés, qui provient à 70% du réseau et à 30% de citernes privées, est souvent insuffisante pour subvenir à leurs besoins[6]. L’évacuation des eaux usées et le raccordement aux égouts pose également problème dans les camps de réfugiés. En conséquence de cela, sous le camp de Zaatari, la nappe phréatique serait sans doute polluée par les eaux usées déversées par les réfugiés du camp[10].
En outre, l’augmentation de la demande en eau impacte sur son prix. L’accroissement de la demande nécessite une utilisation plus importante des canalisations, qui se dégradent plus rapidement, et induit une diminution de la quantité d’eau disponible via le réseau. Afin de garantir leur approvisionnement, les habitants sont forcés d’acheter une quantité supérieure d’eau provenant des réservoirs ou de bouteilles d’eau, ce qui leur induit des coûts supplémentaires [5].Enfin, la qualité de l’eau n’est pas non plus garantie. L’eau provenant du réseau n’est pas toujours suffisamment de bonne qualité pour être bue. Si les habitants en ayant les moyens peuvent se permettre d’acheter de l’eau filtrée, ce n’est pas le cas des nombreuses familles sans argent. Les habitants étant contraints de boire cette eau de qualité incertaine, les cas de diarrhée parmi les jeunes enfants augmentent, impactant directement la santé de ces populations [5].
Des solutions mises en oeuvre
A la suite d’une visite de six jours en Jordanie en mars 2014, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement a évalué la mise en œuvre du droit à l’eau et à l’assainissement dans le pays. Il en est ressorti que « les mesures d’urgence existantes au problème de pénurie d’eau ne sont ni suffisantes ni durables »[2]. Diverses mesures ont donc été proposées par le rapporteur spécial des Nations Unies afin de faire face à cette crise :
– Avant tout, afin de garantir la disponibilité de l’eau, il conviendrait de réduire les pertes d’eau, augmenter la récupération des eaux de pluie et sensibiliser à la préservation de l’eau. Un accroissement du budget alloué à l’exploitation et à l’entretien, qui représenterait la majorité du budget de l’État pour le secteur de l’eau, permettrait également d’améliorer l’approvisionnement en eau. Ce budget est en effet actuellement principalement destiné à l’extension des infrastructures, avec une faible part pour l’entretien et l’exploitation.
– Une révision du système tarifaire, avec des subventions accordées aux ménages les plus pauvres, devrait également favoriser l’accessibilité économique de l’eau. Un soutien financier, de la part des gouvernements et de la communauté internationale, aux gouvernorats du nord, qui accueillent la majorité des réfugiés syriens, favoriserait quant à lui la durabilité de l’accès à l’eau et à l’assainissement pour ces populations.
– Outre ces recommandations, dont la mise en œuvre devra surmonter plusieurs obstacles, différents projets sont actuellement en cours, ou en projet, afin d’améliorer l’accès à l’eau pour les populations jordaniennes. De nombreuses organisations internationales humanitaires sont actives dans le pays et tentent ainsi d’apporter une solution à l’approvisionnement en eau de ces populations. L’aide humanitaire qu’elles apportent concerne à la fois des projets sur les réseaux et la réhabilitation des infrastructures, des projets en faveur des communautés, notamment via la mise en place de citernes pour la récupération d’eau de pluie, et des projets axés sur les individus, tels que l’achat de pompes électriques ou la distribution de coupons permettant l’achat de l’eau [6].
– Enfin, le projet de canal entre la mer Rouge et la mer Morte figure également comme une solution aux problèmes d’approvisionnement en eau de la Jordanie. Un accord controversé signé en décembre 2013 prévoit la construction d’un canal de 180 km entre la mer Rouge et la mer Morte, une station de dessalement et le pompage de saumure. Ce projet, qui permettra de contrer l’assèchement de la mer Morte, est toutefois très critiqué en raison de risques de conséquences environnementales désastreuses [7].
Notes
[1]- Conseil économique et social des nations Unies, Observation n°15 (2002). Le droit à l’eau, Genève, 11-29 novembre 2002.
[2]- « ‘End visit Statement by the United Nations Special Rapporteur on the Human Right to water and Sanitation, Jordan 11-16 March 2014 », Haut-Commissariat aux droits de l’homme [en ligne]:http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14386&LangID=E (consulté le 11 novembre 2014).
[3]- « L’eau en Jordanie : une problématique vitale, un enjeu stratégique, un marché en pleine expansion », Suez environnement [en ligne], http://www.suez-environnement.fr/wp-content/ uploads/2009/06/DP_MO_ Jordanie_2009.pdf (consulté le 11 novembre 2014).
[4]- « Le secteur de l’eau en Jordanie : enjeux et enseignements », Agence française de développement [en ligne], http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/SECTEURS/EAU_ET_ASSAINISSEMENT/pdf/Actions%20AFD%20Eau%20en%20Jordanie.pdf (consulté le 11 novembre 2014).
[5]- « L’afflux de réfugiés syriens aggrave la pénurie d’eau en Jordanie », Oxfam International [en ligne],http://blogs.oxfam.org/fr/blogs/13-03-22-afflux-refugies-syriens-aggrave… (consulté le 11 novembre 2014).
[6]- Ducharme, E., La gestion de la distribution de l’eau en Jordanie à l’épreuve de la « crise syrienne », Mémoire de master, Institut d’urbanisme de Lyon, 2013-2014.
[7]- « La Jordanie place de grands espoirs dans le projet controversé de canal de liaison entre la mer Morte et la mer Rouge »,Irinnews [en ligne], http://www.irinnews.org/fr/report/99838/la-jordanie-place-de-grands-espo… (consulté le 13 novembre 2014).
[8]-« Le Conseil des droits de l’homme examine des rapports sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement et sur les produits et déchets dangereux », Haut-Commissariat aux droits de l’homme [en ligne] :http://www.ohchr.org/ch/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15006& LangID=F (consulté le 11 novembre 2014).
[9]- « En Jordanie, les réfugiés syriens crèvent de soif ; les experts de la Sem dépêchés au camp de Zaatari leur viennent en aide », UNHCR [en ligne], http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=463 ef21123&id=540fdee58 (consulté le 12 novembre 2014).
[10]- « Pénurie d’eau en Jordanie », Caritas [en ligne], https://www.caritas.ch/fr/actualites/larticle/detail/penurie-de28099eau-… (consulté le 11 novembre 2014).