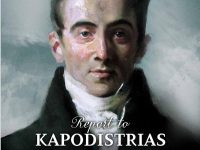NewTech. Faire la guerre sans morts. Les technologies de pointe ont déplacé le champ de bataille.

Dromes war.Vous n’aimez pas la guerre, mais la guerre, elle, vous aime…!», répliquait Léon Trotski à ceux qu’il trouvait trop empreints de pacifisme angélique. Le propos du fondateur de l’Armée Rouge vaut encore aujourd’hui. Mais de quelle guerre parle-t-on désormais!?
Elle s’est tellement métamorphosée que l’on se demande même si le terme de « guerre » convient encore. Elle est devenue diablement sophistiquée, virtuelle, ludique. On parle désormais de robotisation et de numérisation du champ de bataille. Le combattant s’est transformé en une mini-usine mobile montée sur rangers, avec quarante kilos d’équipement sur le dos – parfois par 40°C, comme en Afghanistan l’été. Chargé de batteries, il transporte une informatique de combat qui lui permet de voir plus loin grâce à de petits drones (des avions sans pilote), de communiquer instantanément avec ses pairs et son commandement. Le fusil à tirer dans les coins est devenu une réalité grâce à des viseurs déportés. A l’aide de robots démineurs, il permet de neutraliser une charge ou une mine piégée tout en restant à distance de sécurité. Et quand on pénètre dans un PC (poste de commandement) en opérations extérieures, en Afghanistan ou en Irak, on a l’impression de se retrouver dans une salle de traders à New York : des batteries d’écrans constellent les murs et des « pianoteurs » en treillis s’acharnent sur les claviers d’ordinateurs pour une gestion en temps réel du tempo de la guerre.
Le « fin du fin » est de pouvoir détruire l’autre à distance, sans apparaître. Les drones sont devenus, dans ce registre, une arme de choix, en allongeant au maximum la distance séparant le tireur de sa cible. De nombreux pays travaillent à des formes sophistiquées de dématérialisation de l’agression. Il s’agit de miser davantage sur l’implosion suscitée discrètement que sur l’explosion signée. Comment casser les capacités de l’adversaire, d’un concurrent, sans avoir à engager un seul homme sur le terrain, en restant dans son bureau et en préservant son anonymat ? La réponse a pour nom « cyberguerre ». Elle fait désormais partie intégrante de la panoplie de la polémologie, l’étude de la guerre. Un virus informatique peut avoir autant, peut-être plus, de capacités de destruction qu’une armée. Cette dernière doit le plus souvent attaquer la périphérie pour atteindre le cœur. L’assaut informatique permet de toucher directement le cœur pour briser la périphérie.
En 2008, lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie, celle-ci fut, dès les tout premiers jours de la confrontation militaire, victime d’une cyberattaque : au moment même de l’offensive des chars russes en Ossétie du Sud, des sites officiels de Tbilissi étaient neutralisés ou piratés. Un an plus tard, c’est une partie des programmes de recherche nucléaire iraniens qui était détruite par un virus introduit par des informaticiens russes mais à leur insu, lors d’une opération de maintenance à Téhéran. Les Américains ou les Israéliens ont bien sûr été suspectés d’avoir monté cette cyberopération à deux bandes, mais les attaquants n’ont laissé aucune signature après avoir tiré leur cybermissile.
Des escarmouches
Les Américains ont très vite mesuré les avantages et les risques de cette nouvelle forme de guerre. Ils en ont été victimes à plusieurs reprises (avec des dégâts limités pour l’instant) et estiment officiellement qu’une cyberattaque majeure contre le cœur de leur pouvoir politique, économique et militaire serait considérée comme un acte de guerre susceptible de faire l’objet de mesures de rétorsion militaire adéquates. A l’été 2011, des centaines de comptes électroniques gérés par Google, appartenant à des journalistes, à des officiels civils et militaires américains et à des dissidents chinois ont été piratés. Montré du doigt, Pékin s’est indigné de ces accusations. On peut toujours répondre facilement à la question « A qui profite le crime d’une cyberattaque ? », mais en apporter la preuve matérielle et juridique est un vrai casse-tête qui n’a pas fini d’empoisonner les gouvernements et les instances internationales. Aucun pays n’est à l’abri de cette nouvelle métamorphose de la guerre qui peut conduire, par exemple, à la destruction complète de stocks de carburants ou de centrales électriques en toute impunité. L’Otan l’a bien compris, qui a placé cette nouvelle menace au premier plan de sa réflexion stratégique. Plus les armées sont sophistiquées, plus elles sont vulnérables à ce type d’attaque. Pour l’instant, il n’y a eu que des escarmouches.
Les guerres bâtardes
La guerre est toutefois restée fidèle à ses vieux standards, et mêle aujourd’hui modernité et archaïsme. A l’époque de Trotski, les choses étaient relativement simples. « Le phénomène guerre » (titre d’un ouvrage célèbre du polémologue Gaston Bouthoul) avait des contours saisissables pour le commun des mortels. Les Etats en armes se faisaient la guerre en uniforme, bannières au vent, pour conquérir ou reconquérir un territoire. Leurs buts étaient sans détours et assez logiques : pénétrer le territoire adverse pour les uns ; le défendre bec et ongles pour les autres. Les rôles pouvaient s’inverser au fil des combats. Pour le soldat, cet engagement avait du sens puisqu’il fallait défendre son pays, sa terre, sa famille, son mode de vie. Et l’attaque lui était souvent présentée comme une forme de prévention. La paix permettait ensuite de faire les comptes, de remettre les pendules territoriales à l’heure, de prendre l’avantage ou de ronger son frein en attendant la confrontation suivante. Les civils étaient concernés au premier chef. Leurs enfants, sous l’uniforme, mouraient en masse ou revenaient cabossés de l’intérieur et de l’extérieur.
La guerre était lisible. L’étrange est venu des conflits dits « asymétriques » (notamment lors des guerres de décolonisation, en Indochine, en Algérie ou au Vietnam) au sein desquels on identifie assez mal les protagonistes, les buts de guerre et la notion même de paix. Ces guerres-là n’opposent plus des Etats ou des armées, mais des soldats en uniforme à des groupes indéfinis, informels, invisibles, insaisissables : miliciens, terroristes, mafieux, etc. Les civils sont otages de ces affrontements sans fin. Ils constituent d’ailleurs aujourd’hui le gros des victimes de combats qui se déroulent de plus en plus en ville : 20 % de pertes civiles en 14-18 ; 50 % en 39-45 ; 80 % dans les conflits contemporains. Quelques noms de cités dévastées résonnent en une triste litanie : Beyrouth, Mogadiscio, Vukovar, Sarajevo, Grozny, Bagdad, Falloujah, Abidjan, Misrata… Seule satisfaction : ces affrontements font beaucoup moins de morts que les « grandes » guerres du passé : 50 millions de tués pour la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), environ 1,5 million (civils et militaires des deux camps) au Vietnam (1965-1975).
Ces guerres obliques, transverses, bâtardes, se multiplient. Leur but n’est pas nécessairement la conquête de la terre, mais le pouvoir et la domination, voire l’extermination. Dans la guerre asymétrique, les soldats en uniforme sont censés respecter des règles de droit ; leurs adversaires ne sont régis que par le seul principe d’efficacité. Tout leur est donc permis, notamment l’utilisation des civils comme arme par détournement. Les buts de guerre reflètent eux-mêmes l’étrangeté de ces situations où le plus faible militairement entend bien damer le pion du plus fort en l’attaquant sur un autre terrain que celui de la confrontation militaire directe.
Autre paradoxe de ces conflits baroques : il y a souvent bien plus de morts pendant la « paix » que pendant la « guerre », ne serait-ce que parce que la notion de paix n’a plus vraiment de sens avec des guerres ni déclarées ni conclues par un traité.
Pendant la phase de conquête de l’Irak (trois semaines en mars-avril 2003), les Américains ont perdu à peine quelques centaines d’hommes. Le président Bush ayant décrété la fin de la guerre après la chute de Bagdad, on aurait pu en conclure que ses soldats s’en tiraient à bon compte sur le plan des pertes. C’était oublier l’effet second de ces conflits bancals. Avec la phase asymétrique (2003-2008), d’attentats suicide en bombes de bord de route, les forces américaines ont perdu plusieurs milliers d’hommes. La plupart d’entre eux, bardés d’informatique et de technologie, sont d’ailleurs tombés sans avoir vu la couleur de leur adversaire rustique.
De tout temps, la motivation du soldat, sa conviction de se battre pour l’essentiel, lui ont permis d’affronter la mort. Le rapport psychologique à celle-ci, qui était globalement le même de part et d’autre, s’est modifié dans un certain nombre de conflits récents. Un monde sépare les combattants. Dans les nations nanties, modernes, hédonistes, l’ombre portée de la mort est de plus en plus écartée. Ce mouvement de fond est allé jusqu’à inciter les Etats-Unis, après leurs pertes en Somalie en 1994, à inventer le concept étonnant du « zéro mort » en opérations. D’où le recours privilégié aux frappes aériennes. La guerre et ses horreurs étaient mises à bonne distance. On comprend donc mieux le traumatisme profond de cette grande nation vivant dans l’utopie du « zéro mort militaire » quand elle s’est retrouvée, un beau matin de septembre, avec plus de trois mille morts civils en plein centre de New York, sans déclaration de guerre…
La mort, même militaire, est devenue un vilain mot qui n’a plus droit de cité. Cachez ce linceul kaki que je ne saurais voir ! Quel contraste avec ce qui peut se passer dans la tête d’un combattant du Hezbollah au Sud-Liban, dans un groupe de combat d’al-Qaïda en Irak ou chez les talibans d’Afghanistan. La mort y est accueillie avec ferveur. C’est une récompense prisée, une place assurée dans le carré des martyrs au cimetière et au Ciel,
en bonne compagnie. Ce choc des visions de la mort bouleverse la donne. Un jeune chef de section (24-25 ans) français, anglais, américain ou israélien, aura toujours en tête deux obsessions : réussir sa mission et ramener tout le monde à la maison. Sinon, il devra subir le choc de la perte d’un camarade, la vision de son corps déchiré, accepter le douloureux face-à-face avec sa famille, voire répondre à une enquête judiciaire suite à une plainte inspirée par un principe de précaution décalé dans cet univers. En face, dans la même situation de pertes au combat, la mort est sublimée et espérée. A ce degré de fanatisme, ce rapport à la mort est un avantage qui place le soldat des démocraties modernes en position de faiblesse.
Kalachnikov et clé usb
Parallèlement, la guerre fait son miel des avancées technologiques. Les insurgés eux-mêmes les intègrent. Ils surfent sur le Net. Leurs commandements ont leur propre site (on estime à plus de cinq mille les sites proches du jihad radical), mettent en ligne textes et images (attentats, décapitations, modes de fabrication d’une bombe, etc.), surveillent ce qui se dit dans les pays cibles. Sur le terrain, en Afghanistan, en Irak, il n’est pas rare de trouver sur le corps d’un insurgé ou d’un milicien une Kalachnikov, mais aussi une clé USB ou un BlackBerry. Lors de l’assaut de Bombay (Inde), en décembre 2008, par des commandos terroristes visant grands hôtels, restaurants, gares et centre culturel juif, les combattants surarmés étaient équipés d’ordinateurs de poche. En base arrière, leur commandement, branché sur les télévisions en continu du monde entier, pouvait instantanément leur renvoyer le reflet de leur effet terreur, ainsi que de nouveaux ordres en direct pour l’amplifier.
Une action terroriste est souvent, en premier lieu, une action de communication (au sens de l’action psychologique) avant d’être un acte de guerre stricto sensu. L’effet de sidération et de terreur qui en résulte est ainsi démultiplié par rapport à la faiblesse des moyens militaires engagés. Le rapport coût/efficacité est favorable à l’acteur terroriste : petite mise militaire, gros bénéfice médiatique (c’est bon pour l’influence et le recrutement). La boucle est bouclée, la modernité est mise au service de l’action militaire rustique.