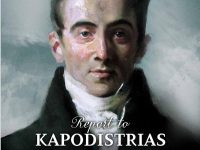Au Bangladesh, les ouvriers de l’industrie textile s’usent toujours pour un «salaire de misère»

L’année passée, des milliers de travailleurs du secteur de l’habillement ont mené une grève historique au Bangladesh. Touchés par l’inflation, ils sont rémunérés en deçà du seuil de pauvreté. Mais leurs demandes pour de meilleures conditions de travail ont été violemment réprimées. À la veille des élections législatives, prévues le 7 janvier, la pression demeure sur les petites mains de la deuxième industrie textile mondiale, qui ont repris le chemin des usines sans avoir obtenu satisfaction.
Le dos voûté sur sa machine à coudre, une femme voit sa bobine de fil s’épuiser à mesure que les pantalons se succèdent. Dans une usine voisine, à Dacca, capitale du Bangladesh, un homme appose sans relâche des strass sur des t-shirts à l’aide d’une pince à épiler. Un autre coud des chemises à la chaîne pour de grandes marques occidentales, qui vendront la pièce à un prix égal à son salaire mensuel.
Au total, les quelque 4 000 usines de confection du Bangladesh emploient près de quatre millions de travailleurs afin d’approvisionner le secteur de l’habillement, qui compte pour 85% de ses 55 milliards de dollars d’exportations annuelles. Pourtant, si le pays est le deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine, il est aussi l’un de ceux qui rémunèrent le moins ses travailleurs.
En novembre 2023, des dizaines de milliers d’ouvriers de l’industrie textile bangladaise ont alors battu le pavé pour réclamer une hausse du salaire minimum mensuel. « Ils ont été confrontés à un niveau de répression sans précédent », regrette Bogu Gojdź, porte-parole de Clean Clothes Campaign, une organisation basée aux Pays-Bas qui milite pour les droits des ouvriers du textile.
Un « endettement perpétuel » pour joindre les deux bouts
De ses onze à ses dix-neuf ans, Nazma Akter a été les petites mains d’une usine de Dacca. Bercée par le bruit mécanique incessant des machines à coudre, elle se souvient avoir dû travailler jusqu’à quatorze heures par jour, sans aucun jour de repos. « Quand on est pauvre, le salaire de misère, c’est toujours mieux que rien », lance celle qui préside désormais la Sommilito Garments Sramik Federation, qui représente plus de 100 000 travailleurs du secteur de la confection au Bangladesh.
Comme d’autres, Nazma a dû sacrifier son éducation et travailler dans la même usine que sa mère pour survivre. « Les travailleurs sont souvent obligés de retirer leurs enfants de l’école pour les faire travailler, ou de fouiller les poubelles pour se nourrir, confirme Bogu Gojdź. De nombreux travailleurs bangladais se retrouvent dans une situation d’endettement massif, avec des prêts à taux prédateurs, juste pour joindre les deux bouts. » Ainsi, les heures supplémentaires deviennent monnaie courante pour faire face à une inflation galopante, qui avoisine les 10%, et espérer atteindre un salaire convenable. Selon le Worker Rights Consortium (WRC), celui-ci s’élèverait à environ 20 000 takas, soit 166 euros mensuels, en faisant deux à quatre heures supplémentaires par jour.
Toujours est-il que, d’après un rapport de l’Institut d’études sur le travail du Bangladesh (BILS) publié en janvier 2023, l’intégralité des travailleurs interrogés ne bénéficient pas d’un revenu suffisant pour leur permettre de se nourrir correctement. Deux tiers d’entre eux souffrent d’un « endettement perpétuel » qui s’élève en moyenne à 70 000 takas, soit environ 580 euros. Dans cette industrie composée de 60 à 80% de femmes, « les travailleuses nous parlent des rythmes de travail, des objectifs de rentabilité complètement irréalistes, des droits sociaux quasi inexistants. On évoque également des produits chimiques toxiques, des machines dangereuses et des personnes qui sont obligées de travailler debout toute la journée », souffle Salma Lamqaddam, en charge du plaidoyer droit des femmes au travail et dans l’industrie textile pour l’ONG ActionAid.
20 000 travailleurs font l’objet de poursuites
À l’occasion de la révision du salaire minimum bangladais, qui intervient une seule fois tous les cinq ans, les ouvriers du secteur ont milité en espérant faire grimper son montant de 8 300 takas (70 euros), fixé en 2018 par le gouvernement, à 23 000 takas (190 euros). « L’enjeu était vraiment important pour les travailleurs de l’habillement, car cette révision du salaire minimum était la seule occasion avant cinq ans d’obtenir un salaire digne qui serait juridiquement contraignant, d’où l’intensité des protestations », explique Bogu Gojdź.
Les manifestations, lors desquelles près de 300 usines ont fermé et au moins quatre travailleurs ont perdu la vie, ont mis à l’arrêt ce secteur clé de l’économie bangladaise, qui approvisionne des géants de la mode tels que H&M, Levi’s, Zara et Gap. Au terme de plusieurs négociations, le salaire minimum a été porté à 12 500 takas (104 euros) le 7 novembre, soit une augmentation de 56%. Un montant jugé insuffisant pour les syndicats et qui reste en deçà du seuil de pauvreté fixé à 23 000 takas mensuels par le BILS. « Il ne s’agit que d’une augmentation de 14% si l’on tient compte de l’inflation », précise Bogu Gojdź.
À l’approche des élections législatives bangladaises, qui se dérouleront le 7 janvier prochain, « les travailleurs sont toujours confrontés à des représailles », rappelle la porte-parole de Clean Clothes Campaign. « S’ils descendent dans la rue pour protester à l’instigation de quelqu’un, ils perdront leur emploi, leur travail et devront retourner dans leur village », avait menacé Sheikh Hasina, Première ministre du Bangladesh, qui s’apprête à briguer son quatrième mandat. Si Clean Clothes Campaign peine à identifier tous les ouvriers concernés, l’organisation fait toutefois état d’au moins 3 000 à 4 000 travailleurs licenciés à la suite des manifestations, de 20 000 qui font l’objet de poursuites et risquent d’être arrêtés ainsi que d’au moins 131 qui sont toujours en état d’arrestation.
De leur côté, les syndicats, obligés de mettre fin à la mobilisation après la violente répression policière, préviennent qu’elle reprendra si les revendications ne sont pas satisfaites. « Pour l’instant, on se concentre sur aider les travailleurs qui ont perdu leur travail et qui sont détenus, mais nous récupérons aussi des forces pour continuer notre combat », affirme Nazma Akter, tout en dénonçant la surveillance et les intimidations que subit le syndicat depuis.
Les marques, des « donneuses d’ordre »
Au-delà de pointer du doigt le gouvernement bangladais qui souhaite maintenir des salaires compétitifs, les organisations appellent aussi à une prise de conscience de la part des marques occidentales. « On les appelle les « donneuses d’ordre » », peste Salma Lamqaddam. « Les sous-traitants nous disent qu’ils ne peuvent pas aller au-delà des 12 500 takas qui ont été actés, car ils sont pieds et poings liés par les acheteurs, donc les marques. Ce sont elles qui dictent, tout en restant à l’ombre, les prix de l’industrie. »
Alors que plus de 75% des exportations bangladaises de vêtements étaient destinées à l’Europe ou aux États-Unis en 2019, Clean Clothes Campaign fustige l’absence de prise de position de ces multinationales pour lesquelles les ouvriers textile s’affairent activement. « Rien n’empêche H&M ou Puma, par exemple, d’augmenter les salaires, de dénoncer publiquement les répressions auxquelles les travailleurs sont confrontés, ou d’enquêter sur leur chaîne d’approvisionnement et de faire savoir à leurs fournisseurs que menacer les travailleurs d’arrestation, de licenciement ou de brutalité policière ne sera pas toléré », détaille Bogu Gojdź.
Si plusieurs enseignes de mode internationales, dont Abercrombie & Fitch, Adidas et Puma, ont demandé au gouvernement de veiller à ce qu’il n’y ait pas de représailles contre les travailleurs qui réclament des salaires équitables, les organisations dénoncent une « hypocrisie ». « Tout ce qu’elles font, c’est s’assurer une bonne affaire : le coût de la main-d’œuvre continuera à baisser alors que le coût de la vie au Bangladesh augmente et que les travailleurs seront maintenus dans ce cycle de pauvreté pendant cinq années supplémentaires », martèle Bogu Gojdź. D’après les estimations du WRC, si l’inflation au Bangladesh se poursuit au rythme actuel, la hausse salariale en cours verra sa valeur complètement érodée d’ici à 2026. À cette date, les travailleurs gagneront, en termes réels, moins que ce qu’ils perçoivent actuellement.