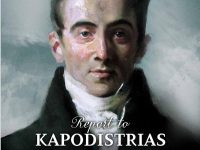Turkiye. « Toujours plus indispensable et toujours plus insupportable » : l’Europe face à l’équation turque d’Erdogan

RECEP Au centre de la géopolitique mondiale, la Turquie d’Erdogan reste un allié militaire essentiel pour l’Europe, tout en s’éloignant toujours plus de ses valeurs démocratiques.
Pilier du flanc sud-est de l’Otan au carrefour des trois principales zones de crise que sont l’espace post-soviétique, le Moyen-Orient et les Balkans, la Turquie n’a jamais été aussi essentielle stratégiquement depuis la fin de la guerre froide. Mais jamais aussi depuis l’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union Européenne à l’automne 2005 après d’importantes réformes démocratiques impliquées par sa candidature, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan n’a paru aussi loin de satisfaire aux critères des « 27 ». Le président turc dont le règne de vingt-trois ans à la tête du pays, d’abord comme Premier ministre puis comme chef de l’État, est déjà le plus long de l’histoire républicaine et impose un régime toujours plus autoritaire et répressif. Désormais, il s’attaque ouvertement à la principale force de l’opposition, le CHP, le parti républicain du peuple fondé il y a 102 ans par Mustafa Kemal en même temps que la République laïque inspirée du modèle jacobin.
Que faire avec cette « puissance opportuniste » selon le mot de Dorothée Schmid, (responsable du programme Turquie Moyen-Orient de Institut Français des relations internationales) toujours plus indispensable et toujours plus insupportable ? Le casse-tête turc des Européens tient dans cette équation.
Un acteur incontournable pour l’Europe
Par son activisme en politique étrangère, à la fois agressif avec un discours nationaliste et religieux fort, et diplomatique se posant en médiateur dans les diverses crises régionales, le Reis comme l’appellent ses partisans a fait de son pays un interlocuteur incontournable. Il est impossible d’imaginer une autonomie stratégique du Vieux Continent sur fond de retrait progressif des Etats – Unis sans les 800 000 hommes de l’armée turque, la plus importante en nombre d’hommes après celle des Etats-Unis, alors que le pays développe en outre une industrie de défense des plus performantes.
Même si elle moins vocale que la France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne, la Turquie joue depuis le début un rôle actif dans la « coalition des volontaires » et le projet d’une force militaire de réassurance qui serait déployée en Ukraine après un arrêt des combats afin de donner des garanties de sécurité à Kiev. La flotte turque est essentielle dans une mer Noire en passe de devenir un lac otanien où les navires russes, sévèrement étrillés depuis le début du conflit par les drones navals ukrainiens, ne quittent plus guère leurs ports de l’est.
En outre Ankara qui contrôle les détroits – le Bosphore et les Dardanelles – applique à la lettre la convention de Montreux de 1936, bloquant le passage à tous les navires des forces belligérantes empêchant ainsi Moscou de remplacer ses pertes alors que plus du tiers des unités de la flotte de la mer Noire ont été mises hors de combat.
Erdogan veut fermer la « parenthèse » démocratique de la Turquie
Il est néanmoins tout aussi difficile de traiter avec cette Turquie toujours plus imprévisible et bien décidée à jouer sa propre partition sur fond de nostalgies néoottomanes. « Recep Tayyip Erdogan veut fermer une parenthèse de deux siècles d’histoire turque tournée vers l’Occident » souligne Ahmet Insel, universitaire et auteur notamment de La nouvelle Turquie d’Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire (La Découverte), pointant sa volonté de revanche sur l’héritage républicain laïque de Mustapha Kemal et contre l’Europe occidentale accusée de poursuivre les desseins des Croisés et des colonialistes.
Au risque de réveiller de vieux démons de l’histoire Il se complaît à évoquer les « frontières du cœur » de la Turquie qui vont bien au-delà de ses limites actuelles fixées par le traité de Lausanne de 1923. Mais en parole tout au moins le leader turc continue à affirmer sa volonté d’adhérer à l’Union Européenne alors même que le processus de négociation est depuis des années plongé dans un coma profond, voire irréversible. Nul n’y croit plus vraiment parmi les « 27 » du moins tant qu’Erdogan restera au pouvoir.
Le Reïs, assume pleinement une diplomatie tous azimuts, sans pour autant rejeter les traditionnelles alliances occidentales à commencer par l’Otan perçue comme la meilleure des garanties de sécurité. Il n’hésite ainsi pas à courtiser les Brics et l’Organisation de la Coopération de Shangaï, deux regroupements informels dominés par la Russie et la Chine qui prétendent représenter le sud global et ces pays émergents ou déjà immergés, qui veulent leur place, voire pour les plus disrupteurs, remplacer l’ordre international dominé par les autorités israéliennes, et en tout premier lieu avec Benyamin Netanyahou, sont exécrables, ce qui le met en porte à faux pour jouer un rôle à Gaza après un cessez-le-feu dans une future force de stabilisation pour laquelle les militaires turcs cochent la double case d’être à la fois membres de l’Otan et ressortissants d’un pays musulman ami de la cause palestinienne.
Recep Tayyip Erdogan ne cesse de clamer que la Turquie est un pont entre l’Orient et l’Occident, avec un pied dans chacun des deux mondes. Et il joue magistralement ses cartes dans des relations transactionnelles qui lui ont permis d’obtenir de juteux accords avec l’UE en 2016 pour bloquer les flux d’immigrants. Ou de conserver des liens avec Poutine en violant allégrement les sanctions, notamment sur les hydro carbures, tout en soutenant militairement l’Ukraine. Un jeu efficace qui a permis à la diplomatie d’Ankara de jouer les médiateurs et d’héberger à Istanbul des rencontres entre des délégations des deux belligérants.
A la tête d’une Turquie qui se pose en acteur majeur sur la scène régionale et bien au-delà, notamment en Afrique où elle s’active aussi bien commercialement que diplomatiquement, Recep Tayyip Erdogan est redevenu un allié fréquentable. Fini les échanges de noms d’oiseau avec Emmanuel Macron. Les deux présidents se parlent souvent, en premier lieu à propos des enjeux ukrainiens mais aussi du Moyen-Orient.
La Turquie au centre de la géopolitique planétaire
Le Reis, qui a des liens profonds avec le Hamas, comme lui issu de la mouvance des Frères Musulmans, se revendique depuis des années en héraut de la cause palestinienne, ce qui lui vaut une incontestable popularité dans la rue arabe. Certes, ses relations avec les autorités israéliennes, et en tout premier lieu avec Benyamin Netanyahou, sont exécrables, ce qui le met en porte à faux pour jouer un rôle à Gaza après un cessez-le-feu dans une future force de stabilisation pour laquelle les militaires turcs cochent la double case d’être à la fois membres de l’Otan et ressortissants d’un pays musulman ami de la cause palestinienne.
Mais cela ne l’empêche d’avoir d’excellentes relations avec Donald Trump. Ankara pourrait même bientôt renvoyer à la Russie les systèmes de défense antiaérienne S 400 dont l’acquisition avait créé une sérieuse crise avec l’Alliance. La Turquie s’affirme comme la principale puissance régionale face à un Iran profondément affaibli par ses défaites face à Israël et en concurrence directe avec l’Arabie saoudite.
Mais il y a l’autre face du Janus turc qui embarrasse les Européens même s’ils gardent profil bas dans leurs protestations. Maire CHP du Grand Istanbul, et favori pour une future présidentielle, Ibrahim Imamoglu est depuis des mois derrière les barreaux pour des accusations de corruption pour le moins sujettes à caution. Une autre procédure a été ouverte à son encontre pour annuler son diplôme universitaire qui aurait été un faux afin de lui interdire toute candidature pour la charge suprême. Le CHP avait conquis de haute lutte au printemps 2019 avec Imamoglu la tête de cette métropole de plus de 15 millions d’habitants qui a elle seule pèse pour un tiers du PIB du pays. Il avait triomphé à nouveau lors des municipales de juin 2024 s’affirmant comme la première force politique du pays. Dès lors la mise hors jeu de ce parti et ses dirigeants est devenue une urgence pour le régime.
« L’objectif principal voire unique de Recep Tayyip Erdogan est de rester à tout prix à la tête de l’État afin de préserver cette nouvelle Turquie conservatrice, nationaliste islamiste voire bigote qu’il a créé en presque un quart de siècle, et qui se disloquera inévitablement s’il perd le pouvoir » pointe Ahmet Insel. Or en interne les nuages s’accumulent. L’inflation atteint selon les données officielles 39 % sur les douze derniers moins, voire 60 % à en croire des économistes indépendants. Les inégalités se creusent de plus en plus et la base populaire de l’AKP en fait les frais, d’où l’affaiblissement croissant de ce parti qui avait été la première force politique du pays depuis 2002. Face à cette grogne croissante, le régime mise sur la répression. Les arrestations de maires à Istanbul ont suscité des manifestations de protestations dans tout le pays dont l’ampleur a pris de court le pouvoir. Il s’inquiète d’autant plus que le CHP se crédibilise de plus en plus comme alternative politique.
Erdogan va tout faire pour rester au pouvoir
Recep Tayyip Erdogan veut pouvoir se présenter pour un troisième mandat à la tête du pays, ce que lui interdit la Constitution. Cela implique ou une dissolution du parlement, pour une présidentielle anticipée à laquelle il pourrait participer puisque son second mandat n’aurait pas été achevé. Ou un changement de Constitution. Mais même avec ses alliés ultranationalistes il ne dispose pas de majorité suffisante.
D’où l’ouverture au parti kurde lancée il y a plusieurs mois avec l’assouplissement du régime de détention d’Abdullah Ocalan, le leader historique de la guérilla kurde du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) qui a mené la lutte armée contre Ankara qui a fait plus de 60 000 morts depuis les années 1980. Le leader du PKK a appelé ses partisans à déposer les armes. Quelques petits gestes symboliques ont été faits mais ce processus de paix reste balbutiant. Plus de 75 % des Turcs soutenaient lors de l’ouverture des négociations d’adhésion une future intégration de leur pays à l’Union. Malgré les désillusions, le rêve européen d’une grande partie de la société civile turque reste bien vivant. Il est donc plus nécessaire que jamais que les Européens accentuent les pressions sur Ankara en même temps qu’ils s’ouvrent à une coopération beaucoup plus étroite qui ne soit pas seulement militaire.