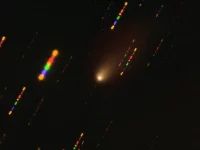Science. Île de de Pâques, Chichén Itza… Quand l’ADN fossile livre une autre histoire

THEORIE Des analyses récentes en archéogénétique permettent d’éclairer les zones d’ombre qui pèsent encore sur l’histoire de nos ancêtres. Quitte à bouleverser les interprétations données jusque-là, comme à Rapa Nui ou dans la célèbre cité maya.
L’île de Pâques, ou Rapa Nui en langue polynésienne locale, est régulièrement présentée comme l’exemple parfait du suicide écologique : là, au cœur de l’océan Pacifique, les habitant·es de cette terre émergée d’à peine 164 kilomètres carrés auraient signé leur perte en surexploitant ses ressources naturelles, notamment ses arbres, pour construire des statues monumentales, les moaïs. Un déclin mortifère de la population, au XVIIe siècle, aurait suivi, bien avant l’arrivée des colons européens, en 1722.
Cette théorie, popularisée notamment par le chercheur américain Jared Diamond dans son essai Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie,vient, ironiquement, de s’effondrer avec la publication d’une récente étude dans la revue Nature.
Celle-ci s’est intéressée aux dépouilles de quinze anciens îliens conservées dans les réserves du muséum national d’Histoire naturelle, à Paris, à la suite de deux expéditions réalisées en 1877 et 1935. Or l’analyse du génome de ces individus, dit « ADN ancien » ou « ADN fossile », n’a montré aucune évidence de crash démographique dans les années 1600, battant en brèche la théorie de l’écocide.
À Rapa Nui comme ailleurs, l’archéogénétique donne parfois les clés d’une autre histoire. Depuis des siècles, celle-ci nous est rendue accessible grâce au travail d’archéologues, de linguistes, de botanistes, d’écologues, de géologues… En étudiant les vestiges d’un site, ils nous racontent les lieux de vie de nos ancêtres, les évolutions socioculturelles les ayant affectés, l’environnement dans lequel ils vivaient ou encore les bouleversements naturels qui les ont touchés.
Épidémie et esclavagisme
En plongeant dans l’ADN ancien, une nouvelle strate a été dévoilée aux scientifiques, plus intime : quels liens biologiques entretiennent des individus ensevelis à tout jamais dans un même tombeau, d’où viennent-ils, comment leur environnement, leur culture, les migrations mais aussi les maladies ont-ils laissé des traces dans leur génome ?
Dans le cas de Rapa Nui, une équipe dirigée par Anna-Sapfo Malaspinas, à la tête du groupe génomique des populations à l’université de Lausanne, a tenté de faire parler cet ADN ancien pour répondre à une question fondamentale : comment la population de la petite île chilienne a-t-elle évolué au cours du temps ? Lorsqu’une espèce subit des événements marquants, comme des évolutions démographiques, ceux-ci laissent des « signatures » dans le génome.
« Pour résumer, plus la taille de la population est importante, plus sa diversité génétique est grande. Au contraire, un déclin de la population s’accompagne d’une diminution de la diversité génétique », explique Anna-Sapfo Malaspinas. Grâce aux différences contenues dans le génome des quinze anciens îliens, et à de puissants modèles mathématiques, les chercheurs ont ainsi pu reconstruire le nombre d’individus « génétiques » vivant à différents instants sur Rapa Nui.
La tragédie commence seulement en 1722, lorsque les colons européens débarquent sur l’île.
« Nous avons testé différents scénarios, avec et sans l’effondrement démographique qui serait intervenu en 1600. L’idée est de comparer ce que prédisent ces trajectoires avec ce qu’on observe dans la réalité : or, sans effondrement, les données issues de nos modélisations ressemblent beaucoup aux données démographiques réelles », assure la scientifique.
Selon ce nouveau travail, la population aurait augmenté progressivement depuis 1250 et l’arrivée de Polynésiens, premiers habitants sur l’île, atteignant un pic juste avant l’arrivée des Européens, en 1722. Cette limite haute n’aurait cependant jamais dépassé les 3 000 personnes, ce qui concorde avec les écrits des premiers colons, mais diverge des estimations de 15 000 à 20 000 personnes sur lesquelles se base la théorie de l’écocide.
Pour Anna-Sapfo Malaspinas, « dès qu’on remet en cause ce chiffre de 15 000 à 20 000 habitants, plus rien ne tient. Non seulement l’hypothèse de l’effondrement n’a plus de fondement, mais cela nous interroge aussi sur les biais des auteurs qui la défendent : leur vision sur les peuples indigènes, qu’ils voient comme des populations promptes à s’entretuer dans des guerres tribales, à pratiquer le cannibalisme, n’a-t-elle pas influencé leur interprétation des données ? Ils présentent l’histoire de Rapa Nui comme une défaite de la culture des peuples autochtones, alors que la réalité est bien différente ».
L’effondrement démographique a bien eu lieu – mais les dates et ses causes n’ont rien à voir avec celles avancées par les tenants de l’écocide. La tragédie commence seulement lorsque les Européens débarquent sur l’île, n’hésitant pas à tuer les habitant·es et important des maladies contre lesquelles les îlien·nes n’étaient pas immunisé·es. Plus tard, dans les années 1860, des esclavagistes péruviens ouvrent un nouveau sombre chapitre sur Rapa Nui, dont ils déportent près d’un tiers des habitant·es. Concomitamment, une épidémie de variole finit de décimer la population de l’île, qui chute à 110 personnes.
« Il ne faut pas voir l’archéogénétique comme une discipline indépendante, qui travaillerait seule et changerait tout, commente Anna-Sapfo Malaspinas. Nous apportons un nouvel éclairage, mais celui-ci repose sur des données accumulées par du travail fait avant nous par d’autres spécialistes, des archéologues, des linguistes, des anthropologues, etc. Des recherches tentaient déjà de montrer que la théorie de l’écocide faisait fausse route, et les arguments génétiques sont venus conforter cette autre piste. »
Le mythe des sacrifices de jeunes vierges
À 5 800 kilomètres au nord-est de Rapa Nui, dans le Yucatán au Mexique, l’archéogénétique vient également d’éclairer une autre histoire : celle de Chichén Itzá, une colonie maya qui avait émergé vers l’an 250 et pris subitement fin en 1697 avec la conquête espagnole de la région. Entre-temps, elle était devenue l’une des plus grandes et plus influentes cités mayas, faisant office de centre politique de cette civilisation.
Chichén Itzá est aujourd’hui l’un des sites archéologiques parmi les plus étudiés de la Mésoamérique. Cette cité est notamment très connue pour son cénote sacré, un puits naturel conduisant à une source d’eau souterraine – une richesse inespérée dans cette région très aride.
Depuis le début des années 1900, des opérations de dragage ont permis de remonter les mystères enfouis sous ces masses d’eau : des objets en or, ainsi que des squelettes humains, victimes de sacrifices. « De nombreux corps étaient ceux de femmes et quand cette information a gagné les médias grand public, l’idée selon laquelle c’étaient des jeunes femmes, vierges, sacrifiées dans le cadre de rituels de fertilité, s’est propagée. Mais à aucun moment, dans l’histoire mésoaméricaine, on ne retrouve cette injonction à devoir sacrifier des jeunes femmes “pures” », explique Rodrigo Barquera, chercheur au département d’archéogénétique de l’institut Max-Planck de Leipzig (Allemagne).
Avec ses collègues, le chercheur vient de signer une étude, également publiée dans Nature, sur l’ADN ancien de 64 squelettes d’individus sacrifiés, retrouvés à 300 mètres au nord-est du cénote sacré, dans un chultún, une citerne creusée à la main afin de stocker des réserves d’eau potable.
« C’est très rare de pouvoir extraire des données génétiques de restes humains retrouvés dans des environnements tropicaux. Les milieux sont très humides, la dégradation est très rapide, l’acidité parfois importante. Même les os, et leur matériel génétique, se dissolvent rapidement, décrit Rodrigo Barquera. Par chance, les corps découverts dans le chultún avaient été déposés dans des sortes de grottes fermées, où ils ont pu être préservés. C’était inespéré ! »
Des jumeaux suppliciés
Première surprise : l’analyse génétique des squelettes du chultún, dont le sacrifice aurait eu lieu sur une période de cinq cents ans, entre 600 et 1 100 après J.-C., montre que la totalité des victimes n’ont rien de jeunes vierges, mais sont des individus de sexe mâle. Des précédentes analyses avaient montré qu’aucun n’avait atteint l’âge adulte, et que la moitié avaient entre 3 et 6 ans.
Autre découverte stupéfiante : l’analyse de ces ADN anciens révèle qu’un quart des victimes ont des liens très proches de parenté, tels que des frères ou des cousins. Deux paires de jumeaux « vrais » sont également identifiées – une incongruité statistique quand on sait que ceux-ci ne comptent que pour 0,4 % des grossesses habituellement. Cette part de frères, de cousins et de jumeaux pourrait en réalité être bien plus importante encore, seuls 64 individus ayant pu être analysés sur la centaine de corps exhumés du chultún.
« Quand nous avons découvert ce résultat, nous n’en revenions pas. Nous avons refait les analyses au moins cinq fois, et fait tourner trois logiciels différents pour confirmer les données, s’étonne encore le scientifique. Il n’y avait jusqu’alors aucun autre site mésoaméricain dans lequel des sacrifices uniquement d’individus de sexe masculin avaient été identifiés, et encore moins de jumeaux. Ce que l’archéogénétique nous a permis de trouver change l’histoire véhiculée jusque-là sur Chichén Itzá, celle-ci est désormais bien plus riche. »
Même si elle n’avait encore jamais été attestée physiquement, la présence de jumeaux sur un site sacrificiel n’étonne cependant pas les chercheurs et chercheuses, du fait de l’importance donnée aux jumeaux dans la mythologie maya. Ceux-ci, ainsi que le thème du sacrifice, sont en effet centraux dans un des textes sacrés mayas, le Popol Vuh : des jumeaux, Hunahpu et Xbalanque, y affrontent les dieux des Enfers afin de venger leur père et leur oncle, également jumeaux, qui avaient été assassinés.
Chez les Mayas, on croyait que ces sacrifices devaient être réalisés pour que l’univers continue. Qui se serait risqué à voir l’univers disparaître en ne pratiquant pas ces rituels ?
Rodrigo Barquera, chercheur en archéogénétique de l’institut Max-Planck de Leipzig
« Ce lien avec les textes mythologiques suggère que ces jeunes garçons avaient été sélectionnés pour ces sacrifices du fait de leurs liens biologiques, explique Rodrigo Barquera. Ces rites nous semblent sordides au XXIe siècle, mais il faut comprendre que le système de pensée, chez les Mayas, était radicalement différent : on croyait alors que ces sacrifices devaient être réalisés pour que l’univers continue. Qui se serait risqué à voir l’univers disparaître en ne pratiquant pas ces rituels ? »
Les analyses des génomes des suppliciés de Chichén Itzá ont eu une autre conséquence, cette fois très contemporaine : ceux-ci sont génétiquement liés aux habitant·es autochtones actuel·les de la région, en quête d’affirmation de leur identité maya. « Ils ont l’espoir que les nombreux visiteurs du site changent leur comportement : ceux-ci encensent la magnificence de Chichén Itzá, mais à peine sortis des ruines, accumulent les actes et commentaires racistes envers les descendants des Mayas », explique le chercheur.
Cela pourrait aussi encourager les institutions à porter un autre regard sur les communautés locales : non seulement elles ne sont jamais consultées au sujet du site, mais elles n’y ont même pas accès. À Rapa Nui aussi, les analyses menées pourraient avoir une application très concrète : le rapatriement des dépouilles des quinze îliens, arrachés à leurs terres natales par des scientifiques français.