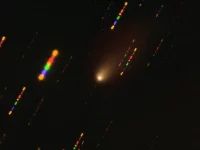Rencontre avec Jean-Luc Godard : « On ne peut pas parler »

CHIEN LOUP À l’heure où les bouleversements politiques, écologiques et sociaux semblent marquer la fin d’une époque, Mediapart a eu envie de rendre visite à Jean-Luc Godard, dont les films sont des mises en abyme inégalées des beautés et des troubles du monde. Mais rien ne s’est passé comme prévu.
3 décembre 2021 à 19h31
Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que l’entretien ne se déroulerait pas comme nous l’avions espéré. En débarquant à Rolle (Suisse), en bordure du lac Léman, un jour pluvieux de novembre, nous n’avions qu’une certitude : le cinéaste, 91 ans ce vendredi 3 décembre, avait accepté, en dehors de tout calendrier lié à la sortie d’un film, le principe d’une interview.
Onze ans après un premier entretien accordé à Mediapart et une rencontre publique au Cinéma des cinéastes à Paris, c’était l’occasion de revoir un immense artiste, dont Le Livre d’image, son dernier film en date (encore visible sur Arte), nous avait éblouis. Nous pouvions rencontrer le cinéaste pendant une heure au moins, peut-être plus, à partir du milieu de matinée. Chez lui, à quelques encablures du lac. Pas de photos ni de caméra. Et un binôme « paritaire », avait-il pris soin de nous communiquer, pour l’interroger.
Le rendez-vous avec Jean-Luc Godard a été organisé grâce à l’aide de son ami, l’historien et poète palestinien Elias Sanbar – il apparaît dans Film Socialisme (2010). Quelques jours avant l’interview, il nous décrit un Godard implacable observateur des rouages de la télévision française – en particulier des chaînes d’info en continu.
Alors que Bruno Dumont a présenté cette année France, dont l’héroïne, jouée par Léa Seydoux, est une présentatrice vedette d’une pseudo-BFMTV, le fait que deux cinéastes majeurs, et de générations différentes, se penchent sur les maux de la télévision française n’est sans doute pas anodin. Nous avions envie de connaître le « regard » de Godard sur ces images.
À notre arrivée, il nous accueille dans son salon, où tout a été préparé pour la rencontre : deux fauteuils sont disposés face au sien, une petite table pour y déposer nos affaires. Godard nous serre la main dès l’arrivée. Nous demandons l’autorisation de retirer nos masques. Il accepte, s’enfonce dans son fauteuil, dos à la fenêtre. Derrière nous, un écran plasma éteint.
Sur le mur, à sa droite, la reproduction monumentale d’un portrait noir et blanc d’une femme, que nous avons tardé à identifier au fil de la conversation, au risque de le décevoir : la philosophe Hannah Arendt, dans ses jeunes années. Assis sur les premières marches de l’escalier qui mène à son bureau et à sa salle montage, dans la pièce mitoyenne au salon, son assistant Jean-Paul Battagia écoute, à distance, l’entretien. Il est 10 heures du matin, une conversation s’esquisse.
On est très heureux de vous rencontrer.
Jean-Luc Godard : Oui, je me suis demandé pourquoi.
Vous avez accepté cette demande d’entretien à un moment qui, politiquement, nous préoccupe.
Oui, j’entends bien.
Avant la présidentielle française, avec la montée d’Éric Zemmour, les craintes d’une extrême-droitisation du débat public… Ce moment politique vous intéresse-t-il ?
Pourquoi moi ? Il y a longtemps que je suis en dehors de tout ça.
Vous suivez un peu les débats politiques, les émissions à la télévision ?
Oui, tout à fait, mais… J’ai quitté le cinéma classique tel qu’il se fait. Sur le fond, il ne m’intéresse plus beaucoup, qu’il soit à la télévision, sur un grand écran ou sur Netflix. Il ne m’intéresse pas parce que c’est trop plat. La Terre pour moi n’est pas plate. Depuis très longtemps, j’étais contre, un peu contre, l’abus du texte, l’abus du scénario et d’autres choses. Et l’affection que j’avais pour la peinture un peu classique, jusqu’aux impressionnistes, m’a aidé, d’une certaine façon, parce qu’ils étaient en dehors des journaux.
Cézanne était ami avec Zola, mais c’étaient deux mondes différents. Et je me suis plutôt rangé du côté de Cézanne. Cézanne peut-être ne s’en fichait pas de Dreyfus, mais il ne militait pas pour Dreyfus comme Zola. Et donc, moi, je ne milite pas avec vous. Du reste, je n’ai pas accepté de prendre un abonnement à Mediapart à l’époque parce que ça me paraissait antinomique avec quelque chose du cinéma.
En quoi cela vous semblait-il antinomique ?
Parce qu’ils impriment sur papier ou sur la télévision, alors qu’ils devraient au minimum faire des films ou autre chose… Mais c’est le monde qui devient comme ça. Et je ne me trouve pas intéressant. Pendant longtemps, je me suis trouvé intéressant. Parce que les gens me parlent de moi. De ce que j’ai fait. Et en plus, je ne peux plus leur parler, même s’ils ne me parlent pas de moi. Parce que je suis forcé de parler la langue de mes concitoyens.
Je m’aperçois que je ne regarde pas
Et quand je dis la langue, c’est toutes les langues. Si on était tchèques, on parlerait tchèque – je dis encore tchécoslovaque. Si on était russes, on parlerait russe. Si on est français, on parle français. Mais tout ça, c’est l’alphabet. Et quand j’ai vu que Google allait sûrement s’appeler Alphabet, je me suis dit : « Ça y est, c’est fait. » Et donc le grand coupable, pour moi, s’il faut employer le mot coupable, ou une espèce de promoteur, ou le diable, si on est religieux, c’est l’alphabet.
Pourquoi ? Le grand coupable de quoi ?
Mais parce que les lettres – qui sont ensuite devenues des chiffres –, on peut les tordre dans tous les sens. Si on lie ça un peu à Cézanne, disons aux images pour employer le mot courant, eh bien, on peut survivre. Si on ne le fait pas, si on ne fait qu’interpréter une image, ou une image donnée comme les caricatures, ça ne sert à rien. Donc je suis assez seul, dans une prison comme ça.
[Tout] ce que je vous dis n’est pas intéressant, car ce n’est que de moi qu’il s’agit. On devrait être ici et vous, si vous étiez dans mon domaine, qui est très vaste, vous devriez me dire : « Ah, dans tel film », ou peu importe dans un autre film aujourd’hui ou dans une image de la télévision qu’on peut brancher, vous devriez dire : « Est-ce que ça va ? », « Est-ce que ça ne va pas ? »
Au lieu de ça, vous me parlez de moi. Ça ne m’intéresse pas. Je le fais gentiment pour voir une dernière fois ce que c’est un des atomes de la gauche en France. J’estime toujours la gauche, mais je la mets à gauche. C’est pas intéressant. C’est pas intéressant. Les gens confondent langage et langue, y compris la science. Bien sûr, je m’intéresse toujours à tout ça car j’ai toujours deux pieds sur terre. Donc je crois qu’on ne peut pas parler. Je crois qu’on ne peut pas parler.
*****
À ce stade de l’entretien, nous aurions pu prendre acte du constat d’échec que Jean-Luc Godard était en train de dresser et partir. « On ne peut pas parler », énoncé deux fois : le message est clair. Mais par un mélange d’obstination, de curiosité, d’admiration pour son œuvre et de fascination pour l’étrange situation qui était en train de se mettre en place, nous sommes restés. À partir de cet instant, le questionnaire précis que nous avions préparé et ordonné devient caduc. Nous sommes donc soulagés quand le cinéaste prend l’initiative de parler de ses chiens.
Jean-Luc Godard : On s’est mis avec Anne-Marie [Miéville, sa femme – ndlr] à prendre des chiens, que l’on a récoltés dans des refuges – le dernier y compris en Espagne. Parce que les chiens, c’est intéressant : si vous les regardez, ils ont tout dans le regard. Nous, on n’a rien dans le regard. J’ai longtemps cru que j’avais quelque chose dans le regard comme cinéaste, aujourd’hui je ne le crois pas. Vous me regardez, je vous regarde mais on n’exprime rien par ce regard.
Un peu, quand même ?
Non, rien du tout. Vous avez une intention derrière votre regard, mais quand vous comparez votre regard, ou celui de n’importe qui à la télévision, au regard d’un chien – je ne connais pas assez d’autre animal –, ou, disons, le cheval ou le poisson, mais je ne m’y connais pas assez, on ne regarde pas. On voit, mais on parle de ce qu’on voit. Les animaux ne font pas ça. Ils ont une bouche, pourtant. C’est autre chose.
Avec les yeux, vous regardez. Vous êtes comme une caméra. Je regarde aussi. Mais sans plus puisque je parle notre langue et que je ne parle pas autre chose. Donc chaque fois qu’on dira un mot de plus, il n’est pas utile. Je le fais par curiosité, pour voir quels sont ces gens qui disent : « Il faut changer le monde », « il faut être contre le charbon », ou être comme ça… Ce n’est pas que ça m’amuse, je me fais pitié à moi-même de m’intéresser encore à ça. Mais comme je suis encore sur Terre, que j’ai quelques années à vivre, je le fais voilà. C’est tout.
Mais on ne vient pas sonder votre âme ou vous demander pourquoi vous avez fait ci ou ça. Ce qui nous intéresse, c’est de capter un petit peu de ce que votre regard à vous voit du monde dans lequel on est.
Mais je vous dis, je m’aperçois que je ne regarde pas. Les chiens regardent. Je trouve que je ne sais pas regarder comme eux. Car je parle tout de suite. Je parle tout de suite. Depuis l’invention de l’alphabet, on est un peu maudits. Si le diable est dans les détails, il est dans les détails des 26 lettres qui sont devenues très vite, grâce aux mathématiciens, des milliards et des milliards de chiffres. Je ne dis rien d’autre.
*****
L’hypothèse que l’invention de l’écriture a coupé les humains de leurs relations symbiotiques avec les autres espèces vivantes est au cœur d’un livre magnifique du philosophe David Abram, Comment la Terre s’est tue. Nous lui soumettons cette idée et cette référence. Il nous renvoie dans nos cordes : « S’il n’a fait qu’écrire, c’est pas intéressant. Il fait comme moi. On ne peut pas s’empêcher de parler. On ferait mieux de faire comme les loups et le mouton. » Et encore : « Mais ce n’est pas intéressant tout ce qu’on dit. C’est inintéressant. Alors, je voulais voir encore des gens qui trouvent intéressant quelque chose comme ça, une fois, comme si je revisitais un ancien lieu où j’ai été, en voyant ce qu’ils sont devenus. Voilà. »
Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, c’est pour ça que j’ai accepté
Nous tentons alors de savoir si le fait d’habiter si près du lac Léman – filmé notamment dans Nouvelle vague (1990) – l’a changé. Si ce voisinage a créé en lui un attachement à la nature. Il s’emporte presque : « Mais ça n’a rien à voir. Vous me parlez de moi, ça n’a aucun intérêt à mon avis pour vous de savoir pourquoi je suis venu en Suisse. Il faudrait connaître ma vie encore mieux que moi je ne la connais pour pouvoir me demander quelque chose là-dessus. Sinon, je vous redis ce que j’ai dit mille fois dans des centaines d’interviews. »
Un mur semble s’élever entre nous. Il reprend nos débuts de phrases interrogatives : « Ça veut dire ? », « Ça ne veut pas dire ? », « Comment dire ? ». Et commente : « Je relève tout ça. Aujourd’hui, à la fin de ma vie, ce sont des blessures pour moi. Ç’a été des blessures très tôt. Parce que mon mauvais caractère, ou mon esprit de répartie, est en fait une réponse à une petite piqûre, mais qui aujourd’hui devient plus forte. Si je veux vérifier quelque chose de mon iPhone auprès d’un opérateur de téléphonie, quelqu’un me dit : « On ne peut pas faire ça, désolé. » Avec mon esprit de répartie, que je n’arrive pas à enlever, je dis : « Non, vous dites que vous êtes désolé, mais c’est moi qui le suis. » Et puis ça s’envenime vite. C’est l’alphabet. Le diable est dans les détails. »
Lui, le spectateur de chaînes d’info continue qu’on nous dit assidu, que pense-t-il de la mainmise de Vincent Bolloré sur une part grandissante des médias français (CNews, Canal Plus, Europe 1, Prisma Presse…) ? « Ç’a toujours été le cas, que ce soit Bolloré ou l’ancienne ORTF. À un moment, j’avais cru à la télévision. J’ai même fait des films payés par la télévision. Mais Bolloré… j’aime mieux lire Le Canard à ce moment-là… »
À notre relance étonnée qu’il ne distingue pas le contrôle public (ORTF) de la propriété privée de chaînes de télé et de radio, il répond en changeant de cible : « Je ne parle plus de cette langue qui est faussée, je la parle pour parler avec vous ou faire mes courses, sinon je ne m’y intéresse pas. » À propos de l’homme d’affaires, il dit encore : « C’est trop grand pour moi. Bien sûr que ça me gêne qu’il ait tous ces trucs en Afrique. C’est pas des gens intéressants. Je ne peux pas m’intéresser. » Nos questions sur les interventions médiatiques d’Éric Zemmour ne donnent rien.
Quand vous avez accepté cet entretien, vous nous aviez fait savoir qu’idéalement, il faudrait qu’il y ait un journaliste et une journaliste.
Jean-Luc Godard : Qu’il y ait au moins la parité.
Pourquoi ?
Pour rester dans la doxa.
C’est une doxa ou c’est quelque chose qui vous importe ?
Je ne sais plus répondre. Avant, j’aimais bien répondre. Maintenant non, c’est fini. C’est pas ça qu’il faudrait faire. Je ne sais pas ce qu’il faudrait faire. Dans un film, j’ai fait dire une fois – c’est le film à qui Jane Campion a donné un prix du jury [Adieu au langage, 2014 – ndlr] : « Un fait est ce qui se fait. Mais il ne faut pas oublier que c’est aussi ce qui ne se fait pas. » Et pour moi, ce qui ne se fait pas aujourd’hui est plus un fait que ce qui se fait. Si je dois le dire comme ça. Le vivre, c’est autre chose. Tout ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que ce qui ne se fait pas entre nous est beaucoup plus important que ce qui se fait. Et qu’en particulier, Mediapart ne fait que ce qui se fait. Il cherche toujours qui a touché quel argent. Il ne cherche pas ce que la personne qui a touché l’argent n’a pas fait.
*****
Dans un bel entretien qu’il avait donné aux Cahiers du Cinéma en 2019, mené par Stéphane Delorme et Joachim Lepastier, Godard évoquait déjà le chantier d’un film à venir, intitulé Scénario. Le tournage n’a pas encore eu lieu, repoussé par la crise sanitaire. Le cinéaste ne veut rien nous dire d’un éventuel calendrier de tournage (« Mais qu’est-ce que ça peut vous faire ? »). Mais il nous apporte un objet précieux, le carnet de Scénario, descendu du premier étage de sa maison de Rolle, et qu’il nous laisse regarder et feuilleter.
Vous m’avez déjà rencontré autrefois, où on a dit tout et le contraire de tout. Maintenant, je vous dis le contraire de rien
C’est un livre d’image(s), de dessins et de collages – où l’on reconnaît la Mélancolie, l’une des plus célèbres gravures de Dürer (il commente, sur l’artiste allemand : « Dans Maîtres anciens, Thomas Bernhard dit de Dürer qu’il a mis la nature sur la toile, et l’a tuée. C’était déjà Netflix »), la colombe posée sur une caméra tirée d’un film de Sergueï Parajdanov (Achik Kérib, conte d’un poète amoureux, 1988). Plus loin, dans une séquence intitulée « Avec Bérénice », apparaît un portrait photo d’Assa Traoré : « Oui, je pensais qu’elle pourrait faire quelque chose, faire Bérénice à la fin. » De la sœur d’Adama Traoré, mort entre les mains de la police en 2016, et devenue une figure de proue de la dénonciation des violences policières, il dit : « Je la respecte ou je l’admire. » On pense aussitôt aux Black Panthers qu’il avait filmés à Londres en 1968 dans son film One + One. Mais il n’ajoute rien à propos de la militante.
Sur la même page, un vers de Racine a été recopié, et modifié : « Que tant d’amer nous sépare » (dans l’original : « Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous / Seigneur, que tant de mers me séparent de vous »). Quelques pages avant dans le carnet, un portrait de Rachel Khan, auteure de l’essai à succès Racée (L’Observatoire, 2021), adversaire des nouveaux discours antiracistes et féministes, et qui vient d’être sollicitée par La République en marche pour travailler sur les questions d’immigration et laïcité avant la présidentielle. Pourquoi ? « C’est éventuellement pour lui demander si on peut la filmer, pendant qu’elle vient à LCI – si ça ne la gêne pas. Parce que ç’a un rapport avec ce que j’essaie de raconter. »
Voit-il un lien entre les mobilisations actuelles contre les violences policières et les mouvements des Noirs aux États-Unis dans les années 1960 ? Nous ne parvenons pas à lui poser les questions que nous avions préparées. Nous évoquons Omar Blondin Diop, militant révolutionnaire sénégalais qu’il avait filmé dans La Chinoise (1967), mort en détention en 1973 sur l’île de Gorée, et sur lequel un film du cinéaste belge Vincent Meessen s’est récemment penché.
Jean-Luc Godard : Il est mort en prison…
Au Sénégal, les dernières manifestations reprenaient sa figure…
Tant mieux.
Vous avez été l’un des premiers à le filmer. Vous y pensez parfois ?
Je me souviens de comment il parlait. C’était un ami de ma femme à l’époque [Anne Wiazemsky – ndlr] – c’était un étudiant, il est mort sous le régime de Léopold Sedar Senghor…
Son film le plus récent, Le Livre d’image, évoque les luttes anticoloniales. Y souffle le vent des soulèvements arabes. Nous avons encore envie de savoir s’il se relie d’une façon ou d’une autre à cette effervescence politique. Nous tentons une dernière question.
Êtes-vous touché par ce moment de révolte de la jeunesse : sur le climat, contre les violences sexistes et sexuelles avec #MeToo, contre les violences policières ?
Tout à fait, comme ça a été en Mai 68 ou à d’autres moments, toute révolte est sympathique.
Il y a des correspondances entre Mai 68 et aujourd’hui, mais les figures sont différentes, par exemple Greta Thunberg…
Je les applaudis tous, je suis avec eux dans mon for intérieur, extérieurement, et si elle m’envoie un bulletin de versement, je le paierai.
« Détective », le 10 mai 1985. © Photo Dominique Faget / Ralph Gatti / AFP
De la militante suédoise pour le climat, il dit aussi : « C’est bien, c’est très sympathique, tout ce qu’ils font à Glasgow [pendant la COP26 – ndlr]. C’est pas Fabius [président de la COP21 en 2015 – ndlr] qui ferait ça. » Nous le relançons au sujet des images de la jeune fille, alors lycéenne, seule devant le Parlement suédois avec son panneau « Grève pour le climat » : « Je pense qu’elle est très bien, elle a beaucoup plus de public que moi et j’en suis très content. » Un peu plus tard, il nous cite « cette phrase, que l’on pourrait dire à Greta Thunberg : nous ne sommes jamais assez tristes pour que le monde soit meilleur ».
Savez-vous quand vous allez tourner votre film en projet ?
Jean-Luc Godard : Non. Peut-être que cela va rester à ce stade.
Vous avez envie de le tourner ?
Je pense, un peu, je ne sais pas, je suis un peu âgé, je ne sais pas.
Mais c’est vous qui devez dire si cela vous intéresse ou pas.
On est impatients de savoir quand ce sera tourné, ça nous intéresse.
Mais qu’est-ce que ça peut vous faire ? Vous n’avez aucun besoin de me voir, aucune raison.
C’est notre métier de rencontrer des personnes et d’entendre ce qu’elles disent…
Vous m’avez déjà rencontré autrefois, où on a dit tout et le contraire de tout. Maintenant je vous dis le contraire de rien.
Mais vous aviez accepté cette proposition de rencontre.
Oui, c’est comme aller sur des lieux d’autrefois.
On arrête là ? On ne veut pas vous déranger…
Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, c’est pour ça que j’ai accepté.
Votre curiosité a-t-elle été satisfaite ?
Elle m’a convaincu de ce que je pensais de Mediapart.
C’est-à-dire ?
Chaque fourmi travaille à vivre le mieux ou le moins mal possible. C’est un moment très intéressant, ce qui se passe en France est très intéressant pour la France, elle est sérieusement malade mais elle le sait, beaucoup d’autres régimes ou pays ne le savent pas.
*****
Nous nous apprêtons à arrêter les enregistreurs et à quitter Rolle. Mais Godard nous interrompt, une dernière fois, et cette fois-ci nous retient. En début d’entretien, il nous avait parlé de cinq phrases « qui [lui] restent en mémoire, et [qu’il se] répète des fois le soir pour voir [s’il][s]’en souvien[t] encore ». Mais à ce stade de la rencontre, au bout d’une heure trente de va-et-vient douloureux entre lui et nous, nous n’y pensons plus.
Jean-Luc Godard : Je ne vous ai pas dit mes cinq phrases ! Vous oubliez, c’est moi qui dois vous le rappeler… Cela m’aide, si je vous les dis. Ça m’aide, pour voir si je les sais toujours.
Au moins, on aura servi à ça.
D’accord. La première, c’est une phrase de Bernanos, dans Les Enfants humiliés, ou ailleurs. J’en ai fait un petit film, du reste, sur Sarajevo [Je vous salue Sarajevo, en 1993, voir la vidéo ci-dessous – ndlr] : « La peur, voyez-vous, est quand même la fille de Dieu, rachetée la nuit du Vendredi saint, elle n’est pas belle à voir, tantôt éraillée, tantôt médiatique, et pourtant ne vous y trompez pas, elle est au chevet de chaque agonie, elle intercède pour l’homme. » C’est une phrase qui peut tout à fait se rapporter à la France d’aujourd’hui qui a peur. Même CNews peut en parler.
La deuxième phrase est de Bergson. Elle m’avait été envoyée par un ancien régisseur, je l’avais déjà citée, il me l’a recitée, puis je l’ai fait dire à Alain Badiou dans Film Socialisme. C’est : « L’esprit emprunte à la matière les perceptions dont il fait sa nourriture et les lui rend sous forme de mouvement auquel il imprime sa liberté. »
Je n’ai jamais bien compris le mot de « perception », les perceptions de la matière.
La troisième phrase, c’est une phrase de Claude Lefort, qui était un philosophe du temps d’un petit groupement qui s’appelait Socialisme ou barbarie, à l’époque de Sartre et Simone de Beauvoir : « Les démocraties modernes, en faisant de la pensée un domaine politique séparé, prédisposent au totalitarisme. » Et voici l’image d’une jeune fille qui plus tard a écrit des livres sur le totalitarisme.
À LIRE AUSSIJean-Luc Godard en liberté7 mai 2010
Il montre le portrait en noir et blanc d’Hannah Arendt.
À l’époque où elle était amoureuse de Heidegger. Cette image est dans un film d’Anne-Marie [Miéville] que vous ne connaissez pas, qui s’appelle Nous sommes tous encore ici[1996 – ndlr].
Après, il y a une quatrième phrase. Vais-je me souvenir du nom de l’auteur ? Pour le retrouver, je tape sur mon iPhone le nom d’un livre qui s’appelle Masse et Puissance [publié en 1960 – ndlr].
Jean-Paul Battagia (son assistant) : Je vais le faire… Elias Canetti.
J’ai mis cette phrase dans Le Livre d’image – elle est dite par ma femme à ce moment-là. On pourrait la dire à Greta Thunberg : « Nous ne sommes jamais assez tristes pour que le monde soit meilleur. »
Et j’en rajoute une cinquième, qui est une phrase de Raymond Queneau, dont j’ai beaucoup aimé à l’époque les romans. Cet aphorisme est le suivant : « Tous les gens pensent que deux et deux font quatre, mais ils oublient la vitesse du vent. »
Il rallume son cigare.
Les cinq phrases, pour les cinq doigts, dont je me souviens depuis des années, et que j’essaie de me répéter, comme un vade-mecum. Je le fais mécaniquement, et des fois, j’essaie d’y penser un peu, de rester avec elles. Surtout quand je m’endors, en général. Voilà. Vous avez réussi à me faire parler, hein. Puisque c’est ce que vous vouliez.
Il se lève du fauteuil pour nous saluer. Nous partons.
Ludovic Lamant et Jade Lindgaard de Mediapart.