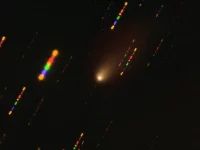Pourquoi le porno japonais fascine-t-il ?

FANTASMES Lors de la vague de l’expansion industrielle du Japon dans les années 1960 à 1980, les sociétés de l’archipel ont taillé des croupières à leurs homologues occidentales en misant sur une valeur clé, la satisfaction du client et la compréhension de ses besoins. Des légions de cadres occidentaux se sont évertuées à comprendre comment les champions de l’industrie du high-tech ou de l’automobile que sont Sony, Panasonic ou Toyota ont réussi à mettre en place une telle capacité de répondre efficacement à la demande et emporter l’adhésion des clients. Même si la démarche eut été moins conventionnelle, ils auraient tout aussi bien pu se former en décortiquant les entreprises du marché de l’AV. Celles-ci ont en effet réussi le pari de fidéliser le client grâce à une stratégie double: une offre segmentée à l’extrême, et le recueil des goûts de leur clientèle pour faire évoluer leur offre.
Pourquoi le porno japonais fascine-t-il? En premier lieu parce qu’il propose une gamme de fantasmes très précis qui servent d’arguments commerciaux pour la promotion d’un film. Quand il ne s’agit pas d’une actrice en particulier, c’est un fantasme, une situation, une configuration sexuelle particulière, voire une profession qui est mise à disposition d’un spectateur qui sera prêt à débourser de l’argent pour acquérir ce produit particulier. La tendance à cette segmentation qui confine parfois à l’obsession est un trait connu en Occident. À tel point que dans l’imagerie populaire, le porno nippon est volontiers perçu comme déviant. C’est une erreur d’interprétation, la déviance se définit par rapport à une norme majoritaire. Or, dans le business de l’AV, il n’y a rien de majoritaire, à part l’hétérosexualité, il n’y a qu’une myriade de cas particuliers.
«Ce qui caractérise le porno japonais par rapport à l’Occident, c’est que les spectateurs ne sont pas considérés comme une masse anonyme et sans désir.»
Un bon connaisseur du secteur
Lister dans un ouvrage l’ensemble des fantasmes disponibles à la vente serait fastidieux, et certains amateurs de vidéos pornographiques nippones s’y sont déjà largement attelés. Une seule règle vaut pour une écrasante majorité de la production: que le produit soit rapidement identifiable dans un genre particulier. Femmes jeunes ou matures, starlettes ou débutantes, tendresse ou violence, fantaisie particulière allant du fétichisme des sous-vêtements aux faux jeux télévisés, en passant par l’hypnose, les massages huileux ou les successions de coups de pied envoyés dans les parties intimes des acteurs mâles, tout est identifiable. Une tendance qui commence d’ailleurs à sonner comme familière dans les nouvelles consommations du porno en Occident où les sites web de vidéos vite consommées proposent de plus en plus un classement par «tag» toujours plus précis. Sauf que cette extrême rigueur du classement et de la segmentation structure le marché au Japon depuis une trentaine d’années.
«Je pense que ce qui caractérise le porno japonais par rapport à l’Occident, c’est que les spectateurs ne sont pas considérés comme une masse anonyme et sans désir. La structuration du marché permet de prendre en compte ses souhaits, ses exigences, les producteurs poussent d’ailleurs leurs consommateurs à dire ce qu’ils apprécient, ce qu’ils aimeraient voir. Il y a des salons, des rencontres, des possibilités de contacts qui font remonter plus facilement l’information, ce qui permet de mieux calibrer les produits», nous explique un bon connaisseur du secteur qui suit l’évolution du milieu depuis deux décennies. «En Europe, pendant longtemps, les films qui sortaient des grands studios étaient assez indifférenciés et proposaient quelque chose censé correspondre au plus grand nombre. Les sites de streaming commencent à changer la donne en poussant au classement par genre spécialisé, mais l’aspect anonyme des spectateurs empêche une analyse vraiment fine de ce qu’attend le marché.» Cercle vertueux: plus la consommation de porno paraît libérée, plus les produits correspondent à ce qu’attend le public. «En Europe, vous pensez que les films japonais sont bizarres. En fait, ils répondent juste à une demande qui a été identifiée. Vous auriez le même genre de films si vous aviez la même capacité de détection des goûts du public.» On pense faire face à une vraie question anthropologique quand on regarde la diversité des scénarios sexuels proposés par l’industrie de l’AV. On ne serait en fait que face à une basique leçon d’économie entre la différence entre une politique de l’offre et une politique de la demande!
Produire, toujours produire
Mais comment font-ils pour produire tant de films? S’intéresser au porno nippon, c’est faire face en premier lieu à la question de l’incroyable productivité en films de qualité sur le plan technique en comparaison avec les standards occidentaux. Une équipe professionnelle de techniciens, parfois réduite à la portion congrue. Les productions les plus modestes se contentent parfois d’un simple réalisateur filmant lui-même et réalisant les photos d’illustration de la jaquette, parfois assisté d’un maquilleur ou d’une maquilleuse payé(e) à la demi-journée. Mais les dizaines de milliers de films qui sortent des studios de l’archipel ne descendent pratiquement jamais en dessous d’un certain plancher qualitatif, avec des techniciens payés, compétents, pas nécessairement créatifs mais connaisseurs de la manière d’assurer une prise de vue. Des tournages en intérieur dans des lieux dédiés, rarement chez des particuliers. Un matériel de qualité que ne bouderaient pas des productions cinématographiques à petits budgets, et une organisation générale du travail qui ne laisse pas de place à l’improvisation, pour réduire les coûts sans rogner sur le produit. Comment la prouesse est-elle possible? La réponse est simple en apparence. Le modèle économique de l’AV au Japon est pensé de telle manière que tous les films soient rentables… au moins un peu. Connaissant bien son public, ses acheteurs, son réseau de distribution, et les tendances du moment, tout en sachant produire de la qualité à moindre coût, l’idée est que chaque film génère son petit bénéfice. Et comment gagne-t-on concrètement sa vie quand on ne dégage qu’un léger bénéfice en faisant un film? Il faut en produire beaucoup, beaucoup. Énormément.
«Nos budgets varient entre 1 million de yens (environ 8.300 euros) pour les moins chers à 1,5 million de yens (environ 12.500 euros) pour les plus grosses productions.»
Sôichiro Tamura, réalisateur de films pour adultes
Sôichiro Tamura est l’un des réalisateurs de l’écurie qui œuvre –à plein-temps et salarié– pour le studio Momotaro Eizo, basé à Tokyo. En vingt ans d’une carrière qu’il n’a commencée qu’au milieu de la trentaine, il a tourné pas moins de 700 films. De son propre aveu, certains sont mieux réussis que d’autres, tous n’ont pas la même valeur technique ou artistique, mais aucun n’a été réalisé sans un minimum de moyens. Et il nous explique que dans son studio, les budgets sont maîtrisés… mais loin d’être faméliques. «Nos budgets varient entre 1 million de yens (environ 8.300 euros) pour les moins chers à 1,5 million de yens (environ 12.500 euros) pour les plus grosses productions.» Le tarif n’est finalement pas si éloigné des (rares) studios qui produisent encore de la pornographie dans des conditions vraiment professionnelles en France. C’est même loin de ce que peut produire une maison comme Marc Dorcel qui peut encore envisager de mettre 100.000 euros sur une belle production, et plutôt autour de 50.000 euros pour une production plus standard. Une somme qui est même équivalente aux géants du secteur dans l’archipel: «Un studio comme Soft on Demand, l’un des géants du secteur, peut –sauf film événement– mettre environ 5 millions de yens dans un film (environ 42.000 euros).» Autrement dit, la force du secteur n’est pas l’argent que l’on peut aligner sur une seule production. À ce petit jeu de celui qui a la plus grosse capacité financière sur un titre, l’Occident n’a rien à envier au Japon. Mais les entreprises de l’archipel, elles, peuvent multiplier les sorties à un rythme effréné. Si Marc Dorcel parvient encore en moyenne à sortir deux films par mois – une performance à ce niveau de qualité sur le marché français–, Soft on Demand en produira une cinquantaine dans le même laps de temps.
Même les plus petites productions parviennent à trouver leur place. Exemple avec Plum, un modeste studio de production, utilisant des actrices pour la plupart méconnues, mais toujours des professionnelles. Ici, le budget par film ne dépasse pas les 600.000 yens par production (5.000 euros environ), et tourne plutôt autour de 400.000 yens (3.300 euros). La recette? La même que les autres, contracter les coûts mais sans rogner sur la qualité sans laquelle le client de toute façon n’achètera pas. La solution réside dans des studios loués à la journée, des tournages qui peuvent se dérouler sur une seule session de 14 ou 16 heures de travail et des réalisateurs jeunes qui peuvent ainsi s’aguerrir sur des productions modestes, où l’exigence technique est finalement proche des grands studios, mais à des prix plus bas. C’est le même modèle de films qui se retrouvent tous à la vente pour générer du chiffre d’affaires et, si possible, un petit bénéfice. Avec à l’arrivée, une logique d’accumulation de petits profits pour exister économiquement, le studio propose à ce jour plus de 2.000 films à son catalogue.