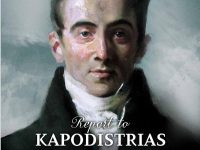Fashion. Peter Saville, nouvel ordre graphique

VISUAL CULTURE. Auteur de pochettes de disques emblématiques pour Joy Division et New Order, le directeur artistique anglais Peter Saville est également très impliqué dans l’univers de la mode.
On sait depuis longtemps à quoi ressemblent les légendes du rock, du cinéma ou de la littérature. Mais à quoi ressemble une légende du graphisme? A quoi reconnaît-on celui ou celle qui forge, dans l’ombre, la culture visuelle de millions de citoyens? A son souci du détail, peut-être. Quand il s’exprime, Peter Saville cherche en permanence ses mots, aligne les grimaces et les adjectifs dans un souci d’objectiver au mieux sa très chaotique subjectivité. Surexcité, logorrhéique, ce dandy décadent reçoit en pleine Fashion Week dans son studio-appartement de l’Est londonien. Pas de meubles, pas d’œuvres d’art. Juste d’interminables bibliothèques et un matelas, qui lui sert aussi de table à manger. «Je campe ici depuis 2003. J’aimerais bien déménager mais je n’en ai pas les moyens. Les spéculateurs immobiliers ont perdu la tête», se désole-t-il en écrasant une cigarette.
Auteur de pochettes de disques emblématiques pour les groupes Joy Division et New Order, Saville, 62 ans, a marqué plusieurs générations de mélomanes par son style radical questionnant les modes de consommation et de communication. Véritable trait d’union entre l’underground et le mainstream, la culture des damnés et celle des élites, l’artiste et designer britannique fera certainement salle comble lors de la conférence qu’il donnera à l’Ecole cantonale d’art de Lausanne le 19 mars.
Fait plus méconnu, Saville est aussi le premier graphiste à avoir été réellement impliqué dans la communication de mode. Depuis les années 1980, ce natif de Manchester collabore ainsi avec de grands designers comme Yohji Yamamoto, Jil Sander, John Galliano, Julien Dossena chez Paco Rabanne. Et à la demande du directeur artistique Raf Simons, Peter Saville vient de redessiner le logo de la marque Calvin Klein, longtemps intouchable symbole d’une culture où mode et consumérisme se confondent. Une culture que Saville dit exécrer.
Nous sommes en pleine Fashion Week de Londres. Assistez-vous à des défilés?
Peter Saville: Non, j’ai développé une résistance à ce genre d’événements. En 2014, j’avais créé avec Yohji Yamamoto une collection que je tenais à baptiser «Meaningless Excitement» («excitation insignifiante»). A mes yeux, c’est ce que la mode est devenue. Quand j’étais jeune, la mode était un atout, un outil qui permettait de naviguer dans le monde en vous aidant à devenir la personne que vous vouliez être. Mais en vingt-cinq ans, je l’ai vue se transformer en addiction consumériste, un comportement stupide, contre-productif et même dangereux. Tout cela n’a plus aucun sens. Pour reprendre une analogie que j’ai utilisée souvent, la mode était autrefois comme du LSD, un trip de folie qui ouvrait votre esprit au monde. Aujourd’hui, c’est du crack, cela vous isole de la réalité.
Pour de nombreux jeunes gens, la mode constitue tout de même une porte d’entrée sur la culture et le monde.
Oui, elle peut l’être, mais il ne faut pas en devenir victime. Personne ne vous oblige à dépenser 50 000 euros en vêtements chaque année. Mais c’est de plus en plus difficile de résister. L’indépendance de la mode a été avalée par une poignée de grands groupes de luxe qui siphonnent aujourd’hui les poches de la classe moyenne.

Pourquoi continuez-vous à travailler avec certains de ces groupes de luxe?
Ce sont eux qui viennent vers moi, et il se trouve que j’ai besoin de gagner ma vie. Et je ne travaille que sur les projets qui m’intéressent. Si j’ai accepté de redessiner le logo de Calvin Klein l’année passée, c’est parce que Raf Simons me l’a demandé. Raf est le premier designer de mode à avoir fait référence à mon travail avec Joy Division dans ses collections. C’était en 2003. A l’époque, il était venu me demander un accès aux archives, ce qui était plutôt cool venant d’un jeune designer indépendant. C’est quelqu’un dont je respecte la vision et le travail.
Quels ont été vos premiers contacts avec la mode?
Le style des gens et des objets m’intéresse et j’ai toujours gravité d’une façon ou d’une autre autour de la mode. A Manchester, où j’ai grandi, mon meilleur ami tenait une boutique de vêtements pour homme très avant-gardiste. Je demandais aussi à mes parents de m’emmener à Carnaby Street, à Londres, où j’achetais des chemises à fleurs et des caftans, qui allaient très bien avec mes cheveux longs. A l’époque, dans les années 1960, il n’existait pas de magazines de tendances. J’ai forgé mes goûts et ma culture visuelle à travers le cinéma et, surtout, la musique et les pochettes de disques. L’image des chanteurs et des groupes de musique était alors assez figée. En 1969, à 14 ans, je suis allé voir mon tout premier concert de rock. C’était David Bowie, qui n’assurait encore que la première partie. J’ai pris une véritable claque. A toute une génération d’ados, Bowie montrait qu’il était possible de s’inventer une identité, loin de celle donnée par nos parents. Pour moi, la mode faisait donc partie de la culture contemporaine, mais ce n’était pas une fin en soi.
Inconsciemment, l’univers du vêtement et du style a donc influencé la création de vos pochettes de disques?
Totalement. Pendant mes études de graphisme déjà, je venais chaque mois à Londres pour acheter une copie de Vogue Paris. C’était très important pour moi, car j’y découvrais le travail de photographes comme Guy Bourdin ou Helmut Newton, des artistes qui brisaient des tabous sociopolitiques. En plus, les filles étaient sexy! Plus tard, quand je me suis installé à Londres au début des années 1980, je suis devenu ami avec Scott Crolla et Georgina Godley, qui tenaient sur Dover Street une incroyable boutique de mode. Ils étaient capables de juxtaposer d’opulents tissus de chez Sanderson avec une étagère du Corbusier, ou de faire des robes avec des tissus de tapisserie. Tout cela n’avait rien d’une excentricité irritante ou chichiteuse. C’était un laboratoire d’idées postmodernes qui m’a directement influencé pour la pochette de Power, Corruption and Lies du groupe New Order. Grâce à Scott et Georgina, je savais qu’un tableau fleuri d’Henri Fantin-Latour n’aurait rien de ringard sur une pochette d’album new wave. C’était une lecture très contemporaine du Flower Power et c’était très cool!
Vous imposiez votre propre vision sur ces pochettes, alors qu’en théorie vous étiez là pour véhiculer celle du groupe de musique. Ce statut d’artiste n’a jamais irrité les membres de Joy Division puis de New Order?
Non. Dès le début, je n’en ai fait qu’à ma tête. J’envoyais souvent les pochettes chez l’imprimeur sans même que les membres du groupe y jettent un œil. Ils ont toujours trouvé ça OK. Vous savez, les gens de Manchester ne sont pas très expansifs. De plus, quand Ian Curtis est mort et que Joy Division a décidé de continuer en tant que New Order, il régnait au sein du groupe une démocratie du désaccord. Ils étaient incapables de prendre la moindre décision à l’unanimité. Je n’avais donc de comptes à rendre à personne et, comme vous le dites, les pochettes étaient pour moi une sorte de pratique artistique diffusée à grande échelle.
Le monde de la mode et celui de la musique n’ont jamais été aussi convergents qu’aujourd’hui. Comment l’expliquez-vous?
Ce n’est que l’accomplissement de la pop culture. Nous sommes devenus une culture globale, tout est lié. Aujourd’hui, les gosses parlent aussi bien d’art, de musique, de mode que de graphisme et de typographie.
Vous faites aussi partie de cette culture globale puisque vos pochettes de disques se retrouvent aujourd’hui imprimées sur des t-shirts H&M. Que pensez-vous de cela?
Je trouve que c’est extraordinaire. Les gens qui achètent ces t-shirts ne savent probablement pas de quoi il s’agit, mais ça fait partie de l’époque, et à ce titre c’est intéressant. Et pourquoi les achètent-ils? En partie parce que les images que j’ai créées il y a quarante ans sont encore cool aujourd’hui. C’est un grand honneur de faire partie, à 62 ans, de ce grand nuage qu’est la culture contemporaine.